|

Extraits du journal de Harry Morgan 2020
MALHEUR, DESTRUCTION, RUINE ET DÉCADENCE
Les obstacles du monde
Woe destruction ruin and decay
Richard II

1er janvier. — Promenade dans le smog créé par le brouillard, les fumées des pétards et les feux de véhicules et de poubelles, car la liesse, c’est-à-dire l’émeute festive, a été cette année portée à son paroxysme. À certains endroits, où la fumée stagne de façon incompréhensible, la respiration est aussi difficile que sous les lacrymogènes des manifestations de « gilets jaunes ». Ce ne sont pas les endroits où l’ont voit les traces d’incendies ou les résidus des mortiers. Il y a une géographie invisible, une géographie aérienne, avec ses reliefs et ses vallons. Voilà une promenade qui m’aura fait le plus grand mal, au point de vue physique comme au point de vue moral.
3 janvier. — Premier attentat de l’année, un égorgeur dans un jardin public, à Villejuif – qui, pour les islamistes, est naturellement « la ville des juifs » car, comme tous les militants, les muwahhidin vivent dans un univers de symboles.
La journaille tient très fermement la ligne. Cet argument stupéfiant : la preuve que Nathan C. n’est pas un terroriste, c’est qu’il était « inconnu au titre de la radicalisation ». Au-delà du simple illogisme, je relève l’obtusité journalistique, puisqu’une précision apportée par les pouvoirs publics dans le dessein manifeste d’écarter la responsabilité de l’État (le détraqué homicide n’était pas fiché et donc l’administration n’a pas commis de faute, par exemple en ne l’hospitalisant pas d’office) est répétée par le journaliste, mais pour écarter la responsabilité du terroriste (il n’était pas fiché, donc il n’est pas un terroriste).
4 janvier. – Témoignages sur la nuit de la Saint-Sylvestre, de pompiers qui confient que les guets-apens qui leur étaient tendus visaient clairement à capturer l’un d’entre eux. Cela témoigne, dans la pègre des quartiers, d’une certaine tournure d’esprit, candide et meurtrière. Les pompiers sont règlementairement obligés de venir s’il y a un feu. Donc si on allume un feu, on a de bonnes chances de pouvoir capturer un pompier et de le lyncher. C’est une forme de chasse à l’appât.
5 janvier. — Point de situation par un spécialiste de la sécurité intérieure. Après les grands massacres de 2015 et 2016 par des commandos du Califat infiltrés dans le flot des « migrants », après la phase des frappes individuelles réalisées avec les moyens du bord, ce qui nous attend, c’est un « terrorisme endogène structuré », qui sera le fait de la racaille de banlieue, soulevée par la haine de la France, encadrée par des combattants aguerris, rentrés du Levant, et appuyée par les commandos introduits en 2015, dont une partie se trouve encore dans la nature. Ajouter les centaines de terroristes actuellement sous écrou qu’on s’apprête à libérer.
Les experts ont jusqu’ici exactement prédit ce qui allait se passer, de sorte que le déni des médias a d’emblée pris une coloration singulière, puisque la partie de la population qui lit un journal était, à chaque étape, parfaitement informée sur la tournure des événements.
8 janvier. — Liquidation par les États-Unis du chef de la force Al-Qods. L’Iran réagit en abattant un avion de ligne et en organisant pour le chef terroriste des obsèques à grand spectacle, avec présence obligatoire des fonctionnaires, mouvements de foule et centaines d’écrasés. Je ne comprends pas pourquoi nos médias minimisent le nombre de piétinés et soutiennent que le Boeing aurait été victime d’un incident mécanique. Je ne comprends pas davantage pourquoi les journaux impriment que cet avion contenait des « Canadiens », alors que les passagers étaient des Iraniens « réfugiés » au Canada et qui rentraient de vacances dans leur pays.
11 janvier. — Les Iraniens ont avoué qu’ils ont abattu l’avion de ligne, au grand embarras des médias occidentaux. Quel monde à l’envers. C’est la tyrannie arriérée et meurtrière qui joue la transparence. Ce sont les médias occidentaux qui mentent et qui propagandisent.
16 janvier. — Dormi un tour d’horloge pour me refaire des fatigues de la scintigraphie d’avant-hier. Repris la course légère. Mais je suis mal remis de mon examen et la remontée des températures rend l’exercice physique beaucoup plus pénible. J’ai couru à la vitesse habituelle mais, rentré chez moi, je tremblais sur mes jambes, comme un cheval fourbu.
Je lis la conférence, devenue une sorte de petit livre, d’un ex-ambassadeur et ex-directeur de la DGSE pour un think-tank chevènementiste. Le risque, selon l’expert, n’est pas tant le terrorisme, qui est le fait d’une minorité, que l’insurrection générale des enclaves musulmanes. (Cela se recoupe avec l’avis du spécialiste de la sécurité intérieure, voir la note du 5 janvier.) Les autorités le savent et font tout pour éviter l’explosion. D’où cet impératif absolu de ne fâcher personne. D’où aussi la prédication constante à destination de la population européenne, puisque c’est à elle de fournir tous les efforts d’accommodement.
Mon expert fait aussi cette remarque que j’ai si souvent faite pour mon compte : la seule arme des élites progressives est le langage, et la création d’une réalité postiche par le langage.
17 janvier. — À Strasbourg, manifestation géante de pompiers, qui dénoncent les guets-apens de la Saint-Sylvestre. L’image de ces centaines de soldats du feu symboliquement couchés par terre devant le Palais de justice, pour réclamer des juges qu’ils sévissent contre les émeutiers, c’est certainement l’une des plus bizarres de l’actuelle guerre.
Achevé la lecture du petit livre, ou de la longue communication, de l’ex-directeur de la DGSE. Ce serait donc le souci de ménager la susceptibilité mahométane, crainte de mettre le feu aux poudres, qui expliquerait le mensonge systématique sur les exactions islamiques. Bref, on mentirait aux musulmans, de manière prophylactique, quitte à susciter l’incrédulité et l’ironie amère de la population. Que vaut cette explication ? Que valent les explications rivales (on mentirait aux Français pour les rassurer, ou bien, tout simplement, le pouvoir mentirait pour cacher son impuissance) ? Toutes sont vraisemblables, mais à bien examiner toutes ressemblent à des conjectures, chaque expert étant naturellement persuadé de connaître le dessous des cartes. À vrai dire, la situation est à mes yeux tellement absurde qu’elle me paraît se passer de toute explication, autre que le désarmement moral. Nier une réalité gênante en dépit de l’évidence fait partie du répertoire d’attitudes des gouvernements victimaires, et un tel mensonge est à lui-même sa propre explication. Quant aux médias, fidèles à leur mission de propagande, ils rechignent à fournir des éléments qui contreviennent à l’orthodoxie du moment. Il n’y a là aucun mystère.
18 janvier. — Il plane décidément un mauvais air. Le président était au théâtre. Un « journaliste militant », en réalité une petite gouape qui filme sa propre participation aux émeutes, a signalé sur les réseaux la présence du chef de l’État. D’autres « militants » se sont rassemblés devant le théâtre et ont essayé d’entrer. Le président a été brièvement exfiltré, la petite gouape, qui n’en est pas à son coup d’essai, a été arrêtée, puis relâchée.
Ce que je note ici est une tentative de reconstitution des événements d’après la dépêche d’agence, car cette dépêche contient précisément le récit qu’écrirait la petite gouape si la petite gouape était capable d’écrire.
[Ajout.] La petite gouape se vante à présent d’avoir vu le président foutre le camp, mort de trouille. Et la petite gouape se réserve de publier les images tournées par elle de cette fuite. Or on sait par des confidences de gens qui étaient dans la salle qu’il n’est rien arrivé de tel. Le président a rapidement pu regagner son siège, il a assisté à la représentation jusqu’au bout, s’est longuement entretenu ensuite avec les acteurs et metteurs en scène du spectacle.
20 janvier. — Cette fusée d’un ancien dirigeant d’un « syndicat » étudiant, fameux pour sa lutte contre les « réactionnaires », sa culture du viol et sa coopération avec l’islam radical : « On a commencé à se positionner en anti-Front national pour ensuite dire que l'islam c'est pas si mal. Et de là, certains ont glissé vers : “l'islam, c'est mieux.” »

21 janvier. — Je fais une pause dans Rider Haggard, qui a fait les frais de mon light reading pendant les dix derniers mois. Ce qui me frappe est l’aspect gothique à peine transposé des romans africains de Haggard. Je ne fais point allusion ici à ce gothique tardif ou « fin de siècle », pour lequel Patrick Brantlinger avait proposé à la fin des années 1980 l’expression « gothique impérial », mais bien au gothique originel, celui d’Horace Walpole, d’Ann Radcliffe ou de Monk Lewis. On pourrait dans le cas de Haggard parler d’un gothique africain. Son trait principal est une projection vers le passé (le roman gothique, comme son nom l’indique, est par nature orienté vers une époque médiévale). L’Afrique de Haggard est le lieu de la conservation et du surgissement du passé, qu’il s’agisse d’une féodalité africaine (les différentes tribus unies par des liens de vassalités) ou d’une antiquité africaine (une cité perdue comme celle de Kôr, une civilisation perdue comme celle de Zu-Vendis), l’Afrique étant perçue comme le lieu des origines, celui où l’on trouve les ruines – les ruines habitées – des civilisations fondatrices. De ce fait, il n’y a pas d’entreprise coloniale à proprement parler : les Anglais sont chez eux en Afrique, comme tout le monde, les Égyptiens, les Babyloniens, les Phéniciens, les Perses. On est dans le cadre d’une redécouverte, éventuellement d’une réappropriation. Au surplus, le projet impérial lui-même est décrit avec ironie, précisément du fait du caractère transitoire des civilisations. La projection vers le passé s’accompagne donc d’une projection vers le futur, car il viendra une époque où le fourbi des Anglo-Africains se changera à son tour en « vestiges » archéologiques trouvés au hasard de fouilles, priceless relics of the Anglo-African age, comme l’écrit Haggard avec une ironie gothique dans The People of the Mist.
L’élément métapsychique ou surnaturel chez Haggard relève également du gothique originel, car le champ de la sorcellerie est défini par la faculté de prophétie, de sorte que les sorciers et les sorcières africains communiquent invariablement le programme narratif du roman, programme que le romancier déroule ensuite vers son issue fatale, et que les personnages subissent avec stoïcisme. Or cette économie romanesque est homologue à celle de la fiction gothique, qui est centrée depuis Walpole sur la malédiction ancestrale, même si, chez Haggard, elle donne une structure tout à fait particulière à l’univers romanesque.
Ces deux premiers aspects du gothique africain de Haggard pourraient se résumer dans la formule : fatalisme et féodalisme.
Sont également gothiques, outre les ruines elles-mêmes – qui ne sont pas celles de castels médiévaux mais, encore une fois, celles des civilisations antiques, dont le prototype reste Kôr, la cité des morts, dans She –, les paysages de rocs nus, les falaises vertigineuses qui entourent et enferment les mondes perdus comme Kukuanaland, Zu-Vendis, etc. À ce paysage gothique est associé le vertige gothique, dans des scènes cauchemardesques d’escalade, ou au contraire de glissades le long de falaises à pic, de traversée de fragiles ponts de neige ou de glace.
Gothiques encore les personnages, la jeune fille isolée dans un domaine, même si, au lieu d’un ténébreux château, ce domaine est une plantation au fond de l’Afrique (Stella dans Allan’s Wife, Juanna dans The People of the Mist, la jeune fille Hope dans Holy Flower, Inez dans She and Allan), le traître (mais ce trait n’est pas distinctif, le traître gothique étant généralisé dans le type de fiction que pratique Haggard), les monstres (con)sacrés, gorille géant, crocodile monstrueux, éléphant gigantesque, serpent démesuré, les sorciers malfaisants, les cultes immondes.
Gothiques toujours, les émotions. L’horreur gothique accompagne les scènes paroxystiques de sacrifice humain ou celles, omniprésentes, de bataille. Cette horreur annihile les sens (alors que la terreur, au contraire, les aiguise). Allan Quatermain, au cœur de la bataille, est incapable de dire ce qui s’est passé, comment il s’est transporté à tel endroit, par quel miracle il est toujours vivant. Cette horreur gothique est très proche du vertige gothique, de l’horreur des altitudes et de la chute, qui elle aussi abolit la conscience.
Tout ceci n’empêche pas que Haggard relève également du « gothique impérial ». Brantlinger donne de ce dernier la définition suivante : appartient au « gothique impérial » le roman d’aventures incluant des éléments gothiques, dans la période allant de 1880 à la Grande Guerre. Brantlinger propose précisément, comme terminus a quo, King Solomon’s Mines de Haggard, paru en 1885, et, comme terminus ad quem, Greenmantle de Buchan, paru en 1916. D’autres auteurs de cet imperial gothic sont Stevenson, Kipling, Stoker ou Doyle. Les thématiques fondatrices de l’imperial gothic selon Brantlinger sont l’invasion de la civilisation par les forces obscures de l’occulte et du démoniaque, et réciproquement l’atavisme, qui cause la chute du civilisé dans la barbarie primitive (« going native »). Une troisième thématique est la disparition des terrains propices à l’héroïsme et à l’aventure (de fait, mon excellent ami Allan Quatermain a souvent tenu là-dessus des discours éloquents).
On retrouve ces motifs du « gothique impérial » dans les romans africains de Haggard. L’occultisme, la démonialité, se manifestent à travers la sorcellerie africaine et la présentation de certains peuples comme démoniaques (les Amahagger, habitants de Kôr, le peuple du brouillard dans The People of the Mist, les Pongo dans The Holy Flower). Ces mêmes peuples de démoniaques sont décrits comme dégénérés, ce qui explique leurs pratiques de sacrifice humain, de cannibalisme. Le motif de la dégénérescence s’applique aussi individuellement à Ayeha quand elle retourne dans la flamme sacrée, puisque, en un cauchemar darwinien, elle se transforme en une sorte de singe, devenant avant de disparaître une nouvelle Gagool, la simiesque sorcière apparemment immortelle de King Solomon’s Mines.
L’analyse de Brantlinger relève pour une part de l’évidence. Il n’est pas très difficile de lire l’irruption fictionnelle en Angleterre de menaces orientales, vampires, momies vivantes, bijoux ou objets porteurs de malédictions, dacoïts, thugs étrangleurs, fakirs, sectes d’assassins, comme la traduction littéraire d’un malaise colonial, qui relève d’une inquiétude gothique. On pense, chez Haggard, aux White Kendah dans The Ivory Child, des Somaliens qui font irruption dans la demeure de Lord Ragnal, dans l’Essex, procurent, dans la transe hypnotique, des visions véridiques et prophétiques à Allan Quatermain et à Miss Holmes, et essaient d’enlever cette dernière pour en faire leur prêtresse. Cependant, pour ce qui est de la thématique symétrique de l’atavisme, l’inquiétude gothique est surmontée chez Haggard, qui associe les Africains, comme du reste les Vikings, à un âge héroïque – le rapprochement avec les héros homériques ou ceux de l’antiquité romaine est explicite –, et qui propose comme idéal de la masculinité les qualités du gentleman anglais combinées à celles du barbare, au prix d’une ambiguïté jamais surmontée, puisque les personnages de guerriers sont décrits par ailleurs comme assoiffés de sang et comme capables de tuer de façon impulsive, de sorte que, transposés dans un environnement urbain, ils seraient indiscutablement classés parmi les psychopathes.
24 janvier. — Repris la lecture d’Ainsworth. Rookwood (1834) contient bien quelques toiles d’araignées, mais on n’en attend pas moins d’un roman gothique.
Il me frappe que le clou du roman, qui est la chevauchée du brigand Dick Turpin de Londres à York, décrive le protagoniste de façon tout à fait réaliste sur le plan psychologique. Dick Turpin est un sociopathe, qui agit de façon impulsive, et qui va ensuite au bout de ses résolutions sans que rien ne puisse l’arrêter, ce mélange d’impulsivité et d’inflexibilité constituant, sur le plan psychologique, le fond de sauce du type criminel. Ceci n’empêche nullement que Dick Turpin soit, dans le roman, un brigand au grand cœur. Et le fait qu’il soit un brigand au grand cœur n’empêche pas qu’il soit pendu.
29 janvier. — Sur le site du Daily Mail, images particulièrement bien filmées, par un amateur doué, non point d’une rixe (a brawl), comme l’écrit trompeusement le journal, mais bel et bien d’un lynch, d’une exécution sommaire à coups de pied, où dix fois, vingt fois, on frappe en pleine tête, en plein visage, en prenant de l’élan, en tapant de toutes ses forces.
La suite de l’histoire nous est racontée par ce pédopsychiatre, qui vient de publier un ouvrage sur les jeunes hyper-violents. Quand on dit au lyncheur : « Voyez, votre victime va finir ses jours ainsi, elle ne peut plus travailler, elle ne peut plus lire, elle ne peut plus marcher ni s’habiller sans aide », la réponse est : « Rien à foutre. » Quand on lui dit : « Vous l’avez tué, pensez à la douleur de ses proches. », l’assassin répond : « De toute façon il serait mort un jour. » Ces réponses sont invariables. Le lyncheur est incapable d’empathie puisqu’il est un psychopathe. Mais nos systèmes pénaux sont eux aussi psychopathes. Leur prétendue attention au délinquant, leur souci de le « réinsérer », n’est qu’une formulation « noble » de leur psychopathie et les quelques semaines de prison que feront les lyncheurs mineurs ou déclarés tels, c’est le « rien à foutre » de l’institution.
30 janvier. — À propos d’une gamine qui est menacée de mort par les émeutiers en ligne pour avoir dit ce qu’elle pensait de la religion-qui-ne-commet-pas-d’attentats, ce mot de la garde des Sceaux : « L’insulte à la religion, c’est évidemment une atteinte à la liberté de conscience ». Or « l’insulte à la religion » n’existe pas en droit français. Si cette dame, qui est professeur de droit public, prononce des énormités juridiques, c’est qu’elle est suspendue entre deux mondes, et en particulier entre deux systèmes légaux, celui des autochtones et celui des nouveaux venus, et que le leur est de plus en plus le nôtre, que le travail d’imprégnation assuré de concert par les barbus et par les médias nous fait passer insensiblement d’un ordre à l’autre.
2 février. — Festival d’Angoulême, hobnobbing with the upper crust.
3 février. — Résultat de la scintigraphie de janvier. Pas d’évolution.
« L’immédiateté est inhérente aux médias », déclare ce directeur d’une chaîne de télévision, sans noter la contradiction lexicale (mais j’usais d’une formulation très semblable dans l’entrée du 12 décembre 2018). Les (im)médias seraient en somme un simple conducteur optique : ce que recevrait le spectateur, ce serait l’événement lui-même, transporté sur son écran ; ce qui justifierait ce nouvel esclavage des « informations » suivies en continu par toute la population, dont le résultat le plus clair est que les current affairs occupent désormais la totalité de la vie intellectuelle.
Je me suis désabonné de la petite feuille libérale que je lisais depuis trois mois. Je renonce à lire un quotidien, ayant fait le tour de ceux qui me semblaient à peu près possibles, et les ayant recalés successivement.
8 février. — Un peu lu la presse dans l’affaire de la lycéenne menacée. Tous les commentaires portent sur les propos « blasphématoires » de la lycéenne, le commentateur pouvant noter, le cas échéant, que cette dernière « a droit au blasphème ». L’islamisation du pays semble donc achevée, puisque « la religion », en France, c’est la religion musulmane, et que tenir des propos critiques sur l’islam, c’est « blasphémer ». Cette islamisation a été obtenue par la violence, violence considérée elle aussi comme étant dans l’ordre des choses, à telle enseigne que les menaces de mort et les menaces des tortures les plus épouvantables visant la lycéenne ne suscitent chez les commentateurs aucune réaction. Quant aux élèves du lycée de la jeune victime, à en croire les reportages des hebdomadaires, ils se comportent comme s’ils étaient scolarisés au Pakistan plutôt que dans l’Isère. Cette jeune fille a insulté l’islam, donc on ne peut plus rien pour elle, et d’ailleurs elle savait à quoi elle s’exposait. Tout est parfaitement régulier, puisqu’on avait prévenu.
Nos sophistes ont imaginé la ressource de se présenter non simplement comme de vigilants gardiens de la morale (cela, c’est le pharisaïsme, qui est vieux comme le monde), mais comme des redresseurs de torts. Face à Némésis, il n’y a pas d’échappatoire. Celui qui est signalé à la vindicte du justicier peut seulement s’écrier, comme dans un roman populaire : « Malédiction ! Démasqué ! »
10 février. — Je suis bronchiteux, bronchite probablement attrapée à Angoulême. De surcroît, j’ai à peine dormi cette nuit, à cause de la tempête. Passé le plus clair de la journée au lit.
11 février. — Toujours alité. Débat télévisé entre la secrétaire à l’égalité des sexes et un fameux polémiste. Cette dame est capable de dire que le terroriste de Christchurch portait sur lui le manifeste Le Grand Remplacement, écrit par Renaud Camus, qui dans son esprit est donc une sorte de Mein Kampf des suprémacistes blancs que ceux-ci portent en permanence sous le bras comme un pasteur méthodiste porte sa bible. (En réalité Brenton Tarrant a posté en ligne un « manifeste » titré The Great Replacement, mais où ni Camus ni son livre ne sont évoqués.) Capable aussi de dire que Renaud Camus prétendait ne pas pouvoir définir lui-même le Grand Remplacement. (Camus a toujours parfaitement défini le Grand Remplacement ; il réfute les statistiques et toutes espèces de « preuves » scientifiques introduites dans le débat, ne voulant se fier qu’à l’évidence des yeux.) Il me frappe que cette femme politique issue du monde associatif, qui en tant que militante professionnelle est un pur produit de la culture médiatique, a en réalité sur les « polémiques » médiatiques qui constituent l’intégralité de son univers mental les idées les plus approximatives. Mais les factoïdes médiatiques ne sont vraisemblablement à ses yeux que des projectiles commodes dans la dispute. Il ne s’agit pas d’avoir raison, mais d’avoir raison de son adversaire, de lui clouer le bec.
12 février. — Toujours alité. Renaud Camus porte plainte contre la secrétaire d’État qui racontait l’autre jour que le terroriste de Christchurch portait sur lui le livre de Camus intitulé Le Grand Remplacement.
Je comprends mieux la vitupération socratique (Phèdre 278c) des poètes, des orateurs et des législateurs, dénoncés comme des producteurs d’écrits qu’ils seraient incapables de défendre au cours d’un examen sérieux. Notre décadente époque – comme sans doute, toutes les décadentes époques – est caractérisée par la présence de ces textes morts, figés, doxiques, dont les producteurs appartiennent aux milieux de la culture, de la politique et de la justice, et qui sont donc en effet l’équivalent pour notre temps des poètes, des orateurs et des législateurs.
15 février. — J’émerge malaisément d’une semaine de bronchite qui m’a cloué au lit.
19 février. — Discours du président sur le « séparatisme » et sur la façon de lutter contre le « séparatisme », plus intéressant peut-être par les réactions qu’ils suscite qu’en lui-même. Le président du parlement turc réagit dans son français exécrable : « Les explications de M. Macron, président de la République française (...) annonçant qu’il va lutter contre le séparatisme islamiste est signe d’une islamophobie primitive. » L’« islamophobie primitive », c’est le fait de s’opposer en France à la sécession des Turcs, qui votent pour Erdogan et qui suivent religieusement ses consignes de ne pas s’intégrer.
Les vérités embarrassantes sont imprimées désormais dans tous les journaux, même les journaux bien-pensants. « Islamiste » et « antiraciste » sont devenus à peu près synonymes. Plus curieux encore : ces vérités sont admises par les islamistes eux-même, qui expliquent tout naturellement qu’on est « islamophobe » quand on s’oppose à leurs desseins de conquête.
21 février. — Serse de Haendel au Badisches Staatstheater, mise en scène de Max Emanuel Cencic, version Grease, avec clins d’œil à la culture gay, de Liberace à Tom of Finland. On épate le bourgeois (il y a même eu quelques sifflets). Cependant on ne joue pas impunément sur certains ressorts obscurs de l’âme humaine. J’ai rêvé cette nuit d’une sombre histoire de voyeurs, qui disposaient de trous dans une palissade pour couler un regard concupiscent sur des ébats homo-érotiques. Les voyeurs, c’étaient nous, les spectateurs de l’opéra. Le trou dans la palissade, c’étaient les petites jumelles de théâtre à l’aide desquelles je déchiffrais les sur-titres.
22 février. — Superbe exposition Hans Baldung Grien à la Kunsthalle de Karlsruhe. J’ai été particulièrement intéressé par les images de sorcellerie, qui me paraissent très proches du Marteau des sorcières. En particulier, l’association entre le pot d’onguent et le vol nocturne vers le sabbat est figurée par des moyens purement graphiques et il semble que l’artiste ait beaucoup fantasmé sur ce thème.
Le soir, Tolomeo Re di Egitto de Haendel, au Staatstheater, mise en scène de Benjamin Lazar, dépouillée et tout à l’opposé de celle de Serse, vu hier, les chanteurs errant en somnambules dans cet opéra où les amants ne se reconnaissent pas.
À l’entracte, on mange des bretzels en buvant du champagne ou du vin blanc. Mais les prévoyants commandent à l’avance tout un repas, qu’ils trouvent servi en quittant leurs sièges.

Photo © Marion Sardine
23 février. — Repensé à la démonstration de Karl Schmitt dans Der Begrif des Politischen sur la centralité, à chaque époque, d’un domaine de l’esprit, et sur le rêve d’une « neutralisation » du politique par le recours à ce domaine, avec la conséquence que le prétendu « domaine neutre » devient lui-même le nouveau théâtre d’affrontement. Ce domaine d’esprit central, selon Schmitt, est théologique au XVIe siècle, métaphysique au XVIIe, humanitaire-moral au XVIIIe (nous n’en sommes jamais tout à fait sortis), économique au XIXe, technologique au XXe. Et au XXIe siècle ? Comment continuer la série ? La réponse, que j’ai longtemps cherchée, crève les yeux : c’est la sociologie qui est le domaine central, c’est par elle que se fait la prétendue neutralisation du politique et c’est elle qui devient le nouveau terrain d’affrontement, c’est-à-dire le lieu même du politique.
Illustration frappante de cette dépolitisation via la sociologie : la rapide transformation civilisationnelle de l’Europe est décrite dans les termes anodins d’une modification de la démographie (« c’est vrai qu’il y a un changement de population »), le substrat démographique étant une variable neutre du point de vue de la sociologie.
L'ordre sociologique s’arroge la prééminence sur l’ordre juridique. Il est banal d’observer que les cours suprêmes, Cour de cassation, Conseil d'État, Conseil constitutionnel, Cour de justice de l'Union Européenne, Cour européenne des droits de l'homme, pratiquent un interventionnisme social dans le contexte d'une sociologie militante. Le droit s'efface alors devant des normes vagues, voire déclaratoires, invoquées de façon opportuniste. Le principe de « fraternité », tiré – cela ne s’invente pas – de la devise de la République, permet au Conseil constitutionnel de dépénaliser l’aide au séjour illégal. Quant à la Cour européenne des droits de l’homme, sa vocation est d’interpréter « à la lumière des conditions de vie actuelles » une Convention qui ne contient qu’une vingtaine d’articles vaguement formulés. On ne saurait mieux proclamer le biais sociologique, puisqu’il s’agit d’accompagner des évolutions sociales considérées comme auto-validatrices. Il faut consulter à ce sujet l’éclairant rapport de Gregor Puppinck du think tank European Center for Law and Justice, sur la collusion des ONG financées par George Soros avec la Cour, dont les juges sont eux-mêmes d’anciens militants professionnels.
Pour finir, le nouvel ordre sociologique amène la dispersion de l’État. C'est encore une banalité de noter l’effacement du régalien, l’État se cantonnant à des fonctions d’assistanat social. Mais il est tout aussi révélateur de constater que ce qui fonde la nation, ce n’est plus l’histoire, la culture, la langue, ni même le contrat social, mais « nos valeurs », alors même que personne n’a la moindre idée de ce que sont « nos valeurs ». Or parler, comme de normes fondatrices, des « valeurs » d’une communauté, c’est faire de la sociologie.
Cette dissolution du corps politique dans le bain d’acide de la sociologie est censée assurer une paix perpétuelle. C’est ce qui amène le président Hollande à déclarer : « le nationalisme, c’est la guerre », le président Macron à dénoncer « la lèpre nationaliste ». Cette doctrine provient en droite ligne de la polémique marxiste, tout « nationaliste » étant un fasciste déguisé. Cependant les régimes marxistes étaient précisément ultra-nationalistes. Il a donc fallu la doctrine sociologique pour qu’un pays s’applique à lui-même la condamnation de son propre nationalisme.
La solution est radicale. Plus de nations, plus de frontières (donc plus d’États), cela signifie : plus de guerres. En termes schmittiens : plus de possibilité de répartir des groupes humains selon la distinction ami/ennemi. De fait, le comble de la dépolitisation par la sociologie apparaît sur le plan extérieur. Le mouvement vers l’Europe de « migrants » – mouvement préparé et organisé – est réinterprété comme une crise « humanitaire », à laquelle nous devons faire face précisément au titre d’un assistanat social étendu pour l’occasion à la planète entière.
La difficulté est que les groupes humains en conflit se définissent à présent précisément selon des critères sociologiques : ethnie, religion, etc. Ainsi le terrain prétendument pacifié se révèle comme le nouveau terrain d’affrontement. La nouvelle doxa ethno-victimaire (identity politics) est précisément celle de groupes sociaux en guerre les uns contre les autres. En France, où l’on est dogmatique, cette conflictualité est assumée, et interprétée selon la dichotomie oppresseur/opprimé, de sorte que la neutralisation du politique n’a jamais été qu’une apparence ou qu’une ruse, le sociologisme prenant, ici encore, la suite du marxisme (mêmes acteurs, mêmes objectifs). On peut relever à cet égard l’étonnante compacité du discours médiatique, où internationalisme (marxiste), mondialisme (libéral), et sans-frontiérisme (ethno-victimaire) sont confondus, et sacralisés au nom de « nos valeurs ».
Pareil ordre repose sur l’imposture et le boniment. Mais précisément, la propagande n’est plus perçue négativement car l’objectif est d’assurer à n’importe quel prix le consensus social. C’est ce qui explique la fausseté et l’hypocrisie assumées du discours « antiraciste » : n’importe quel mensonge est justifié s’il favorise la cohabitation de populations qui n’ont rien en commun (« vivre ensemble »). La violence politique portée par l’islam est ramenée au fait divers, donc au micro-événement sociologique. Ou bien elle reçoit une interprétation psychiatrique, et est référée dès lors au chapitre des causes sociales des troubles mentaux. (« Les terroristes passent à l’acte parce qu’ils traversent un moment de désespoir. »)
9 mars. — J’ai lu au Mexique The Plumed Serpent de D. H. Lawrence, a silly story où un Mexicain, Don Ramón, recrée le culte de Quetzalcóatl et de Huitzilopochtli pour « réveiller » son pays. Si l’on discerne aisément des tendances romantiques, voire des tendances fascistes, dans la fascination du romancier pour une révolution agitant les forces instinctives d’un peuple, si l’on reconnaît sans surprise l’intérêt du romancier pour le sexe (« How wonderful sex can be, when men keep it powerful and sacred, and it fills the world ! »), la meilleure description du roman passe par le vocabulaire de Voegelin : les Mexicains indigènes et métis n’ont que partiellement différencié l’âme, en dépit de la christianisation, et ils cherchent à retrouver l’expérience fondamentale de la participation à la communauté d’êtres (y compris animaux et plantes), et rêvent d’un retour à la compacité d’un empire cosmologique – d’où justement le symbolisme qui mêle tout, Quetzalcoatl, le ciel, la terre, la planète Vénus, etc. Un tel retour est évidemment impossible (en fiction comme dans la vie réelle) et le résultat est la présentation frauduleuse par le romancier de la conscience de Don Ramón comme le Logos divin. C’est précisément ce qui rend le roman idiot.
10 mars. — Pandémie de coronavirus. Les frontières se ferment une à une. Une planète à l’arrêt. Je n’arrive pas à croire que, il y a seulement quatre jours, j’étais à l’autre bout du monde, ayant pris un avion à peu près comme on prend un autobus.
À la pharmacie, on a tracé des zébras au sol pour que les patients se tiennent à distance des pharmaciennes. Au moment où je rentre, tous les clients sans exception piétinent ces zébras.
12 mars. — Les consignes officielles sont à présent le confinement. Les écoles seront fermées lundi (nous sommes à jeudi). Mais de façon incompréhensible, les élections municipales de dimanche sont maintenues.
13 mars. — In the Land of Zu. Pression intraoculaire droite : 16, gauche : 15.
14 mars. — Le Premier ministre annonce que les restaurants, les cafés et les commerces non essentiels ferment dès ce soir.
15 mars. — Images de la foule parisienne profitant du printemps. Les Français ne respectent aucune consigne, peut-être parce que le maintien des élections les a convaincus que « ce n’était pas si grave ».
16 mars. — Ce titre incroyable lu sur la Toile : « L’État islamique déconseille à ses jihadistes de se rendre en Europe à cause du coronavirus. » (Le Journal de Montréal.)
Ce soir, le Président annonce un confinement général.
17 mars. — Beaucoup de monde au supermarché, vingt minutes d’attente en caisse, mais peu de produits en rupture. J’ai eu l’impression en observant le contenu des chariots que beaucoup de gens avaient fait des stocks hier lundi, en prévision du confinement, et qu’ils venaient pour compléter ces stocks.
18 mars. — La promenade avec Manu est remplacée par une vidéoconférence. Je fais une course quotidienne dans les champs, en portant sur moi ma carte d’identité plus un exemplaire de l’« attestation de sortie dérogatoire » qu’il faut s’établir à soi-même à chaque fois qu’on sort. La difficulté est que, selon les termes de cette attestation, on est censé prendre son exercice « à proximité du domicile ». Mais que signifie « à proximité » ? Je cours ordinairement une heure ou une heure et demi, en m’éloignant de sept ou huit kilomètres de mon domicile. Aujourd’hui, je n’ai pas osé, et j’ai tracé un large cercle autour du village.
J’achève Five Families : Mexican Case Studies in the Culture of Poverty (1959), d’Oscar Lewis, extraordinaire ouvrage d’ethnographie appliquée aux slums (plus à une famille de « nouveaux riches »).
19 mars. — Ce qui était inimaginable la veille encore, le lendemain devient une banalité. Ce matin, un médecin déclare à propos des vieillards des maisons de retraites : « On assiste à des taux de 75 % de résidents atteints par le virus et des taux mortalité catastrophiques, au-delà de 20 à 30 %. Il n'y a pas de place pour eux à l'hôpital, ils sont trop vulnérables. »
Sur les conseils de Marion Sardine, appelé la gendarmerie pour vérifier que je pouvais courir dans les champs. Réponse positive. Mais ce soir la consigne ultra-rigoriste du ministère des sports est : footing réduit à un ou deux kilomètres.
France Culture a cessé d’émettre, « l’esprit d’ouverture » s’accommodant mal apparemment du confinement et du bouclage des frontières. Lorsqu’on se branche sur l’antenne, on entend France Inter ou des rediffusions. Essayé d’écouter une émission sur Jules Verne, dont l’invité est le très érudit François Angelier. Mais le journaliste se soucie seulement de faire dire à son invité en quoi Verne est contemporain (il défend le « vivre-ensemble », il est « écologiste », il « préfigure le gore », etc.). Il n’y a plus de littérature possible pour des gens dont l’univers mental se rétrécit historiquement à l’instant présent et géographiquement à leur personne, et pas plus de littérature « de genre » que de littérature générale. Un acteur lit un extrait de « Edgar Poe et ses œuvres » de Jules Verne. L’acteur ne sait pas prononcer le nom d’Ann Radcliffe (« Ann Radclaïffe »). J’imagine un adolescent d’aujourd’hui, qui découvrirait France Culture et écouterait la station pour s’ouvrir l’esprit, comme j’ai pu le faire moi-même il y a quarante-cinq ans, quand j’étais adolescent. Il apprendrait qu’on juge un auteur du passé à son degré de conformité avec nos préjugés, et qu’on prononce Ann Radclaïffe.
Shakspere. Troilus and Cressida, version de la BBC (1981), curieuse pièce où tout est faux, l’amour, l’héroïsme, l’honneur, et dont la tonalité semble donnée par la parole systématiquement ordurière du clown Thersites.
20 mars. — Réflexions pour un temps de confinement. Réseaux sociaux (ces adolescents confinés qui passent la journée entière étendus sur leur lit, à pianoter sur leur petit téléphone). Instruments de torture pour l’âme. Sur la Toile, l’Encyclopédie des crétins annonce triomphalement qu’elle continuera à assurer sa mission planétaire de décervelage.
La porte-parole du gouvernement, sur une chaîne d’informations en continu : « Attention, je veux pas qu’on commence à dire que c’est passque c’est des banlieues avec des populations de telles ou telles origines que les gens ne respectent pas les règles. » La réalité des quartiers peuplés par the lawless Alarbes est décrite dans Le Temps de Genève, par Richard Werly, en reportage à Saint-Denis : « Les mesures barrières sont ignorées par la population. Contrôler ? “Impossible. Nous n’en avons pas les moyens.” [C’est un policier qui parle.] “Verbaliser et infliger les fameuses amendes à 135 euros ? Silence gêné et regards qui en disent long. “Ce n’est pas jouable, reconnaît l’un des policiers. Si une dispute commence, on ne pourra pas gérer, et le risque de contamination deviendra encore plus grand.” Un tramway arrive. Le port du masque est assez généralisé. À l’évidence du matériel chirurgical. La vérité : les points de vente clandestins de masques dérobés dans les hôpitaux existent. Certaines épiceries en vendent sous le manteau. »
21 mars. — Je n’arrive pas à croire au peu de contenu des médias qui « couvrent » la crise sanitaire vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Le confinement durera plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois. Nous n’avons pas de masques, et le gouvernement a prétendu que le masque ne servait à rien, pour éviter la ruée de la population sur les stocks, au détriment des soignants. Le manque de lits en réanimation est flagrant, et découle directement de choix désastreux en matière de politique de santé. Voilà ce que nous tenons d’à peu près assuré. Tout le reste consiste en spéculations, en accusations, en imputations plus ou moins calomnieuses. Et l’on passe des heures à s’abreuver de ces inepties, par inquiétude, par désir de savoir. Les pires des instruments de torture pour l’âme, dont je parlais hier, ce sont les médias.
Vu avec un vif plaisir Titus Andronicus, la plus sanguinolente des pièces de Shake-Scene, spécimen de ce théâtre de la cruauté né apparemment des guerres de religion. Il est indéniable qu’un personnage comme Aaron le Maure rend un son très moderne, lui dont l’unique regret est de ne pas avoir accompli de plus nombreux et de plus monstrueux forfaits.
23 mars. — Cette crise qui nous oblige à rester calfeutrés, c’est la crise faite sur mesure pour notre époque. Tout ce qui arrive arrive sur nos écrans, puisque les écrans sont l’endroit où nous résidons socialement. Inversion de tout : la solidarité consiste à se barricader ; l’isolement devient l’acte social par excellence (« tous ensemble chacun chez soi »). Le paralogisme devient le mode de raisonnement normal (exemple : la décision de ne pas fermer les frontières devient sa propre justification, puisqu’on conclut que « le virus ne connaît pas les frontières »). Les mots perdent leur sens (« Coronavirus : France Culture se mobilise » est la façon qu’a trouvé la chaîne d’annoncer l’arrêt des programmes).
L’impression générale d’ineptie s’augmente beaucoup des ratés du discours officiel. C’est la ministre des sports qui expliquait l’autre jour que la course légère doit se limiter à un kilomètre ou deux, n’ayant à l’évidence aucune idée de ce qu’est une distance d’un kilomètre, ni du temps qu’un coureur met pour parcourir un kilomètre. Finalement, le Conseil d’État ayant exigé des précisions, le Premier ministre corrige ce soir : course d’une heure maximum, dans un rayon d’un kilomètre autour de son domicile. (C’est certainement ce rayon d’un kilomètre qui est devenu une course d’un kilomètre). Ou bien c’est la porte-parole du gouvernement qui, cherchant à démontrer qu’il ne sert à rien de mettre un masque, précise qu’elle-même ne saurait pas mettre un masque sans se contaminer, comme si un tel geste présentait la moindre difficulté. Ainsi les plus imbéciles brodent autour des consignes ou des éléments de langage. Comme le confinement est aussi celui des cerveaux, ces absurdités mettent les caractériels et les mabouls au suprême degré de l’exaltation et les font se répandre sur la Toile en accusation furibondes. Et ces ratés de la communication nourrissent l’extrême défiance vis-à-vis du pouvoir, dans une population dont on découvre avec un peu d’effarement qu’elle considère désormais qu’un gouvernement, quel qu’il soit, est incapable de faire face à une crise, quelle qu’elle soit.
24 mars. — Quarante minutes d’attente aux caisses ce matin. Et des noms d’oiseaux qui volent. Irritabilité générale après une semaine d’oisiveté forcée. Qu’en sera-t-il dans quatre semaines, dans six semaines ?
J’ai fait cette fois des achats mieux conçus et j’espère tenir dix jours, car cette visite au supermarché présente un véritable danger, les clients ne respectant aucune consigne, se marchant dessus, postillonnant à l’envi, touchant à tout, etc. J’essaie de me décontaminer, sitôt rentré chez moi, en retirant tous mes vêtements et en prenant une douche. J’étais décontaminateur, pendant mon armée. On se préparait alors à une guerre nucléaire, bactériologique et chimique avec l’URSS. Plus tard, je m’étais fait la réflexion qu’on m’avait préparé à une guerre qui, grâce à Dieu, n’aurait jamais lieu. Seulement, pour ce qui est des catastrophes, il ne faut jamais dire jamais.
26 mars. — Sur le site académique conservateur Quillette, je retrouve une idée qui m’était venue à l’esprit immédiatement : le monde du confinement – et le monde qui sortira de la crise –, c’est celui du roman de science-fiction d’Isaac Asimov, The Naked Sun (Astounding Science Fiction, 1956). Les gens vivent seuls dans de vastes propriétés, servis par des robots, ayant acquis une véritable phobie de la présence physique, et se rendent visite les uns aux autres au moyen d’hologrammes.
Relevé dans l’Encyclopédie des crétins. À propos d’un prétendu « test » qui sert à convaincre les réalisateurs de films de « racisme » sous prétexte que, dans leurs films, ils ne font pas assez de place aux « minorités » : « Ce test n'a pas de critères précis, ce qui lui permet d'analyser plus finement les représentations. »
27 mars. — Après la volte-face du gouvernement – sur l’utilité des masques, sur l’opportunité de la fermeture des frontières –, on se surprend à espérer que les autorités apprennent de la crise que le mensonge est politiquement ruineux. Seulement il faudrait pour cela sortir de cette situation absurde où les médias mentent « pour la bonne cause » et où ceux qui dénoncent ces mensonges ne le font nullement pour rétablir la vérité, mais pour nous égarer dans des mensonges encore plus effrontés.
29 mars. — Lu Nightmare of Extasy, la biographie « orale » d’Ed Wood, qui a inspiré à l’écran l’excellent film de Tim Burton. Mais le livre m’évoque davantage l’étude de cas d’Oscar Lewis sur les slums mexicains que la contre-culture. Le problème d’Ed Wood n’est pas son goût pour les pulls angora et les talons hauts, mais son alcoolisme et sa dèche. Ed Wood ne sait pas comment on s’y prend pour être alcoolique. L’alcoolique de métier, une fois qu’il a atteint le degré d’alcoolémie requis, s’y maintient en sirotant les quantités nécessaires. Ed Wood ne sait boire que cul sec, à la cosaque, et se plonge dans des états indescriptibles. Même inadaptation en ce qui concerne la production cinématographique. Ed Wood se retrouve à devoir tourner des films en quelques heures, faute de budget, films qui le ruinent si d’aventure ils sont bénéficiaires (il a souscrit pour plus de 100 % des parts, et il doit donc plus de 100 % des recettes).
J’ai à nouveau une belette, ou une fouine, ou une martre dans le grenier, qui conchie et compisse ma façade. Impossible de m’en débarrasser.
30 mars. — Le dictateur d’Angora évacue les « migrants » qu’il avait, il y a un mois, équipés, armés et massés à la frontière grecque, en Thrace. Ces gens sont repartis comme ils sont venus, dans des bus affrétés par l’imperator turcorum. Non seulement la tentative d’extorsion à l’endroit de l’Union européenne – donnez-moi des milliards ou je vous inonde de « migrants » – a échoué grâce à la vigilance des garde-frontières grecs et européens, et à la résistance spontanée de la population, mais les « migrants » amassés dans des camps insalubres constituent un redoutable cluster épidémique, que le tyran frériste a imprudemment libéré sur son propre pays.
31 mars. — On vide les prisons à cause de l’épidémie. Pas question en théorie d’élargir les terroristes, ni les criminels dangereux. Pourtant le régime a élargi deux des terroristes de l’attentat de Noël 2018 à Strasbourg, deux gitans sédentarisés qui avaient fourni son arme au tueur.
Shake-Rag. Revu Pericles Prince of Tyre. En français, Périclès, prince de Pneu. Ce n’est pas une pièce exactement, mais l’adaptation d’un roman grec, dans la version d’un contemporain de Chaucer, John Gower, qui apparaît sur scène comme récitant et justifie pour le public le fait que l’action progresse par bonds.
1er avril. — Les commentateurs relèvent que le président fait désormais l’éloge des frontières, qu’il défend la réindustrialisation, bref qu’il fait tout le contraire de ce pour quoi les pouvoirs en place l’ont fait élire. Les plus cyniques s’en amusent, les plus droitiers s’en réjouissent. Mais ces réactions témoignent elles-mêmes de l’absence de vision des éditorialistes, car elle est nécessairement vouée à l’échec, la réforme entreprise par un dirigeant pragmatique qui recrute ses ministres parmi ceux-là mêmes dont la confusion idéologique a jeté à bas les structures de l’ordre.
3 avril. — Refait mes provisions, après dix jours, comme prévu. Maigre fréquentation du supermarché, nombreux rayons vides, y compris pour les produits de base, farine, œufs. Le poisson n’est plus qu’un lointain souvenir.
« Les chiffres battent en brèche le fantasme de la fachosphère qui prétend que l’État s’accommoderait de zones de non-droit. » Et le journaliste cite une source policière : « À Beauvais, une adjointe de sécurité a été grièvement blessée. Preuve qu’on agit ! » – La preuve qu’il n’y a pas de zones de non-droit, c’est que la racaille a défoncé le crâne d’une malheureuse policière dans un guet-apens.
4 avril. — À présent que tout s’éboule du fait de la catastrophe épidémique, le sans-frontiérisme devient transparent à l’ordre politique, comme dirait Voegelin. Il apparaît comme un sous-produit idéologique de la mondialisation, commercialisé par la petite-bourgeoisie cervicale – on ne peut décemment la qualifier d’intellectuelle. Le sans-frontiérisme est la traduction paradoxale, dans des termes humanitaristes et sentimentalistes, d’une doctrine, la mondialisation, qui pousse le cynisme à ses conséquences extrêmes. Du reste, on l’a toujours su, puisque, au cours des trois dernières décennies, à chaque fois que l’on vantait les bénéfices économiques de la circulation sans restriction des biens, des services et des capitaux, les petits-bourgeois cervicaux s’indignaient que ce même principe de libre circulation ne comportât pas le droit pour tout individu de franchir librement les frontières et de s’installer où il voulait. Les États de départ, États faillis et État voyous, ont rapidement compris l’intérêt de cette singulière doctrine, puisque les flux à sens unique leur permettaient de se débarrasser de leurs éléments indésirables (pauvres, chômeurs, criminels, etc.). Et naturellement l’islamisme a traduit la migration dans les termes d’une conquête.
Comme la condition de la liberté absolue de circulation et d’établissement est la mort des États (puisque les États décident souverainement qui ils accueillent et qui ils refoulent), le sans-frontiérisme rejoignait la mondialisation dans l’idéal de la privatisation du monde, d’une planète où l’on aurait subverti l’idée même de bien commun, où l’on aurait définitivement aboli le droit – tout en s’en réclamant sans cesse.
5 avril. — Attaque d’un égorgeur soudanais, en plein confinement. Le tueur islamiste est allé chercher ses victimes à l’intérieur des commerces. Autre nouveauté : si l’exécutif parle vaguement d’une « attaque » ou d’un « drame », le parquet national anti-terroriste s’est saisi sans respecter le délai diplomatique. Il semble donc que les autorités aient renoncé à mentir, vraisemblablement parce qu’on ne ment pas à des confinés, de peur qu’ils ne règlent les comptes une fois déconfinés. Du coup, la presse, prise de cours, introduit la catégorie paradoxale du « réfugié terroriste ».
6 avril. — Je découvre dans le National Post de Toronto, consulté sur la Toile, que les officiels Canadiens ont raconté à leur population les mêmes imbécillités exactement que leurs homologues français sur l’inutilité, voire la dangerosité, de porter des masques, avant de faire volte-face. Cependant l’administratrice en chef de l’agence de santé publique canadienne s’est montrée plus honnête que ses pairs français, car elle a listé parmi les raisons de déconseiller le port généralisé du masque le risque de pénurie pour les soignants.
Identité aussi sur la question des frontières et de la « libre circulation ». La même administratrice canadienne expliquait en janvier qu’on ne pouvait pas mettre en quarantaine des voyageurs venant des zones contaminées par le coronavirus car on aurait « stigmatisé » certaines communautés (cette administratrice est elle-même asiatique). Mise au pied du mur, elle excipait, en cas d’initiative canadienne prématurée sur le contrôle des frontières, du risque de se faire gronder par l’Organisation mondiale de la santé.
Les populistes simplifient à outrance en dénonçant le choix de ne pas fermer les frontières comme dicté par le dogmatisme, comme si les dirigeants déclaraient avec emphase : « Je refuse de fermer les frontières car c’est contraire à toutes mes valeurs. » Le sans-frontiérisme est inscrit dans les traités, dans les usages, il résulte de jeux de pouvoir complexes (les médias de désinformation ne manqueront pas de qualifier de « fasciste » le dirigeant qui le premier fermera ses frontières).
8 avril. — Le confinement semble efficace (et les gouvernements qui n’ont pas confiné, ou pas assez vite, s’en mordent les doigts). On en est à 100 000 morts comptabilisés pour la planète entière. Même si le chiffre réel est quatre ou cinq fois plus important, on est loin des ravages des grandes pandémies. La vie électronique se maintient, et se maintiendra aussi longtemps que les réseaux fonctionneront. Elle permet le télétravail, les relations avec les proches et avec la communauté (les chrétiens s’apprêtent à vivre la Semaine Sainte entièrement par messes internétiques). Cependant ce qui est gagné en efficacité est perdu en chicaneries. Contester la stratégie de confinement semble l’attitude par défaut, comme si le civisme avait disparu, ou comme si, pour une cervelle moderne, une épidémie dévastatrice était inconcevable. Contestation en actes dans la racaille, qui met un point d’honneur à violer toutes les consignes. Contestation intellectuelle dans les classes supérieures. Un éditorialiste parle très justement d’une « connerie malveillante chez les instruits ». Une partie non négligeable des confinés consacre apparemment ses loisirs forcés à écrire un pamphlet contre le gouvernement. Aux États-Unis, une élue démocrate de l’Ohio veut faire comparaître le président Trump devant la Cour pénale internationale de La Haye pour « crime contre l’humanité » parce qu’il a fait l’éloge de la chloroquine comme remède contre le virus. En France, tout à l’inverse, c’est le scepticisme du Haut Conseil de la santé publique sur l’efficacité de ce médicament qui amène les plus excités à à réclamer un procès contre les médecins et les politiques. Lesdits politiques cherchent paraît-il à se protéger, soit en réduisant leurs traces écrites, soit à l’inverse en constituant des dossiers ad hoc.
9 avril. — On trouve à nouveau du poisson. Moi dont la source exclusive de protéines depuis trois semaines était le blanc d’œufs, je me suis confectionné, en allant aux limites de mes talents culinaires, un saumon en croûte. Quant à la nourriture intellectuelle, elle se fait par les classiques, tous les classiques, Le Roman de la rose ou Platon, comme si, là aussi, on portait son choix sur les aliments qui ont la meilleure valeur nutritive.
À dix-neuf heures hier soir, appel à la prière diffusé par haut-parleur dans un patelin à forte population turque, à trente kilomètres au nord de Strasbourg. Il est difficile de se figurer l’effet produit sur la population. Les gens sont consignés chez eux et l’appel du muezzin retentit dans les rues vides.
Renseignement pris, c’est loin d’être un incident isolé. Explications des responsables religieux. Ce serait une façon de servir la communauté, au moment où les mosquées sont fermées. Cela a contraint le ministre de l’Intérieur, un peu gêné aux entournures, à un rappel à la loi : « Les appels à la prière n’appartiennent ni à nos usages, ni à notre tradition. À cet égard, les restrictions aux libertés, notamment de culte, ne sauraient en aucun cas justifier que l’on s’écarte de ces traditions. » Mais le président du Conseil français du culte musulman dénonce les dénonciations et parle d’« une campagne politico-politicienne aussi absurde qu’incompréhensible contre les musulmans de France ». Je peux recopier ici mot à mot ce que je notais il y a un an : « On a inventé un style ad hoc, qui est un pastiche, presque une parodie, du style de l’expert. Il faut tenir pour acquises, et même feindre de tenir pour banales les inventions les plus ébouriffantes. Il faut se déclarer “surpris”, il faut trouver “très inquiétant” que l’opposition trouve encore à s’exprimer, comme si elle était, elle, constituée de factieux violents. »
10 avril. — A writer is naturally self-isolating, and since I slipped into invalidism I have been living almost as a recluse. N’empêche que le confinement déclenche chez moi des rêves sociaux. Des touristes s’installent sur mon pré. Ou bien c’est une assemblée d’animaux. Ce qui manque, c’est de se frotter à une foule de gens qu’on ne connaît pas, de se mêler au troupeau humain.
Autres rêves, épidémiques ceux-là. Le salut, cette nuit, consistait à rejoindre à la nage une certaine île, mais à la condition préalable que j’arrive à me procurer un revolver ; je ne sais pas à quoi il était censé servir, peut-être à nourrir la métaphore guerrière (nous sommes « en guerre » contre le virus).
11 avril. — J’achève la lecture de The Wyvern Mystery de Sheridan Le Fanu. Il s’agit d’un sensation novel, quoique l’auteur s’en défende dans la préface, dont la figure centrale est une femme diabolique, défigurée, à demi-folle, et aveugle. Curieusement le récit repart dans sa fin sur une affaire de substitution d’enfant, comme si l’auteur éprouvait le besoin de relancer l’intrigue.
Par association d’idées, cherché – et trouvé – sur la Toile l’excellente et très fidèle adaptation d’Uncle Silas, du même Le Fanu, réalisée en 1947 par Charles Frank pour Gainsborough Studios. Le langage du film d’art anglais mis au service du gothique. Le film vaut par les décors, les costumes, les éclairages, une caméra qui se comporte comme si nous étions nous-mêmes des fantômes nous glissant dans la demeure gothique de Bartram. Mais le film vaut surtout par le jeu des acteurs. Maud, qui dans le film est rebaptisée Caroline, est jouée par l’angélique Jean Simmons. Le père noble, interprété par Reginald Tate, est un benêt qui est taken in par Uncle Silas. Silas, le débauché prétendument réformé, joué par Derrick De Marney, est une sorte de Tartufe gothique, qui en même temps semble s’amuser prodigieusement de sa tromperie, en vieil enfant (il souffle sur la poussière de la vieille bible qu’il est censé lire tous les soirs, il trouve un portrait de sa « chère épouse » imaginaire en fouillant dans de vieilles gravures qui traînent sur une étagère et en découpant la légende de celle qui lui paraît convenir). Son fils, joué par Manning Whiley, est le type de la brute vicieuse dans sa version campagnarde. Mme de la Rougierre, jouée par Katina Paxinou, la préceptrice alcoolique de Caroline, est réellement monstrueuse, et provient en droite ligne des tricoteuses de la Révolution. Elle a quelque chose de la Madame Defarge jouée par Blanche Yurka, dans A Tale of Two Cities, 1935, de Jack Conway.
Uncle Silas a les défauts habituels des films britanniques. Le principal est la difficulté de la lecture filmique. Silas est tout le temps occupé à ses décoctions et à ses potations. Il est alité dans un état de stupeur quand il fait revenir Caroline de Londres – et l’arrache non seulement au bal de nouvel an, mais aussi à la protection de ses amis –, une maladie dont, le lendemain matin, il ne subsiste inexplicablement aucune trace. Cependant le fait que Silas soit opiomane est rendu incompréhensible, peut-être volontairement.
L’action rapide de la fin, avec luttes à mort successives de l’amoureux de Caroline contre le garde-chasse exécuteur de basses œuvres puis contre le fils débauché de Silas, est également difficile à lire, en partie parce qu’elle est filmée de nuit.
Curieusement, le film fait complètement l’impasse sur la secte des swedenborgiens, et ôte une couche de mystère et d’occulte au singulier récit de Le Fanu.
12 avril. — Timon of Athens de Shexpire, d’après un dialogue de Lucien. Timon peut apparaître comme un idéaliste et un modèle de civilité, cultivant le lien social et l’amitié, et qui est victime de son idéalisme ; ou tout à l’inverse comme un prodigue, dont la prodigalité attire infailliblement des parasites et des sycophantes, et qui va vers une ruine prévisible en dilapidant sa fortune en banquets et en cadeaux ; ou bien encore comme la figure pathétique d’un inadapté social qui cherche à toute force à se faire des amis – voire comme quelqu’un qui est figé dans l’état angélique de la petite enfance, et qui distribue tout ce qu’il possède à ses petits amis en supposant qu’ils agiront de même avec lui. Cependant, qu’on interprète Timon comme un idéaliste, comme un dissipé ou comme un inadapté, sa misanthropie, une fois que ses flatteurs se sont révélés comme des ingrats, apparaît comme l’autre face de son idiosyncrasie, et comme la vérité du personnage.
13 avril. — Lieux communs épidémiques. Croyances folles. La panacée (le paracétamol, la quinine, les huiles essentielles). Le charlatan fêté comme un docteur miracle. Les accusations contre la « médecine officielle ».
Bobards. La fraternité sacerdotale Saint-Pie-X aurait organisé dans la nuit de samedi à dimanche une messe clandestine à l’église Saint-Nicolas-du-Chardonnet. Renseignement pris, il s’agissait de la vigile pascale, qui se tient normalement de nuit. Elle n’était en aucune manière clandestine, puisqu’elle était diffusée sur internet. Cette messe n’était pas dite en public, et on vérifie aisément sur les images qu’il n’y avait pas de fidèles. Cependant le clergé était pléthorique (longue colonne de servants d’autel), et on n’a visiblement appliqué aucune consigne de sécurité : non-respect des distances, distribution manuelle de la communion – et dans la bouche par dessus le marché. Cela n’en fait toujours pas une messe clandestine.
Cette histoire m’a plongé dans un abîme de perplexité jusqu’à ce que je me rende compte que le journaliste qui est à l’origine du bobard est maghrébin. Il n’y a rien d’étonnant à ce qu’un musulman interprète une messe qui se tient la nuit comme une messe clandestine, d’abord parce que, par définition, il ignore tout de la liturgie pascale, ensuite parce que, chez lui, les chrétiens, qui sont persécutés, ont l’habitude de se réunir clandestinement. Il est beaucoup moins facile d’expliquer comment le bobard est devenu une dépêche d’agence, qui a été reprise ensuite par tous les médias.
15 avril. — Les médias débitent à présent les bobards de Pékin, après que les Chinois ont fait le choix orwellien de récrire l’histoire, effaçant les semaines cruciales qu’ils ont fait perdre par leur silence sur la situation sanitaire dans la province du Hubei, semaines pendant lesquelles l’épidémie s’est dispersé dans toute la Chine puis dans tout le monde. Pour persuader les journalistes de propager le récit absurde et contre-factuel d’une Chine qui aurait héroïquement fait rempart contre le virus, il aura suffi à Pékin de dire : « Ceux qui attaquent la Chine sont racistes. » Le PCC entretient à usage interne une rhétorique xénophobe dont la virulence laisse les observateurs interdits. Mais les dirigeants chinois savent que nous, Occidentaux, avons érigé l’« antiracisme » en norme suprême. Et le propre de cette norme, c’est que n’importe qui peut l’actionner contre nous.
16 avril. — Refait les courses. It feels odd to be driving.
Le souci de l’heure est le risque politique. Attaques quotidiennes d’énergumènes armés de couteaux. « Quartiers » en éruption. À la vérité, je ne suis pas certain que les attaques et les émeutes soient plus nombreuses qu’à l’ordinaire, mais comme en théorie tout le monde est confiné, cette obstination de l’élément criminel dans ses errements frappe les esprits. Tout cela est très peu couvert par les médias nationaux, il faut aller chercher dans la presse régionale, et, pour la première fois, on sent assez clairement une volonté de censurer – et non seulement de déguiser – les mauvaises nouvelles.
À l’extérieur, le tyran d’Angora achemine vers la côte les milliers de « migrants » qui avaient été refoulés en Thrace, en pensant que l’envahissement se fera plus facilement par la mer. La Grèce et l’agence Frontex se préparent contre l’assaut au moyen d’un blocus maritime. Et les deux risques, le risque épidémique et le risque politique, se conjuguent. Les « migrants » arsenalisés par Erdogan sont porteurs du coronavirus, les camps de fortune dans lesquels ils se sont entassés un mois durant, en Thrace, étant des boîtes de Petri, et c’est donc la contagion, et non seulement l’invasion, que le satrape ottoman promet à l’Europe.
17 avril. — Ce titre dans Le Venin : « Notre-Dame : un an après l’incendie, les thèses complotistes persistent. » Les « thèses complotistes », c’est le fait de ne pas souscrire à ce que l’institut qui vient de sonder les Français désigne lui-même comme la « version officielle », la thèse selon laquelle l’incendie est « probablement un accident ». Cet institut de sondage qualifie ceux qui font le constat élémentaire que les causes de l’incendie restent inconnues de « dubitationnistes » plutôt que de « conspirationnistes ». – Mais pour le journaliste du Venin, qui est en théorie un journal de droite, il faut adhérer à la « thèse officielle », sinon on est « complotiste ».
Je n’insiste pas sur la bizarrerie qu’il y a à titrer : « un an après, les thèses complotistes persistent » – comme si après un an de « thèse officielle » il n’y avait plus de place pour la simple vérité – qui est, encore une fois, qu’on ne sait pas – ; ni sur l’illogisme du journaliste, capable d’écrire : « En juin 2019, les enquêteurs ont affirmé avoir définitivement écarté la thèse de l’incendie volontaire » et dix lignes plus loin : « Un communiqué du parquet de Paris indiquait le 26 juin 2919 qu’“aucun élément ne permettait d’accréditer l’hypothèse d’une origine criminelle”. » « Aucun élément ne permet d’accréditer l’hypothèse d’une origine criminelle » et « on a définitivement écarté la thèse de l’incendie volontaire » sont donc logiquement équivalents pour le journaliste. L’absence de preuve devient la preuve de l’absence.
Si demain la confidence d’un mouchard, ou quelque analyse technique, fait retrouver la piste d’un incendiaire, le procureur indiquera qu’un élément nouveau est intervenu dans l’enquête, et nul ne pourra de bonne foi le taxer de duplicité. Mais la presse, elle, aura été surprise flagrante delicto dans un double mensonge, d’abord sur les faits et en second lieu sur l’interprétation des faits par le parquet, puisqu’elle aura imprimé que la thèse de l’incendie volontaire avait été « définitivement écartée ».
18 avril. — Tout le monde, dans les classes lettrées, tient un abondant journal de confinement. C’est une sorte de règle non écrite, peut-être parce qu’on est persuadé de vivre des événements historiques. On constitue de la sorte des Mémoires pour servir à l’histoire du confinement. Mais précisément, il n’y a rien à relater puisqu’on est enfermé chez soi, de sorte que l’unique sujet de ces journaux, à en juger par les extraits publiés en ligne, est la façon, bonne ou mauvaise, dont on vit l’enfermement et l’isolement – et l’enquête, au moyen de l’introspection, sur les raisons qui font qu’on les vit bien ou mal.
Lectures épidémiques. The Last Man (1826) de Mary Shelley. À la fin du XXIe siècle, les Grecs mettent le siège devant Constantinople et les Turcs abandonnent la ville et refluent en Asie, mais ils laissent derrière eux une peste qui tuera finalement l’humanité entière.
Le roman est un texte mixte. Il s’agit d’un roman à clé – Byron, Shelley, étant bien reconnaissables dans les personnages de Lord Raymond et d’Adrian –, roman né du deuil de Mary Shelley, qui a perdu mari (Shelley s’est noyé en mer) et enfants (morts en bas âge). Mais c’est aussi un roman gothique dont l’action se situe à la fois dans le passé (dans le récit-cadre) et dans le futur, à la fin du XXIe siècle. Littérairement le texte appartient au romantisme, d’où de constantes envolées poétiques, une exaltation du ton, des aperçus philosophiques, une gestion de l’action parfois déconcertante, les événements s’achevant à peine commencés, ou les situations dramatiques s’évaporant, pour ainsi dire. Bref, romanesquement, cela ressemble à Chateaubriand ou à Madame de Staël. Comme l’écrit cette dernière, « les événements ne doivent être dans les romans que l’occasion de développer les passions du cœur humain » (préface à Delphine). Mais après tout Frankenstein est de la même veine, et puise émotionnellement à la même source (Mary Shelley avait perdu un premier enfant), et The Last Man n’est rien inférieur à Frankenstein, de sorte que je m’étonne de la défaveur dont souffre ce roman. L’explication est peut-être à chercher chez les Victoriens, qui ont trouvé trop belle l’histoire de la frêle jeune femme de vingt ans qui écrit l’épouvantable Frankenstein. En somme, ce ne sont pas Shelley et les bébés qui auraient dû mourir, c’est Mary Shelley. Seulement elle ne mourut pas. Elle écrivit cinq autres romans.
Je me suis amusé à comparer les événements de The Last Man avec notre situation, par pur jeu d’esprit car, considéré d’un point de vue technique, The Last Man n’entre à aucun degré dans la catégorie des « romans prophétiques » (prophetic novels), dont les exemples canoniques sont les romans de H. G. Wells.
Dans The Last Man, la maladie provoque la migration ; dans la réalité, la migration est un phénomène antérieur à l’épidémie, et s’inscrit dans un mouvement historique : la contre-colonisation. Cela signifie, en termes stratégiques, que l’islam a joué cette carte de la migration trop tôt. On a déjà vu le changement en Thrace, où les Grecs bloquent stoïquement les « migrants » déployés par le régime d’Angora, et – évolution remarquable – obtiennent l’appui des vacillantes autorités européennes.
Dans le roman de Mary Shelley, on met en culture les parcs aux cerfs, après avoir mangé les cerfs. Puis inévitablement surviennent la disette, puis la famine. Nous autres sommes si riches, notre appareil économique présente tant de redondances, qu’on peut se confiner deux mois durant, en mettant plus ou moins l’économie à l’arrêt, sans provoquer la moindre pénurie, mais tout au plus des manques provisoires sur certaines denrées, manques dus à l’irréflexion des consommateurs. Je puis comprendre à la rigueur qu’on stocke la farine – on a décidé de faire son pain soi-même, ou de ne se nourrir plus que de pizza – ; mais qu’on stocke le papier-toilette ?
Dans The Last Man, on se croit à l’abri en Angleterre, parce qu’on est dans une île (« the sea was to rise a wall of adamant »), mais cette croyance est vaine. Nous autres entretenons une croyance exactement inverse, répétant, comme on nous l’a appris, qu’il ne sert à rien de fermer les frontières, et nous découvrons avec un véritable effarement qu’il y a contrordre, que les frontières sont décidément fermées, et même que la frontière commence à notre perron, puisque nous sommes tous consignés.
19 avril. — Bouquiné Metropolis, le roman de Thea von Harbou. Le film est exactement fidèle au roman, qui le précède immédiatement, et qui est manifestement écrit dans la perspective d’une version filmée, de sorte que la novelisation et le scénario apparaissent comme des projets parallèles plutôt qu’un texte-source et son adaptation à l’écran.
Il y a pourtant un détail important qui diffère entre le roman et le film et cela répond à l’interrogation que j’entretiens depuis longtemps sur une incohérence scénaristique du film. Dans le film, le robot est présenté par l’inventeur Rotwang comme Hel réincarnée (« Die Wieder-Erschaffung der Hel »), tandis que, dans le roman, le robot Futura est simplement le modèle de l’ouvrier du futur et a initialement une tête informe. Cependant dans le film comme dans le roman, le maître de Metropolis, Joh Fredersen, ordonnera à l’inventeur Rotwang de donner au robot le visage de Maria, en voyant celle-ci prêcher dans le souterrain. De là précisément l’incohérence du film, incohérence absente du roman. Dans le film, le robot est façonné à la ressemblance de Hel (cela nous est dit) et le robot ressemble physiquement à Maria (cela nous est montré ; au niveau de la production, le robot a été moulé sur le corps de Brigitte Helm). Cependant le film ne bâtit jamais le syllogisme : si le robot est façonné à la ressemblance de Hel et si le robot ressemble physiquement à Maria, alors Maria ressemble à Hel. Ou pour dire les choses autrement, le film ne construit jamais la relation transitive entre la défunte Hel, le robot fait à son image et Maria. Le résultat est que Freder, fils de Joh Fredersen, ne s’aperçoit jamais qu’il est amoureux d’une femme, Maria, qui est le sosie de sa mère. Et Fredersen et Rotwang n’aperçoivent pas davantage la ressemblance entre Maria et la défunte, de sorte que, dans le souterrain, Joh Fredersen demande à Rotwang de donner le visage de Maria à un robot qui en possède déjà les traits dans son masque de métal. (Dans le roman, encore une fois, le robot Futura n’a pas de visage formé, et la décision de Fredersen de lui donner le visage de Maria est par conséquent une décision de plein droit.)
Visuellement, le récit filmique laisse cette question des ressemblances dans une certaine indétermination. La ressemblance entre le visage géant en marbre blanc de Hel, le visage du robot métallique et le visage de Maria ne saute pas aux yeux du spectateur, parce que la différence des matières rend difficile la lecture des traits. Mais en examinant les photos de plateau on voit assez clairement, me semble-t-il, que la tête marmoréenne de Hel est un portrait idéalisé de Brigitte Helm et que le visage du robot est une sorte de caricature de la même Brigitte Helm, c’est, pourrait-on dire, la tête qu’aurait Brigitte Helm si elle était une auto.



Le plus singulier est qu’il y a dans le roman une incohérence en quelque sorte symétrique. À la fin du récit, Rotwang, qui s’est épris de Maria, est saisi d’hallucination, la bagarre avec Fredersen lui ayant apparemment dérangé l’esprit, et il prend Maria pour Hel. Dans le film, cette confusion est logique, du fait de la ressemblance de Hel et Maria (même si, encore une fois, cette ressemblance n’est pas actée scénaristiquement). Dans le roman, la confusion n’est justifiée par rien.
Tout cela dénote chez Thea von Harbou des idées assez confuses sur la question des visages. À la fin du roman, un Joh Fredersen réformé déclare à sa vieille mère, à propos du visage de Freder, son fils, qu’il lui a semblé le voir pour la première fois, que ce visage était à la fois celui de Fredersen et celui de Freder, mais aussi celui de la défunte Hel, mère de Freder, et celui de Maria, comme si Freder était né une seconde fois de cette dernière, et finalement qu’il était le visage du prolétariat qui vénère Maria.
Ma lecture du roman me conforte dans mon appréciation filmique (qui ne prétend certes à aucune originalité). Metropolis est un film superbe, mais l’histoire est absurde, remplie d’intentions brouillonnes, et fondamentalement incohérente.
21 avril. — Un syndicat policier diffuse des images de lynch, en les dédiant à « ceux qui victimisent les émeutiers prétendument opprimés par la police ». Une meute de cagoulards se jette sur un type au moment où il s’apprête à monter sur son scooter. Quand le type est à terre, on s’acharne sur lui à six, puis à huit, et ce sont les coups de pied en pleine tête. Et lorsqu’il ne bouge plus, le plus euphorique de la bande lui assène pour l’achever des coups de casque de moto en plein visage. Je suis frappé, dans toute cette imagerie de lynch, par ce souci de détruire le visage.
22 avril. — Je lis des numéros du Times Literary Supplement vieux de deux mois, que la poste me livre au compte-gouttes. Ils pourraient être vieux de deux ans, puisqu’ils datent des temps anté-pestilentiels. Voilà ce qui nous divertissait alors. Formulation plébéienne du même ressenti : « On n’en entend plus parler » (prononcé d’un ton faussement surpris et légèrement rigolard).
Cette soudaine dévaluation du discours public est interprétée dans les éditoriaux de la façon suivante : « Le coronavirus donne le temps de penser autrement. » Seulement il est apparemment plus difficile qu’il n’y paraît de « penser autrement ».
23 avril. — Chapitre du « on n’en entend plus parler ». Nous ne sommes plus persécutés au téléphone par les centres d’appel qui vendaient « l’isolation à un euro ». Les réclames sur la Toile semblent avoir disparu également. À la place, on vend de prétendues protections, gants, masques, visières transparentes, qui ne doivent pas plus protéger du virus que la fameuse isolation ne protégeait du froid.
24 avril. — La pandémie semble avoir eu plus ou moins raison des médias, par privation d’aliments. Il ne se passe plus rien puisque tout le monde est séquestré. Il ne paraît plus, sous différentes marques commerciales, que deux quotidiens, qu’on lit sur la Toile, free online dreck. Le premier est The Pandemic, le second est The Automated Throat Slitter. C’est un journal d’opinion qui milite pour un procédé révolutionnaire permettant à une civilisation de céder élégamment, et surtout rapidement, le plus rapidement possible, la place à une autre, « humane slaughter, brief and painless ».
26 avril. — Sensibilité absurde aux variations météorologiques. Une montée ou une baisse de température, un retour de la pluie après une période de sécheresse, c’est désormais la quasi-assurance pour moi d’une journée d’alitement. Le plus curieux est que la fatigue précède le changement. Je suis devenu un baromètre très fiable.
28 avril. — Le traitement politique et médiatique des frappes terroristes a décidément changé du tout au tout avec le confinement. Attentat au véhicule-bélier, hier soir, contre deux policiers. On a appris dès ce matin que le terroriste n’était pas fou, qu’il avait écrit une lettre d’allégeance au Califat. Le parquet anti-terroriste s’est saisi dans les vingt-quatre heures, au mépris de tout protocole.
Confinement. La découverte en illustration à un fait divers de la photo d’un coin de rue parfaitement banal, dans n’importe quelle ville de France, provoque une sorte de nostalgie poignante. C’est un endroit, c’est quelque part.
29 avril. — Plan de déconfinement. Le masque sera obligatoire dans les transports et recommandé dans l’espace public. Cependant, comme on a beaucoup répété que le masque ne servait à rien, on juge de mauvaise politique de dire aujourd’hui le contraire exactement et les médias se contorsionnent dans des explications aberrantes, les plus ingénieux dans le sophisme étant naturellement les rédacteurs des rubriques anti-bobards.
30 avril. — Expédition de courses et fait livrer du fioul. Tant que le livreur est dans la maison, je porte un masque. Je lui tends son chèque au bout d’une pince. Après son départ, j’aère au moyen d’un vigoureux courant d’air.
3 mai. — De toutes les stupidités d’éditorialistes à court d’invention, la plus navrante assurément est : « Ce que nous vivons est sans précédent », avec son corolaire : « Rien ne sera plus comme avant. » En fait de crise sans précédent, la pandémie portée sur les ailes de la mondialisation et donnant un coup d’arrêt à cette mondialisation, nous l’avons déjà connue avec la première route de la soie (tiens, tiens), la propagation épidémique (variole, rougeole, peste bubonique) le long des itinéraires mettant provisoirement fin aux échanges commerciaux. On était au troisième siècle de notre ère.
Quant au corolaire – « rien ne sera plus comme avant » – il confond épidémiologie et idéologie. Pour les tenants du « changement de civilisation », l’épidémie valide leurs critiques du monde tel qu’il est, et elle garantit que ce monde va se transformer conformément à leurs vœux. Il serait évidemment tout à fait déplacé de faire observer aux intéressés que leur réquisitoire contre un monde déchu n’a jamais mentionné le risque épidémique, que le « changement de civilisation » n’a jamais comporté un « plus jamais ça » épidémique.
6 mai. — Achevé The Magician (1908) de Somerset Maugham, curieuse incursion de cet auteur dans le roman fantastique, et même le roman d’horreur, puisque la fin, avec la rangée de cuves aux monstres, préfigure Lovecraft. Le magicien du roman est inspiré du sataniste Aleister Crowley, que Maugham a connu. Cependant on n’en demandait pas beaucoup, à l’époque victorienne finissante et à l’époque édouardienne, pour classer les gens comme satanistes. L’illustrateur décadentiste Aubrey Beardsley était « le Fra Angelico du satanisme ».
7 mai. — On déconfine lundi (nous sommes à jeudi). Allons-nous revenir aux temps ordinaires ? Le « rien ne sera plus comme avant » s’appliquera-t-il non au passé, mais aux cinquante-cinq jours du confinement, de sorte que nous aurons eu l’impression d’avoir rêvé ?
9 mai. — Refait les courses. Pharmacie et supermarché, tout en bouclé en une heure, puisque tout se joue désormais en modèle réduit : la pharmacie ne laisse entrer que quatre clients à la fois ; le supermarché ne met à disposition que 250 chariots.
Dans la queue à l’extérieur de la pharmacie, un type tousse derrière moi, sans mettre la main devant la bouche, et naturellement il ne porte pas de masque et se tient à moins de deux mètres. L’humanité se divise entre les gens prudents, qui maintiennent les distances et se masquent et les imbéciles, qui se conduisent comme des imbéciles. Seulement voilà, les imbéciles sont devenus des imbéciles dangereux, des imbéciles criminels.
10 mai. — Je me fais la cuisine en écoutant sur la Toile soit une messe soit une émission de désinformation. Ce soir, écouté un documentaire d’Arte parfaitement idiot consacré à la censure exercée sur l’art contemporain par les émeutiers en ligne. Je trouve détestable la rhétorique télévisuelle à l’œuvre dans ce type de productions : musique dramatique, plans de coupe servant à narrativiser le propos, comme si on nous déroulait une histoire – mais l’histoire de quoi ? –, montage qui transforme des discours construits de spécialistes en simples prises de position dans un « débat » médiatique. Or cette idiotie est délibérée, elle constitue elle-même le « message », puisque ce que la réalisatrice veut faire ânonner au public d’Arte, c’est que les « communautés » internétiques qui se liguent pour réclamer la censure de telle œuvre, telle exposition, telle représentation dramatique, sont certes dans l’excès, qu’il y a là un danger (celui de la « tyrannie des minorités »), mais qu’il est cependant possible d’adopter une voie moyenne en respectant les sensibilités et en faisant « dialoguer les cultures ».
Cependant les prétendues minorités tyranniques n’existent pas. Existent seulement différents groupes fascistes, qui se livrent à l’émeute, en ligne ou sur le terrain, et qui s’expriment à travers des porte-parole, par exemple des « universitaires » recrutés dans les banlieues françaises par l’establishment académique nord-américain pour exacerber les tensions raciales en France. Ce sont du reste les mêmes porte-parole, encadrés des mêmes brigades de para-militaires, qui dénoncent dans les mêmes termes les actions de la police contre leurs « frères » délinquants.
Quant à l’argument des intéressés, celui de l’« offense » et de la « douleur » provoqués par une « représentation raciste », compte tenu de l’hyper-sensibilité due à une « histoire traumatique », ou quant à l’argument jumeau de la « perpétuation d’un situation d’oppression », il ramène à la subjectivité des censeurs et donc à l’arbitraire de la censure, dont tous les historiens savent qu’elle est foncièrement illogique : telle chose, apparemment anodine, déchaîne les foudres du censeur ; telle autre, apparemment dix fois pire, passe sans problème.
11 mai. — Grande fatigue, peut-être parce que j’ai travaillé toute la fin de semaine pour achever un article. Je me suis endormi à neuf heures et c’est la tempête qui m’a réveillé ce matin, à cinq heures et demi. Entamé ma journée de travail. Mais c’était sans compter sur la météorologie – la température a chuté brutalement de dix degrés – et ses incompréhensibles effets sur mon organisme.
Documentaire sur l’incendie de Notre-Dame d’une chaîne de désinformation en continu. On ne sait toujours pas ce qui a déclenché l’incendie. – On ne le saura jamais du reste, puisque, comme nous le rappellent les auteurs du documentaire, « aucun élément ne permet d’accréditer l’hypothèse d’une origine criminelle » et « la thèse de l’incendie volontaire a été définitivement écartée » sont des expressions exactement synonymes. (De cette façon, il suffit que le feu ait fait rage, effaçant toutes les traces, pour qu’on ait la certitude qu’il ne s’agit pas d’un attentat.) On sait par contre pourquoi les mesures de sécurité n’ont pas fonctionné. Le monsieur chargé de la sécurité, employé d’une société de surveillance, comme n’importe quel vigile de supermarché, était nouveau, c’était son premier jour. Il était seul, son collègue ne s’étant pas présenté à son poste. Ce monsieur avait suivi une formation de deux demi-journées – comprendre deux fois une heure, la projection de diapositives.
13 mai. — Le premier symptôme a été cette abominable fatigue, il y a deux jours, que j’ai attribuée initialement à un excès de travail et à un brutal changement de température. Puis sont apparues les douleurs musculaires, la fièvre, des douleurs migraineuses inusitées, des douleurs gastriques et intestinales. Pas de symptômes respiratoires. Curieux signe dermatologique, une plaque rouge sur la première phalange de l’index gauche, où la peau paraît comme tannée.
15 mai. — Du mieux ce matin, après quatre jours. Les symptômes se retirent en bon ordre, ne restant que les douleurs dans les jambes, un peu de migraine et toujours une très grande fatigue.
17 mai. — Au sixième jour, je vais tout à fait bien. Qu’il est bon, qu’il est doux de se réveiller frais et dispos, l’esprit clair, avec, au fond de la conscience, une sorte de placidité qui est le signal, la « couleur » de la santé.
Longue course dans la campagne, trottant sans fatigue, tout au bonheur d’être bien portant. Soleil éclatant, température fraîche, un agréable petit vent d’est. Mais je ne me trompe pas, partout où la campagne est belle, par exemple dans cette jolie courbe entre deux talus où les acacias sont en fleur, la Direction de l’équipement coupe tout, arase tout, redresse tout. C’est une religion. Il faut religieusement enlaidir le monde. Le plus affreux est la pensée que ces gens ont un sens esthétique, puisqu’ils vont infailliblement à ce qu’il y a de beau, comme l’abeille va à la fleur – mais c’est pour la détruire.
La plaque rouge sur mon index gauche se décolore à vue d’œil ; c’est une chose étonnante qui, en d’autres temps, eût fait supposer quelque diablerie.
Je serai paraît-il contagieux pendant encore cinq jours. Je m’auto-confine donc pour la semaine qui vient.
19 mai. — Chapitre des lectures épidémiques. Dans le Times Literary Supplement, Joyce Carol Oates note que les auteurs de dystopies et de tableaux apocalyptiques sont pris de court quand la catastrophe survient dans la vie réelle – et ne fût-ce que parce que la catastrophe rend leurs peintures inutiles. Mais il y a là – à mes yeux tout au moins – l’aveu déconcertant que l’hyper-pessimisme n’est que de la délectation morose, que ces littérateurs apocalyptiques, qui n’ont de cesse d’alerter au travers de leur littérature sur des « urgences » (humanitaires, climatiques, etc.) et des « dangers » (politiques, technologiques, etc.), cultivent le malheur comme le maraîcher cultive ses légumes, qu’ils sont « morbides », en somme, mais n’accordent en réalité pas le moindre crédit à leur propres inventions.
20 mai. — Les questions qu’on s’échange en disent bien plus long que les analyses des experts. « Comment était votre confinement ? », c’est, à une minuscule échelle, le : « How was your war ? » des conversations de 1945.
Il paraît que la civilisation post-moderne est très mal armée moralement face à un événement comme la pandémie, car elle est en recherche, non pas de « sens », mais de « sens donné à », « d’interprétation », étant entendu que cette interprétation est arbitraire, qu’elle est personnelle, et qu’elle ne fait place à aucune transcendance. Cela est de très peu de secours devant la mort.
Je crois aussi que la crise a révélé aux moins méfiants que nous vivions dans une post-réalité, dans laquelle les contingences n’avaient plus cours. On pouvait parfaitement faire tourner nos économies sans usines, en faisant fabriquer nos produits à l’autre bout du monde. Cela n’engendrait aucun risque politique, énergétique, sanitaire, et ceux qui s’inquiétaient de tels risques étaient des imbéciles ou des « racistes ». Ce transport hors de la réalité était pour partie l’effet d’un climat intellectuel dans lequel les actes concrets étaient disqualifiés, existant seulement des « performances » linguistiques. Il y a eu un passage entre le marxisme – dans lequel la superstructure des croyances et des institutions n’est que le reflet de l’infrastructure de l’économie et des rapports de classe – et le post-modernisme, appuyé sur une lecture fautive d’Austin et des actes de langage : les anciens marxistes ont commencé à revendiquer le fait que les mots créaient leur propre réalité. Et finalement ils se sont réfugiés dans cette réalité fantomatique quand leur utopie a capoté dans le monde réel. Cet esprit de falsification a donné l’impression que, dans la crise épidémique, les mauvaises décisions ont été prises sur des fondements idéologiques, alors que la situation française est plus banalement celle d’un pays qui, de grande puissance qu’il était, a rétrogradé en une trentaine ou une quarantaine d’années au niveau d’un pays « émergent ».
La population a compris que la crise épidémique nous faisait brutalement replonger dans la réalité précisément parce qu’on s’affranchissait des automatismes langagiers. Par exemple on pouvait nous parler impunément de « gestes barrières » et de « distanciation sociale », alors qu’on nous avait dressés à attendre en réaction à tout propos vantant la « distance » ou la « barrière » un sermon bébête sur le « bien vivre-ensemble », sur l’importance du « lien social », sur le « monde sans frontières ». La pandémie était décidément « du sérieux », puisqu’on nous dispensait du sermon.
21 mai. — Ainsi une époque malade, une société malade (« changement de civilisation », autrement dit crise de la cité), est réellement tombée malade (pandémie). Comment s’étonner que les consignes sanitaires soient antiphrastiques (« tous ensemble chacun chez soi ») puisque l’antiphrase résume l’époque. Une faction politique qui se désigne elle-même comme « l’antiracisme » est caricaturalement raciste et virulemment antisémite, et cache de moins en moins ses intentions génocidaires. On a vu l’émergence d’un académisme anticulturel (je reprends l’excellente expression de l’historienne de l’art Isabelle Barbéris). On pourrait parler aussi du conformisme antinormatif de la petite-bourgeoisie morale. Ce qu’on appelle aujourd’hui l’« éducation » est son exact contraire, la production d’une doxa scolaire.
Quelle fin poursuit-on en fichant tout en l’air ? La réponse est : on ne poursuit pas d’autre fin que cette destruction elle-même. Une fois la destruction parachevée, on obtient exactement la société qu’on désirait. Cependant l’antiphrase pointe un aspect « technique », pour ainsi dire, que désigne précisément une expression antiphrastique devenue d’usage courant, celle de réalité artificielle. Du point de vue platonicien, ce qui se joue aujourd’hui, c’est une crise de la mimèsis, de sorte que la diatribe de Platon contre l’imitation (mimèsis), qui m’occupe tant ces derniers temps à propos de questions littéraires, est d’une terrible actualité politique. Les médias se présentent comme des experts en tout, alors qu’ils ne sont experts en rien et qu’ils dénaturent par conséquent la réalité. Ils sont comme le peintre dont parle Platon, qui représente un cordonnier, alors que lui, peintre, ne connaît rien à la cordonnerie, mais qui fait croire le contraire. (République, livre X, 598c). Et quant aux réseaux sociaux, leur fonctionnement même repose sur cette observation qu’on n’imite (mimèsasthai) jamais les caractères réfléchis et paisibles, qui n’ont rien de saillant, mais les caractères irritables (République, livre X, 604e) ; ils sont sociaux comme la guerre est un événement social. Or l’enfermement dans les mondes secondaires – des médias, des réseaux – devient, pour la première fois dans l’histoire humaine, une expérience tout à fait concrète ; on peut réellement passer sa vie entière dans un monde faux, un monde artificiel.
29 mai. — L’escroquerie de « l’isolation à un euro » occupe à nouveau les « bannières » publicitaires sur la Toile, et les messages seraient plutôt plus agressifs qu’avant la pandémie, parce qu’on a, avec cette affaire de confinement, perdu énormément de temps et d’argent. Les nouvelles réclames adoptent donc le ton strident des « droits » (« droit à l’escroquerie »), en dénonçant dans le langage des « droits » ceux qui dénoncent l’escroquerie ; il s’agit à présent d’« en finir avec qui s’opposent à l’isolation à un euro ».
31 mai. — Messe de la Pentecôte, première messe après dix dimanches sans offices. Les fidèles se présentent masqués. On se glisse par une petite porte (il n’y a qu’une entrée). On se passe obligatoirement les mains au gel. Un banc sur deux est fermé et on se met en bout de banc, soit seul si on est seul, soit en couple ou en famille. Il n’y a pas de chorale, mais une seule chanteuse. Pas d’élévation. On ne voit ni hostie ni calice. Pour la communion, on reste à son banc, ces dames passent avec un plateau couvert d’une étoffe, et elles dévoilent à mesure les hosties. S’étant servi, on ôte son masque pour se donner à soi-même la communion et on remet le masque aussitôt. S’il n’y a qu’une entrée, il y a de nombreuses portes de sortie, afin d’éviter qu’on se bouscule.
Impression très curieuse. Il y a quelque chose de médical (la désinfection), quelque chose aussi d’une guerre (les bancs fermés, comme si l’église n’était que partiellement utilisable).
1er juin. — Émeutes raciales aux États-Unis. Les images internétiques qui ont mis le feu aux poudres montrent un policier blanc, l’air hagard d’un homme qui s’est furieusement battu, le genou dans la nuque d’un noir étendu dans le caniveau, immobile. Quand la séquence s’achève, on comprend que le noir n’est pas seulement immobile, mais qu’il est bel et bien mort.
Je crois qu’il y a dans ce soulèvement insurrectionnel comme une réponse donnée collectivement à la crise du coronavirus. Un brusque réveil dans l’aube grise de la pandémie et de la dépression économique ? Pas question. Nous voulons rester dans le monde des images et de l’eusocialité, de l’indignation vertueuse et de la violence consolatrice. Nous voulons continuer à vivre dans la réalité artificielle des réseaux internétiques et de l’information continue. On peut également décrire ainsi la situation : l’énergie inemployée du fait du confinement se dépense en protestations et en émeutes.
La cocotte sous pression est aussi celle des médias, condamnés pendant trois mois à décompter les morts du coronavirus. La chaîne de désinformation du gouvernement russe parle, apparemment sans ironie, des émeutes contre les violences policières, comme si l’émeute était une forme approuvée d’expression politique. La BBC est plus feutrée mais pas moins louche : « Huge demonstrations have taken place in at least 30 cities across the US. They were largely peaceful on Saturday, but violence flared later in the day. » Voilà une phrase qui a l’air de se dévorer elle-même, puisqu’elle parle d’abord de manifestations « largement pacifiques » (c’est donc qu’elles ne l’étaient pas toujours), pour concéder qu’elles ont fini en émeutes et en pillage, autrement dit qu’elles étaient tout sauf pacifiques.
2 juin. — Indice du degré de confusion et d’hystérie générale, Le Venin, dans un article stupéfiant, arrive à imprimer que le médecin légiste du comté confirme la mort par asphyxie du noir Floyd, alors précisément que l’autopsie a rejeté l’hypothèse d’une mort par syndrome asphyxique ou par strangulation, et que le médecin légiste conclut que Floyd est mort d’un arrêt cardiaque dû aux conditions de son arrestation (compression des carotides), à des facteurs médicaux sous-jacents (maladie coronaire et asthme) et à des facteurs environnementaux (intoxication aux opiacés et aux amphétamines). La thèse de l’asphyxie est défendue par une expertise privée, faite à la demande de la famille. Mais les journalistes ont depuis longtemps perdu les pédales, à telle enseigne qu’ils prennent le médecin recruté par la famille, le docteur Michael Baden, pour « le médecin légiste officiel », et qu’ils lui font soutenir simultanément deux thèses contradictoires, mort par « arrêt cardiaque » et mort par « asphyxie », sans comprendre qu’elles sont soutenues, dans la réalité, par des médecins différents, et sans comprendre qu’elles sont contradictoires. Après quoi, comme ce n'est décidément pas la jugeote qui encombre les journalistes français, mais comme ils ont compris à l'agitation de leurs confrères américains qu'il y avait une bataille d'experts, ils notent que ces deux expertises aux « conclusions similaires », celle du médecin légiste, celle du médecin recruté par la famille, contredisent une « première autopsie officielle », qui est précisément celle du médecin légiste.
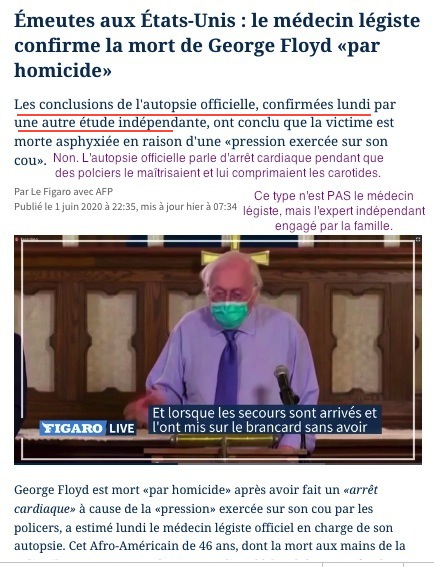
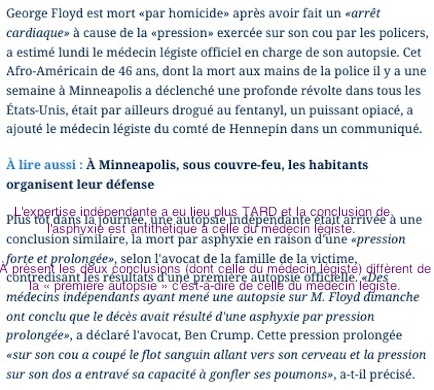
3 juin. — En France, émeute contre les violences policières, à l’imitation des émeutes raciales américaines. Curieuse synthèse imagière : le masque de protection contre le coronavirus devient une version du foulard qui dissimule le visage des casseurs.
Thèse médiatique des « vieux conflits » (conflit racial, conflit civilisationnel). Mais ce ne sont pas de vieux conflits, ce sont des conflits tout neufs, menés par des troupes fraîches. On a seulement donné aux nouveaux belligérants de vieux prétextes.
4 juin. — Dans le Daily Venom, émouvant récit du complice de Floyd, un nommé Hall, façon vie de saint, les caractéristiques criminelles de l’intéressé contribuant à cette image de sainteté. Hall était avec Floyd, dans son auto, au moment de l’arrestation. Hall a donné un faux nom aux policiers, parce qu’il était sous le coup d’un mandat d’arrêt pour détention non autorisée d’arme à feu, violence conjugale, et détention de stupéfiant. Il a fichu le camp, trop heureux de s’en tirer à si bon compte, et s’est terré pendant deux jours, avant de se rendre compte qu’il était passé dans une dimension parallèle où il était, lui, la victime. Il a été incarcéré puis aussitôt relâché à la demande de son avocat.
5 juin. — L’hystérie médiatique est à son comble. Les médias ont bâti en une semaine un univers parallèle complet – un monde-champignon, comme il y a des villes-champignons – basé sur un factoïde imagier (« on a tous vu les images »), et conforme à une « idéologie » qui est elle-même absolument vide, puisqu’elle se borne à l’affichage de sa propre vertu (« l’indignation face au racisme »).
Dans cette réalité artificielle, on est soit victime, soit bourreau. Le pape, quand il condamne le racisme (il condamne aussi les émeutes), « sort de son silence » – qui était donc un silence coupable. Inversement, le président Trump, qui a averti qu’il ferait appel à la garde nationale si c’était nécessaire, « fait l’objet d’une surveillance renforcée sur les réseaux sociaux », qui lui suppriment ses messages au fur et à mesure, parce que, dans ce monde parallèle, il n’est pas le président des États-Unis, mais un « blanc raciste ».
Cette réalité parallèle entièrement construire sur des images pose des problèmes inédits. Par exemple, le « plaquage ventral » devient par le relais imagier une « violence policière ». Mais les émeutes multiplient à l’infini ce plaquage, et les images de ce plaquage. En sens inverse, si les émeutes sont justifiées par la mort d’un homme, que justifient-elles à leur tour quand elles font de nombreux morts ?
8 juin. — Décidément, il faut lire les émeutes américaines comme une forme de psychodrame qui consiste à rejouer la crise épidémique au rebours de son déroulé réel. Au lieu du confinement, de l’oisiveté forcée, l’agglutinement en une masse compacte, l’agitation frénétique d’une foule enflammée. Au lieu de la prise en compte de réalités douloureuses : celle de notre mortalité, celle de la fragilité de notre société, la réaffirmation d’un combat éternel : celui des « opprimés » contre les « structures de l’oppression », c’est-à-dire précisément contre la société. Plus d’un millier de médecins, d’infirmières, d’épidémiologistes américains ont signé une lettre ouverte appuyant les démonstrations au nom de la politique de santé publique et comme une partie intégrante de cette politique de santé (« ... demonstrators who have already taken on enormous personal risk to advocate for their own health, the health of their communities, and the public health of the United States. ») L’une des signataires de la lettre – qui est elle-même en post-doc dans le domaine des maladies infectieuses – explique qu’il s’agit de « changer la perception des protestataires comme “dangereux” ou comme “représentant un risque pour la population”du fait de la pandémie » (« the goal is to change the narrative that those protesting are “unsafe” and “putting people at risk” from the pandemic »). Les caractéristiques de la pandémie – létalité, contagiosité – sont donc niées par des personnes qui appartiennent aux professions de santé, dès lors qu'il est question de leurs frères de race – c’est-à-dire des émeutiers noirs. Et de façon plus mystérieuse encore, les caractéristiques de l’émeute (ce sont les mêmes : létalité, contagiosité) s’effacent, puisque l’émeutier est censé mettre en place au moyen de l’émeute des mesures de prophylaxie dans les épidémies jumelles du coronavirus et des violences policières.
Je notais (entrée du 20 mai) qu’en préconisant « gestes barrières » et « distanciation sociale » on contrevenait flagramment à notre conditionnement idéologique en faveur de « l’inclusivité », du « vivre-ensemble », de tout cet aspect « cochons ensemble » qui caractérise le discours « citoyen ». Or voici que ces prescriptions idéologiques bafouées réapparaissent, sous une forme théâtralisée, et dans une version si extrême qu’elle évoque fortement le dérangement d’esprit (des soignants décrivent les émeutiers comme étant eux-mêmes des soignants).