|

notes pour servir à l'histoire du spiritisme scientifique
Théodore Flournoy et Hélène Smith
par Harry Morgan
|

notes pour servir à l'histoire du spiritisme scientifique
Théodore Flournoy et Hélène Smith
par Harry Morgan
Meinem guten marzianen Freund zugeeignet,
1970-71
J'attends toujours je ne sais quoi d'inconnu, nouvelles formes d'art et nouvelles pensées et quand elles devraient venir de la planète Mars, nul Lemaître ne me persuadera qu'elles doivent m'être nuisibles ou me demeurer inconnues.
André Gide, Lettres à Angèle, Lettre VI, 1899
I. IL Y A CENT ANS
 "Au
mois de décembre 1894, je fus invité par M. Auguste
Lemaître, professeur au Collège de Genève,
à assister chez lui à quelques séances d'un
médium non professionnel et non payé, dont on m'avait
vanté de divers côtés les dons extraordinaires et
les facultés apparemment supranormales. Je n'eus garde, comme
bien l'on pense, de laisser échapper une telle aubaine, et me
trouvai au jour dit chez mon aimable collègue.
"Au
mois de décembre 1894, je fus invité par M. Auguste
Lemaître, professeur au Collège de Genève,
à assister chez lui à quelques séances d'un
médium non professionnel et non payé, dont on m'avait
vanté de divers côtés les dons extraordinaires et
les facultés apparemment supranormales. Je n'eus garde, comme
bien l'on pense, de laisser échapper une telle aubaine, et me
trouvai au jour dit chez mon aimable collègue.
Le médium en question, que j'appellerai Mlle Hélène Smith, était une grande et belle personne d'une trentaine d'années, au teint naturel, à la chevelure et aux yeux presque noirs, dont le visage intelligent et ouvert, le regard profond mais nullement extatique, éveillaient immédiatement la sympathie. Rien de l'aspect émacié ou tragique qu'on prête volontiers aux sibylles antiques, mais un air de santé, de robustesse physique et mentale, faisant plaisir à voir et qui n'est point d'ailleurs un fait très rare chez les bons médiums."
Ainsi commence, par un poncif,* l'ouvrage du psychologue suisse Théodore Flournoy titré Des Indes à la planète Mars, et sous-titré Etude sur un cas de somnambulisme avec glossolalie (1900), imprimé à ses frais, et dont la suite sera: Nouvelles observations sur un cas de somnambulisme avec glossolalie, publiée dans sa propre revue (déc. 1901, in Archives de psychologie; tome premier, daté 1902).
* Dans la littérature du spiritisme, pas une description de médium qui ne commence par la protestation que le médium n'a rien d'une sibylle. Les plus grands médiums, Eusapia, Florence Cook, etc. eurent droit à ce rituel éloge, peut-être destiné à les distinguer des saintes, mystiques et extatiques chrétiennes.
Th. Flournoy, après des études de médecine (sa thèse, soutenue à Strasbourg, en 1878, porte sur l'embolie graisseuse) et de philosophie (il est spécialiste de Kant) a fondé le laboratoire de psychologie de l'université de Genève. Il est venu à l'étude de l'inconscient dès 1892, via l'audition colorée et les synopsies - ces bizarreries psychologiques qui font associer les chiffres, ou les lettres de l'alphabet, aux couleurs, et les jours de la semaine à des marches d'escalier et qui nous valurent, entre de moindres chefs-d'oeuvre, le Sonnet des voyelles de Rimbaud.
Au lieu d'inconscient, Flournoy parle, comme Myers, de subliminal (de sub limen, unter der Schwelle, sous le seuil). Son inconscient est un inconscient créateur, inventeur, artiste, romanesque, acteur, bavard, florissant. D'où son intérêt pour les médiums.
Il publie en 1898 Quelques Faits d'imagination subliminale chez les médiums. Mais Hélène Smith est sa principale découverte et la source de sa gloire.
trois romans subliminaux
Flournoy commence par démontrer qu'Hélène est une automatiste. En attestent les contractures observées pendant les transes, et même l'une ou l'autre phase de somnambulisme complet signalée dès l'année 92 (c'est à dire avant que notre psychologue ne s'en mêle).
Du moment où Flournoy intervient, la médiumnité d'Hélène devient complète. Comme l'écrit notre auteur, "En termes physiologiques, l'hémisomnambulisme sans amnésie auquel elle en était restée jusque-là, et que les assistants prenaient pour l'état de veille ordinaire, se transforma en somnambulisme total, avec amnésie consécutive. En langage spirite, Mlle Smith devint complètement intrancée, et, de simple médium voyant ou auditif qu'elle était, elle passa au rang supérieur de médium à incarnations.
Je crains que ce changement ne doive m'être en grande partie imputé, puisqu'il a suivi de près mon introduction aux séances d'Hélène."
Et notre psychologue de louer ce médium polymorphe.
Apparaissent alors les trois "romans somnambuliques" que l'auteur appelle aussi des cycles (analogues, écrit Flournoy, à ces "histoires continues", ces rêves éveillés, ou ces fantaisies, que les gens se racontent à eux-mêmes, "mille fois reprises et poursuivies, rarement achevées"). Ce sont le roman hindou, le roman royal et le roman martien.
Dans le cycle hindou, Hélène revit une incarnation où elle fut la fille d'un cheik arabe et, sous le nom de Simandini, l'épouse d'un prince hindou, Sivrouka, régnant sur le Kanara et qui aurait construit la forteresse de Tchandraguiri.
Dans le cycle royal, Hélène est Marie-Antoinette, reine de France. Elle s'était tenue pendant quelques semaines pour la réincarnation de Lorenza Feliciani, le médium de Cagliostro, jusqu'à ce qu'on lui fasse remarquer que ce personnage sortait de l'imagination de Dumas (Mémoires d'un médecin). Elle devint alors Marie-Antoinette.
L'origine du roman royal est, selon Flournoy, la gravure des Mémoires d'un médecin illustrant la fameuse scène de la carafe.
Dans le cycle martien, Hélène Smith est en communication avec notre planète-soeur, dont elle décrit les paysages et, surtout, dont elle livre la langue et l'écriture.
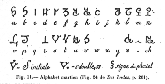
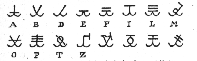
Ce cycle sera prolongé par un cycle ultramartien, un cycle uranien et plusieurs cycles lunaires, sur lesquels, malheureusement, la documentation va en décroissant, suite à la brouille du médium et du psychologue, de sorte que, sur les derniers nous ne savons à peu près rien.
On se ferait une représentation fausse des séances en supposant qu'Hélène, endormie, se contente de vaticiner. Elle présente simultanément tous les types d'automatisme. Son esprit guide s'exprime par son doigt- par typtologie - tandis qu'elle parle; ou bien elle interprète la lutte avec l'esprit familier, chacun contrôlant la moitié de son corps. Puis, au plus profond de la transe, elle mime les scènes qu'elle voit ou joue son rôle tandis que les expérimentateurs lui donnent la réplique.
Ces représentations culminent en 1895, avec les grandes séances jouées (en particulier dans les cycles hindou et royal, les plus théâtraux et aussi les plus érotisés), que Flournoy fait photographier.
Tels sont les trois romans fabriqués par la subconscience d'Hélène.
En même temps que ces élaborations complexes et ordonnées (ordonnées du moins autour de grandes scènes, - car pour la continuité qu'on associe généralement à l'idée de roman, elle fait totalement défaut), fruits des somnambulismes complets de Mlle Smith, se développent les facultés de demi-somnambulisme et Hélène vivra dans un monde enchanté, gratifiée dans ses moments de moindre attention, de visions, communications et autres révélations.
Hélène a toujours été une enfant rêveuse et solitaire. Visions, peurs irraisonnées et véritables hallucinations se sont succédées dans son enfance. Elle a cultivé le rêve éveillé. Flournoy croit que les créations automatiques du médium poursuivent les rêveries enfantines. Il suppose que - sans le déclencheur de l'initiation spirite - ces facultés auraient progressivement disparu à l'âge adulte, la personnalité s'équilibrant, ou s'unifiant, pour garder le jargon du psychologue.
Léopold et Cagliostro
Un mot sur Léopold, qui est l'esprit guide d'Hélène et qui se rattache plus spécifiquement au cycle royal, puisqu'il se découvre qu'il s'agit de Cagliostro.
Léopold, vis-à-vis du médium, se comporte à la fois comme une sorte d'impresario, comme un directeur de conscience, et - ainsi que l'écrit Flournoy - comme un régisseur caché dans la coulisse et qui surveille le bon déroulement du spectacle.
Dans le cycle royal, il apparaît à sa place (aux yeux du seul médium), comme un personnage de la comédie, et il donne la réplique (inaudible) à Hélène-Marie-Antoinette.
Cependant, il a ses équivalents dans le cycle martien.
Flournoy oublie de le noter, mais il y a du Dr Phinuit dans Léopold. Le médecin français désincarné qui sert d'esprit guide à Mrs. Piper, le médium de Boston, coqueluche de la Société Américaine des Recherches Psychiques, a visiblement inspiré à Hélène son Léopold-Cagliostro. Joue ici la part de la culture médiumnique, que Flournoy néglige presque entièrement chez Hélène (et à quoi répond du reste sa culture de chercheur psychique, car Flournoy n'oublie pas, quant à lui, de se comparer avec ses illustres homologues d'outre-Atlantique qui, à la même époque, étudient Mrs. Piper.)
outils théoriques
Les outils théoriques de Flournoy sont multiples, à l'image des personnalités d'Hélène, et le psychologue ne cherche pas à les unifier ou les solidifier en une vision plus vaste. Ils comprennent, d'après la liste donnée en préface à Des Indes: la désagrégation mentale de Pierre Janet, le double-moi de Max Dessoir, les états hypnoïdes de Freud et Breuer et surtout la théorie du moi subliminal de Myers. D'après les références en bas de page et les notions utilisées peu ou prou dans le texte, on pourrait rajouter à cette bibliothèque la psychologie de William James.
La désagrégation mentale de Pierre Janet (L'Automatisme psychologique, 1889) consiste en l'apparition d'une deuxième série de pensées non rattachées à la personnalité normale. Elle se manifeste en particulier dans l'écriture et la parole involontaire et se rattache donc à l'automatisme partiel (par opposition au somnambulisme complet - ou à la catalepsie - qui réalise l'automatisme total). La désagrégation mentale a cependant de multiples degrés, et le sujet, plus ou moins réveillé, est également plus ou moins conscient de ce qui se joue en lui.
Flournoy, fort de cette théorie, brosse donc le tableau des hallucinations, et autres rêves éveillés spontanés d'Hélène Smith dès avant sa médiumnité et même depuis son enfance.
De façon plus générale, Flournoy se situe à l'extrémité d'une série d'études des personnalités secondaires ou des personnalités multiples, qui a traversé le 19ème siècle. Désagrégation mentale et personnalités secondaires sont alors largement considérées, dans le monde savant, comme les sources des phénomènes médiumniques.
Des états hypnoïdes de Freud et Breuer (Studien über Hysterie, 1895) Flournoy donne un exemple typique, l'hallucination d'un aérostat qui visite Hélène à heure fixe, pendant une période de mauvaise santé (et donc de suggestibilité accrue) parce qu'ayant vu un ballon à l'exposition nationale de Genève, la femme qui l'accompagnait se montra curieuse des impressions d'Hélène si elle consentait à monter dans ce ballon. On voit l'importance 1) du choc émotionnel et 2) de l'état de conscience diminué à cause de la maladie ou de la santé débile.
La psychologie de William James entre moins parfaitement dans le schéma de Flournoy. James n'a rien à voir avec l'automatisme, niant l'idée d'une pensée subconsciente et ironisant lourdement dans ses Principles of psychology (1890) sur toute l'école allemande de la pensée inconsciente, von Hartmann et Schopenhauer en tête. Quel contraste avec Janet qui étend les dimensions de l'automatisme ou des "formes inférieures de l'activité humaine" jusqu'à y inclure la distraction, l'instinct, l'habitude et... la passion amoureuse.
Mais comme simultanément William James admet les personnalités secondaires, et qu'il est pétri de science psychique, sa pensée sert, en dépit de tout, les desseins de Flournoy.
Myers
La théorie du moi subliminal de Myers est la pièce de résistance du menu théorique de Flournoy.
Ainsi que nous l'écrivions dans notre étude sur Human Personality*, Myers a eu une influence considérable sur ses pairs, en particulier sur James, Janet et Flournoy. Cette influence précède la publication (en 1903) de son ouvrage posthume et s'étend sur les vingt dernières années du siècle, où le chercheur anglais domine les recherches psychiques par le poids, la quantité et la rigueur de ses publications dans les Proceedings de la S. P. R.
Que la pensée qu'il a ainsi exprimée au fil des volumes des Proceedings ne fût pas la pensée définitive de Myers est évident; mais comme on sait que l'illustre chercheur anglais n'a pas achevé son ouvrage, les deux volumes de Human Personality n'apparaissent eux-mêmes que comme une suprême compilation de ses travaux, débarrassée de certaines thèses par trop aventurées.**
* L'esprit dans la lettre, spiritisme scientifique et littérature, I. Comment Fred Myers vint à l'esprit, The Adamantine, vol. 11, 1er cahier.
** Janet relève par exemple la théorie de Myers, abandonnée par la suite, qui fait de chaque hémisphère cérébral le siège d'une personnalité autonome, explication commode, encore que naïve, des cas de dédoublement de personnalités, - mais qui n'explique pas les personnalités multiples!
Flournoy partage la conception de Myers d'une subconscience utile. Il donne de nombreux exemples d'interventions à bon escient de la subconscience d'Hélène.
Notre genevois est même tout pétri de Myers. Il est reconnaissant à cet auteur d'avoir fixé le vocabulaire de l'automatisme et lui emprunte par exemple le terme d'hallucinations hypnopompiques. Il lui sait gré d'avoir fixé les notions des recherches psychiques et ne parle, avec Myers, que de supranormal, pour ne pas dire surnaturel, ce qui barrerait la route à l'investigation scientifique (le terme de paranormal, avec son délicat fumet de lecture de concierge, n'est pas encore en usage).
La pente de l'ouvrage de Flournoy est toute myersienne. Le miracle du cas Hélène Smith, c'est qu'une personnalité présentant des tendances à la désagrégation mentale parvienne à organiser son activité en cycles distincts. C'est la problématique même de Myers, qu'on pourrait résumer ainsi: Comment un état maladif parvient-il à améliorer la personnalité, ou du moins à produire des phénomènes supérieurs à ceux qu'on attendrait de la personnalité normale?
du supranormal
Cependant, il faut bien que les deux auteurs diffèrent à un moment.
Selon Flournoy, les phénomènes d'Hélène Smith révèlent une riche faculté d'invention, d'organisation et de mémorisation (en particulier dans les alphabets et les lexiques des langues extra-terrestres) mais la personnalité qui les crée est infantile. Une bonne partie de Des Indes est consacrée à la démonstration de l'infantilisme des productions de Mlle Smith.
D'après Flournoy, les rêveries de l'enfance, chez une personnalité portée à la désagrégation mentale, passent sous le champ de la conscience, et deviennent des phénomènes automatiques. L'initiation d'Hélène au spiritisme a donné le prétexte, la licence, avec ses ancrages autour des esprits, des planètes et des vies antérieures.
La subconscience de Mlle Smith, c'est donc son enfance, passée de l'autre côté, passée sous le seuil, et réveillée par la pratique du spiritisme et par les suggestions de Flournoy.
Flournoy consent-il à la merveille, c'est à dire aux facultés mentales inconnues, conformément à la théorie du subliminal de Myers?
S'il y a du supranormal chez Hélène, Flournoy ne l'a pas vu. Il ne nie pas qu'il puisse y en avoir. Il laisse la question ouverte.
Limpide en apparence, la solution de Flournoy est louche.
En spiritisme, le merveilleux provient des moyens plus que des résultats. C'est la transe elle-même qui est la merveille, c'est l'automatisme qui fait le caractère extraordinaire des séances. C'est pourquoi l'histoire des sciences psychiques commence avec l'hypnose. Un psychiste convaincu pourrait la résumer à peu près ainsi: On constate que, sous hypnose, des êtres prédestinés manifestent des phénomènes qui échappent aux lois connues de la nature.
On n'a donc pas vidé la merveille en déclarant infantile la subconscience de Mlle Smith.
le cas Flournoy
Il se pose en réalité trois séries de questions:
• D'abord, quelle est la part de Flournoy dans la production des phénomènes? Dans des expériences telles que celles des Charcot, des Binet, des Janet ou des Flournoy, l'expérimentateur n'est pas neutre, et ne prétend pas l'être, mais influence le phénomène par suggestion. Flournoy a lui-même souligné son rôle crucial dans les séances avec Hélène et fait le parallèle avec l'hystérie. Faut-il en conclure que l'invention des phénomènes appartient autant à notre psychologue qu'à Hélène, que les productions automatiques d'Hélène sont semblables à celles des malades de la Salpêtrière?
• Deuxièmement, quel est l'enjeu de la séance pour les deux parties? Cela nous amène inévitablement à la question de la séduction et nous oblige à suivre l'évolution ultérieure des rapports entre nos protagonistes.
• Enfin, quelle est la position de Flournoy vis-à-vis des phénomènes médiumniques? Il ne faut pas confondre le psychologue avec un esprit fort, un sceptique, un de ces médecins à l'ancienne mode, mécréants et matérialistes. Est-il, tout en s'en défendant, peu ou prou, un spirite? Est-il un chercheur en science psychique (qui, par définition, ne préjuge pas des résultats) et, dans ce dernier cas, lorgne-t-il plutôt du côté de la métapsychique (et des phénomènes physiques) ou du côté des recherches psychistes anglo-américaines (et des phénomènes métagnomiques)?
Flournoy se déclare convaincu par les tables tournantes de Thury. Il accepte les phénomènes d'Eusapia Palladino. Cependant, s'il est un chercheur psychique, pourquoi s'obstine-t-il à étudier un médium dont il s'est convaincu au bout de quelques mois qu'il ne produit pas de phénomène supranormal.
Cherche-t-il seulement, comme l'indiquerait le titre de sa première étude, à étudier la production linguistique d'Hélène Smith, c'est-à-dire un curieux phénomène d'automatisme? Mais dans ce cas, pourquoi écrire un livre qui, sous son titre anodin, prend à bras le corps la question de la médiumnité?
On voit à quoi mène ce train de pensée. Il ne faut plus parler du cas d'Hélène mais de celui de Flournoy. A côté du cas Hélène, enfantin et transparent, le cas du psychologue est des plus complexes, des plus embrouillés.
la suissesse et le Saint-Bernard
"Ce style, il fait involontairement penser à un gros chien du Saint-Bernard: il entre en matière d'un air bon enfant, il gambade, fait mine de vous céder, revient d'un bond... et vous voilà roulé par terre."
La Gazette de Lausanne, 4 janvier 1902 (cité dans O. Flournoy, Théodore et Léopold, 1986)
Flournoy, au moins dans Des Indes, écrit bien. Il a une façon de présenter les choses qui n'a l'air de rien mais qui dispose le lecteur et le conduit où l'auteur veut le mener.
Il manie tour à tour l'ironie, le gros bon sens, la sympathie chaleureuse. Il est positif, il est enthousiaste, il est caustique. Il est d'une rondeur de médecin de famille, ou bien il vole au secours de son médium, fringant comme un jeune homme, et puis le voici qui gamine et polissonne.
Flournoy songe d'abord à défendre son médium, et d'autant plus qu'il ne l'épargnera pas sur la nature de sa médiumnité. S'il ironise sur la façon dont Hélène se décerne parfois, par Léopold interposé, des certificats de santé mentale, lui-même rédige constamment de tels certificats.
Il faut dire qu'on est en plein scientisme, en pleine vague du "génie comme névrose" (Flournoy cite d'ailleurs l'ouvrage de Lombroso et l'étude du docteur Toulouse sur Zola). Dans un tel contexte, la médiumnité devient, c'est la moindre des choses, une preuve de dégénérescence.
Flournoy en preux chevalier vient donc à la rescousse de son médium, en vitupérant les racontars de la faculté, la bigoterie et l'étroitesse d'esprit de ses membres, sans d'ailleurs dissimuler son dilemme. Le débat est polarisé entre les deux conceptions, myersienne et lombrosienne, la médiumnité comme utilisation de facultés supérieures et la médiumnité comme phénomène morbide, et il faut prendre parti.
Or voici, Flournoy n'a aucune envie de prendre parti. "«Vous n'osez pas affirmer que la médiumnité est une chose bonne, saine, normal, enviable, qu'il faut développer et cultiver partout où on le peut, et que les médiums nous mettent en relation avec un monde invisible supérieur? Mais c'est donc que vous tenez cette disposition pour funeste, malsaine, morbide, détestable, digne d'être extirpée ou anéantie partout où elle fait mine de se montrer, et que vous regardez tous les médiums comme des détraqués!» Voilà [écrit Flournoy] la logique imperturbable du vulgaire, le dilemme taillé à coup de hache dans lequel le milieu ambiant, spirite et non spirite, s'amuse parfois à m'enfermer et qu'il ne cesse de faire résonner aux oreilles de Mlle Smith."
Ou plutôt, puisqu'il lui faut prendre parti (et de préférence en faveur de son médium) Flournoy va tâcher de trouver des facultés utiles dans un phénomène morbide, le fameux uprush of helpful faculties de Myers, ce que Flournoy nomme drôlement la petite monnaie du génie. "Il est cependant intéressant de constater, écrit-il, que dans les pays où ces études ont été poussées le plus loin, en Angleterre et en Amérique, le courant dominant chez les savants qui ont le mieux approfondi le sujet n'est point du tout défavorable à la médiumnité, et que, loin d'en faire un cas particulier de l'hystérie, ils y voient au contraire une faculté supérieure, avantageuse, saine, dont l'hystérie serait une forme de dégénérescence, une caricature morbide."
Flournoy n'est pas si loin de William James qui reconnaîtrait volontiers aux médiums une hypothétique fonction sociale de prêtresses du subliminal et imagine un culte de l'inconscient, du réservoir de force vitale dont les détentrices, mixture de prophétesses et de magiciennes, de thérapeutes et de femmes-abbés, eussent trouvé dans leur emploi prestige et un suffisant équilibre, - vision charmante; charmante et lointaine.
Le flagorneur et l'hystérique
Des Indes est un délicat exercice d'équilibre entre les passages adressés au public savant (où notre auteur se permet parfois une ironie badine), et ceux plus spécifiquement destinés à se ménager les bonnes grâces du médium (ou le ton est tour à tour révérencieux et affectueux).
Cette obligation de ménager ses deux publics, Flournoy y fait allusion dans sa préface en disant que son livre est un bâtard d'ouvrage scientifique destiné au petit nombre de savants ou de gens "du métier" (c'est à dire de psychologues) et de livre de vulgarisation adressé au "public cultivé". Dans cet hypothétique public, qui ne peut être très vaste, l'ouvrage étant tiré à mille exemplaires, il faut inclure Hélène et les gens qui la connaissent - et la reconnaîtront.
Dans les Nouvelles Observations, moins bien écrites, et destinées au public savant, dossier, enfin, plus que livre véritable, Flournoy avoue les artifices. "Mes lecteurs spirites de Des Indes ne paraissent pas avoir compris le grain d'ironie, ou l'artifice diplomatique alors nécessaire, qui m'a fait traiter d'extravagance la supposition que Mlle Smith aurait pu lire ou entendre le passage en question dans Marlès. [Il s'agit des noms et des dates relatifs au roman hindou.] Il suffisait pourtant d'un peu de bon sens pour se dire qu'un ouvrage de ce genre, publié à Paris en 1828, ne devait pas être, au bout d'une cinquantaine d'années, d'une rareté telle qu'une enfant ou une jeune fille comme Hélène ne pût en aucun cas le rencontrer occasionnellement sur sa route."
Et ailleurs, dans le même ouvrage: "En m'abstenant de formuler catégoriquement mes conclusions... je favorisais en effet les interprétations même les plus contraires à l'évidence [en inclinant pour l'authenticité des signatures spiritoïdes d'un syndic et d'un curé savoyards]. J'en fais mon peccavi: j'avais trop compté sur la perspicacité de tous mes lecteurs, et plusieurs se sont laissés prendre aux artifices de rhétorique, pourtant si transparents, auxquels j'avais eu recours afin de ne pas heurter trop rudement la conviction sincère de l'honorable médium..."
Hélène S.
Pourtant, à d'autres endroits de Des Indes, Flournoy suppose tout de bon qu'Hélène ne lira pas son livre. C'est, au fond, un désir inavoué. Flournoy ne trouverait pas mauvais que son sujet se comportât comme ceux des médecins et des psychologues, sans intervenir sur la suite.
C'est précisément à l'imitation des Félida X, des Anna O., des Léonie, des Marie, que Flournoy dote son sujet d'un pseudonyme.
C'est d'abord un moyen de protéger son anonymat. La précaution s'avère d'ailleurs insuffisante, vu le caractère public de l'activité d'un médium, même d'un médium bénévole et qui n'opère que dans des cercles privés - vu aussi l'environnement d'une petite ville et la nature de l'ouvrage qui, sans être un best-seller, a tout pour intriguer. Hélène fut identifiée dès la parution de Des Indes comme Catherine-Elise Müller.
Mais un pseudonyme est aussi un nom de plume.Que Flournoy ne s'est-il contenté, à la façon de Janet, de donner un prénom, vrai ou supposé, et peut-être une initiale, à son médium. Il n'y aurait point, dans ce cas, d'Hélène Smith mais une Catherine ou une Elise ou, mieux, une Hélène S.? Ces femmes qu'on nomme par leurs prénoms ne sont que sujets d'expérience; elles sont les servantes de la science.
En donnant un nom de fantaisie à son médium, Flournoy lui reconnaît implicitement un statut d'artiste ou d'auteur. On imagine aisément dans la bibliothèque de nos songes, quelque roman anglais signé de ce nom.
Hélène se considère d'ailleurs comme coauteur de Des Indes. Cela posera de menus problèmes après la brouille, puisqu'elle se persuadera être la destinatrice normale des droits d'auteur et soupçonnera Théodore de s'enrichir sur son dos.
Nous nous trouvons en somme devant un double cas de cécité hystérique, analogue à celle dont est frappée Hélène dans la transe, et qui fait disparaître les assistants à sa vue, chacun des deux partenaires méconnaissant
Pourquoi un pseudonyme à consonance anglo-saxonne? Ce n'est pas une langue qu'Hélène possède. Comme l'écrit drôlement le psychanalyste Olivier Flournoy, petit fils de notre psychologue, dans Théodore et Léopold (1986): "Hélène parle le français, l'italien et l'allemand un peu, à peine un mot de hongrois, le martien à la perfection, mais en principe, elle ne parle pas l'anglais..." Et notre auteur d'ajouter malicieusement: "D'autre part, Hélène parle le martien comme un enfant de six ans qui inventerait une langue secrète, l'ultramartien comme un enfant de deux ans qui serait installé sur son pot, et de plus elle baragouine l'uranien et balbutie le lunaire."
Il est clair d'abord que Flournoy (ou Hélène, car il est possible qu'elle ait inventé son pseudonyme*) a choisi de signaler l'artifice. D'où ce patronyme de Smith, trop commun, sentant le faux nom, assorti de surcroît d'un prénom français, comme pour mieux montrer qu'il est fait à plaisir.
* "Selon l'opinion de Mme Denise Werner, dont la mère, Mme Alice Werner, fille de Théodore Flournoy, a bien connu le médium, c'est Elise Müller qui aurait probablement choisi elle-même son pseudonyme, prénom compris." (O. Flournoy, Théodore et Léopold)
Ce nom supposé d'Hélène Smith, dans son anonymat à la Dupont, on ne sait, du reste, si c'est le nom d'un médium ou celui d'une création falote et éphémère, personnalité secondaire déguisée en esprit désincarné. Hélène Smith est cousine des Katie King, des Yolanda et autres créations ectoplasmiques et fantomatiques, actrices trébuchantes d'une surnaturelle mascarade.
O. Flournoy fait remarquer dans son livre qu'Hélène est le prénom de la fille de Théodore Flournoy. Il y aurait donc une sorte d'adoption fantasmatique et presque une paternité, le médium incarnant une fille qu'elle aurait fantasmatiquement donnée à Théodore.
Enfin, nous est-il permis de soupçonner dans le choix onomastique l'influence possible de Joseph Smith, fondateur de l'église mormone, et d'Hélène Keller, sourde-muette-aveugle américaine, alors fort en vogue, à qui des prodiges de pédagogie et de psychologie avaient permis de communiquer avec son entourage? Hélène n'est-elle pas sourde et aveugle, à deux mondes alternativement, puisqu'à l'état de veille, elle ignore les merveilles de l'au-delà, et qu'en transe ou en demi-transe, elle perd contact avec la réalité?
la clairvoyante délirante
au nom merveilleux
Le pseudonyme de "la clairvoyante délirante au nom merveilleux" comme dit Lacan (Acte psychanalytique, sém. du 22 nov. 67, cité par M. Cifali, Des Indes, Seuil, 1983), cristallise les équivoques de la relation Hélène-Flournoy.
Cependant, on a beaucoup bâti, et hâtivement, sur des prémices incertaines, de sorte que le baptême d'Hélène Smith est devenu, dans une certaine littérature, son entrée en folie.
Nous versons en cet endroit le commentaire d'une exégète, parce qu'il représente de façon exemplaire, dans sa médiocrité, une certaine vulgate universitaire. Cédant à notre tour à la manie des pseudonymes, nous appellerons pour la circonstance notre exégète Mlle W. et nous tairons notre source.
Quant au médium (note Mlle W.)
"le vedettariat accentua ses tendances mégalomanes et narcissiques. Deux conséquences découlent de ce nouveau statut de star. D'une part, sur le plan matériel, elle bénéficie d'une rente que lui fait une riche Américaine, adepte du spiritisme, ce qui lui permet de cesser à jamais tout travail salarié. D'autre part, sur le plan de son identité (et l'on sait à quel point le nom est une composante importante de la personnalité), elle assimile complètement le pseudonyme que lui a donné Flournoy pour protéger sa vie privée. Pour le grand public, elle est Hélène Smith et non pas Elise Müller et, étant donné l'importance que se donne le personnage public, on peut dire qu'en la nommant Flournoy l'a littéralement créée. Déjà encline au dédoublement de personnalité, elle se vivra désormais sous une double identité. Non seulement toutes ses productions ultérieures (peintures, dessins, poèmes), mais même sa correspondance avec ses intimes sont signés tantôt Hélène Smith, tantôt Elise Müller, tantôt des deux noms unis par un trait d'union. Quand Flournoy adresse une lettre à Elise Müller, c'est Hélène Smith qui répond."
On découvre ici un auteur décidé à détecter du symptôme, et qui feint de croire que l'abandon d'un travail salarié pour une existence de rentière ait un effet destabilisant. Aux yeux de notre universitaire, la posture de demoiselle de commerce dans la maison Badan (car tel est le métier d'Hélène; elle finit chef de rayon), est un gage d'équilibre mental - sinon un sort enviable.
Flournoy, moins niais que notre moderne exégète, proteste dans une note infrapaginale de Des Indes contre la" barbarie" de ces maisons de commerce d'où est "bannie toute notion d'humanité" et où les malheureuses sont contraintes de rester debout onze heures par jour, "et exposées aux foudres de l'honorable patron pour chaque instant de repos pris à la dérobée et par contrebande sur quelque méchant escabeau." Il mentionne un peu plus loin, tout en vantant la robustesse de la bête, que Mlle Smith souffre de dysménorrhée et qu'elle a connu une phase de ménorrhagie et d'affaiblissement général, nécessitant un repos complet de six mois, à la suite d'une période de surmenage où elle dut "travailler debout à son magasin encore plus que de coutume".
Que la médiumnité de Mlle Smith fut pour Catherine-Elise Müller une façon d'échapper à son esclavage, grâce à la munificence de la "riche américaine" (qui s'appelait Mrs. Jackson) et qu'elle lui conféra célébrité, honneur (au moins dans le milieu spirite) et richesse, ce sont des faits. Rajouter là-dessus un prêchi-prêcha ésotérique, à base de psychanalyse de bidet, sur les vertus thérapeutiques du salariat, nous paraît plus symptomatique des contradictions de notre exégète que du cas d'Hélène Smith.
Et que dire de la deuxième partie de la citation de Mlle W., estimant que le clivage de la personnalité d'Hélène s'aggrave une fois qu'elle est débarrassée de la nécessité de travailler dans son magasin - et donnant pour preuve que notre genevoise "assimile complètement son pseudonyme" et va vivre "sous une double identité" (les deux assertions sont contradictoires, soit dit en passant!), signant ses productions littéraires et artistiques, peintures, dessins, poèmes, Hélène Smith (c'est inexact, en ce qui concerne les toiles) et sa correspondance tantôt Hélène Smith, tantôt Elise Müller, tantôt des deux noms réunis?
Que dire, en effet, sinon qu'on nous propose ici un nouvel exemple de psychanalyse de pochette-surprise dont la leçon est clairement, "cette pauvre fille, ayant échappé au psychiatre, ne pouvait que finir délirante."
Or, n'en déplaise à notre exégète, la fin des soins de Flournoy n'a pu précipiter la désagrégation mentale d'Hélène pour l'excellente raison que Flournoy n'a jamais soigné Hélène Smith. Sauf à admettre que le psychologue qui fait courir un rat dans un labyrinthe est en train de le soigner.
Enfin, cette preuve par neuf de la folie, invoquée à travers tout le passage - l'usage du nom de fantaisie, pour parler comme le Code civil (car il ne s'agit de rien d'autre), que démontre-t-elle sinon la persistance, chez notre pétulante exégète, d'un préjugé petit bourgeois? - Quelqu'un qui vit sous un nom inventé, fût-il peintre et médium, doit être plus ou moins fou. Et là-dessus, pour étayer, Mlle W. fait allusion au "dédoublement de personnalité" (notion un tantinet désuète à la fin du vingtième siècle, réveillée évidemment par les théories des personnalités secondaires de Flournoy). En somme, notre commentatrice exprime banalement la frousse bien connue de sa classe sociale devant l'utilisation d'un pseudonyme.
Hélène ne fraude pas
Flournoy, ayant lavé son médium de l'accusation de déséquilibre, doit encore l'innocenter du soupçon de simulation. Il n'y réussit pas complètement, puisqu'il se verra contraint de revenir à charge dans les Nouvelles Observations, et qu'il se sera fendu entre-temps d'un billet à une gazette locale pour corriger la maladresse d'un reporter qui parle d'actrice habile et de rôles préparés.
Certes, la tentation est grande de rejeter en bloc les merveilles de la conscience subliminale et de faire des médiums de purs simulateurs. Cela n'a jamais été le point de vue de Flournoy et il partage avec les spirites la conviction de la sincérité du médium et de la véracité de la transe. Mais où les spirites voient des esprits et des vies antérieures, Flournoy distingue une personnalité secondaire d'Hélène.
Par contre, pour les médiums de moindre calibre, dont l'examen par Flournoy, échelonné au cours des années, sera rassemblé dans Esprits et médiums, le lecteur est parfois dominé malgré lui par l'impression que le médium est un simple fraudeur et que si Flournoy voit de l'automatisme dans ses prouesses, c'est par tact, par bonnes manières, et (un tout petit peu) par esprit de système. Tel examen par Flournoy d'un cas de cryptomnésie, (c'est à dire de mémoire enfouie - en l'espèce celle d'un roman lu jadis) paraît sujet à caution. Tout incline le lecteur moderne à penser que l'insoupçonnable sujet à cryptomnésie s'est rendu coupable d'un anodin plagiat. Il est impossible de trancher la question. Contrairement à l'idée vulgaire, le plagiat est la chose du monde la plus difficile à établir, sauf le cas du recopiage pur et simple. De plus, ces rapprochements littéraires rappellent immanquablement la méthode de Jarry démontrant que Toomai des éléphants de Kipling a donné le conte Petit-Louis de Georges d'Esparbès, par le jeu des associations d'idées. Autrement dit: tout conte mettant en scène un "petit tambour" doit revenir par association d'idée à Toomai des éléphants.
La longue étude des stigmates cataleptiques d'Hélène intrancée, des contractures, de l'anesthésie, de l'allochirie (inversion de la gauche et de la droite), du champ visuel réduit, n'a pas d'autre but que de démontrer qu'elle est une authentique automatiste.
La question de la fraude est en réalité de peu d'intérêt. Elle cède à celle de la suggestion.
II. LA DEMOISELLE DE MAGASIN ET LE DISCIPLE DE MESMER
En décrivant les signes du somnambulisme, ou de la catalepsie chez Hélène, Flournoy fait son petit Charcot, son petit Binet ou son petit Pierre Janet. Il montre qu'Hélène présente les mêmes signes d'insensibilité que les hystériques ou les hypnotisées.
C'est tout le sens de sa dramatique intervention initiale. Les spirites autour d'Hélène, avant l'arrivée de Flournoy, n'avaient pas vu qu'elle était somnambule. Parce qu'elle avait les yeux ouverts, ils ont cru qu'elle était éveillée. Flournoy, petit Sherlock Holmes de la science, la pince pour se persuader qu'elle dort. Il est le seul autour du guéridon, à comprendre la véritable signification de la cérémonie nocturne. On se représente notre homme déclarant dramatiquement à son auditoire médusé: "J'affirme que cette femme est en état d'hémisomnambulisme."
Hélène, qui connaît, à partir de l'intervention de Flournoy, la transe complète avec amnésie, produit la réaction qu'on attend d'elle. L'amnésie est en effet inséparable de ce que Janet appelle l'automatisme total. Même si Hélène ignore Janet, elle sait ce qu'est le somnambulisme et que les somnambules ne se souviennent pas de leurs déambulations nocturnes. Il y a là moins une question de vocabulaire que de bon sens. Si les phénomènes échappent à la conscience du médium, le médium ne peut pas en garder de souvenir.
Comme pour dédommager Hélène de l'oubli des grandes séances, les phases d'hémisomnambulisme fleurissent hors séance. Les hallucinations spontanées, les intrancements, les irruptions des personnalités secondaires, Léopold ou les incarnations antérieures, apparaissent au lever et au coucher, dans les phases de demi-éveil, ou même au bureau, dans des instants de rêverie, de vacance de l'esprit.
Ce n'est pas diminuer le mérite de notre psychologue que de dire qu'il arrive un peu tard. Il n'y a plus grand chose, en 1894, à ajouter aux études classiques de l'hystérie. Comme Flournoy en convient lui-même, il serait temps que la psychologie s'occupe de sujets sains.
Il n'y a pas grand chose non plus à ajouter aux études sur l'hypnose. Or Flournoy se comporte, selon le mot d' E. Roudinesco (La Bataille de cent ans) comme un mesmériste à l'ancienne mode.
C'est précisément la prépondérance de la suggestion qui confère aux séances Smith leur tonalité particulière.
Dans les grandes séances (médiumniques), le médium intrancé répond à une personne de l'assistance. Le plus souvent, cette personne n'est autre que Flournoy "qui se trouve donc, de fait, dans la même relation qu'un hypnotiseur vis-à-vis de son sujet".
Flournoy confesse que le cycle martien, l'invention de la langue martienne et de l'ultra martien sont des réponses à ses suggestions. Il admet que le roman hindou est en partie inspiré par une flamme du subliminal d'Hélène pour lui.
Mais, si Flournoy admet qu'il a une influence sur les productions somnambuliques, le roué a une façon d'avouer qui contraint son lecteur à s'écrier "vous nous en faites accroire"; il avoue et, quelques pages plus loin, il s'excuse de s'attribuer un rôle aussi important.
Si, au lieu du livre de Flournoy, on lit les comptes-rendus de séance tenus par Auguste Lemaître, nous avons aussitôt une impression toute autre de la nature de ces séances.
"Est-ce que mademoiselle voit un homme? Oui. - Un homme connu de M. Flournoy? Non. - L'a-t-elle déjà vu dans la vision bouddhique de la semaine dernière? Oui. - Est-ce une antériorité de monsieur Flournoy? Oui. - Est-ce une antériorité lointaine datant de plusieurs siècles? Non. - Est-elle de ce siècle? - Non. - du siècle dernier? Réponse indécise. - Mademoiselle pourrait-elle écrire? Non. Et la table dicte: Patience! - Est-ce que mademoiselle incarne la veuve hindoue de la vision de l'autre jour? Oui. - Cette veuve est-elle l'antériorité d'une personne connue? Oui. - Ici présente? Réponse indécise et de nouveau la table dicte: Patience. M. Flournoy: - Cette veuve hindoue, vit-elle maintenant? Oui - Est-ce ma femme? Pas de réponse. - Etais-je prêtre? Non. - Prince? Oui (énergique)." (Archives privées des descendants d'Auguste Lemaître, Cahier n. 1, p. 38-39, cité par Mireille Cifali, in Des Indes à la planète Mars, Seuil, 1983)
Le psychologue donne à Hélène des suggestions post-hypnotiques, dans lesquelles, le sujet, revenu à l'état de veille, accomplit malgré lui un ordre donné sous hypnose, d'où des scènes burlesques et même désopilantes. Il faut bien rire un peu.
Le mot suggestion vient chez Flournoy à égalité chez lui avec celui de somnambulisme ou de transe.* Avec les autres auteurs, il compare la transe médiumnique au sommeil hypnotique. Et de conclure que le médium est dans un état d'auto-hypnose. Flournoy n'hypnotise pas Hélène, mais il suggestionne un sujet somnambule qui s'est mis lui-même en état de transe, ce qui revient au même.**
* Flournoy utilise l'orthographe anglaise, trance, d'après Myers. Nous conservons l'orthographe française.
** Des médecins aux chercheurs psychiques tout le monde est partisan de l'hypnose. Les grands noms de la métapsychique, les Richet, les de Rochas, les Lombroso, les Boirac, sont des grands noms de l'hypnose.
L'hypnose est le pont qui permet de passer du symptôme à la merveille, ainsi que l'illustrent parfaitement Ochorowicz et Mlle Tomczyk. Venue le consulter pour des troubles mentaux, Stanislawa Tomczyk accepte de se faire hypnotiser par notre philosophe polonais. Elle manifeste, sous hypnose, des facultés médianimiques. Ochorowicz est tellement passionné qu'il décide de l'étudier et de l'"entraîner" pour observer les étapes de son développement médiumnique. Mlle Tomczyk habita plusieurs années chez Ochorowiz. Le résultat fut qu'il produisit une nouvelle Eusapia, qui, sur certains points, dépassa, paraît-il, la première. Elle ne fut jamais une professionnelle.
Hereward Carrington invita Ochorowicz avec Stanislawa aux Etats Unis. Le Polonais déclina, arguant de la défaite d'Eusapia et craignant sans doute semblable mésaventure pour Mlle Tomczyk. La faute aux savants américains, bien entendu, à leur mauvaise foi et à leur façon de désespérer le médium.
Les chercheurs en sciences psychiques, les spirites eux-mêmes, n'ont cessé d'insister sur la suggestibilité de leurs médiums. Pour les spirites, la suggestion explique commodément nombre de messages erronés provenus de soi-disant esprits, mais souhaités par un assistant, et pour les chercheurs psychistes, elle explique nombre de fraudes dans des phénomènes physiques. Eusapia, sitôt qu'on lui réclame un miracle, se hâte de le produire, par magie ou par fraude.
L'ensemble de la séance est une réponse à la suggestion de l'assistance, assoiffée de merveilles ou de contacts posthumes.
Flournoy note cependant au chapitre quatre de Des Indes qu'"Hélène n'a jamais été hypnotisée ni magnétisée", qu'elle répugne à se laisser endormir.
C'est, d'abord, qu'il juge légitime, dans une optique de psychologie expérimentale, de se livrer à des expériences. Il pourrait reprendre à son compte la préface de L'Automatisme psychologique, où Janet laisse entendre qu'il est plus simple de passer par des sujets hystériques, qu'on suggestionne, que d'opérer comme Moreau de Tours qui avait recours au hashish pour produire une "folie artificielle".
Ensuite, Flournoy estime par une sorte de syllogisme que puisque Hélène, en état de somnambulisme, est suggestible, il est légitime de la suggestionner.
Enfin, encore qu'il ne soit jamais question, sous la plume de Flournoy, de soigner Hélène, on est obligé de supposer que le psychologue garde à l'esprit, plus ou moins confusément, la méthode cathartique et les guérisons miraculeuses des magnétiseurs et des hypnotiseurs, et semble admettre implicitement que si ses suggestions ne guérissent pas le médium - dont la santé est parfaite, à l'en croire - du moins, elles ne peuvent lui faire de mal.
hypnotisme de caf'-conc'
Flournoy observe que s'il pousse trop loin la suggestion ("si l'on continue trop longtemps à expérimenter sur Hélène et à la questionner"), les visions originales n'apparaissent pas, mais sont remplacées par les classiques de l'hypnotisme de café-concert: médium fasciné par un objet brillant, extatique, furieux, humant des fleurs imaginaires, etc.
Cela tourne parfois à la bouffonnerie. Dans les séances Marie-Antoinette, en particulier, où tout le monde s'amuse bien, on se demande si Hélène est réellement dans un état second. Transe est plutôt ici excuse, permission.
Rien ne révèle mieux, à nos yeux modernes, les rapports du psychologue et de l'hystérique que la photographie publiée par O. Flournoy, dans Théodore et Léopold, qui montre Hélène au pied de Flournoy, dans la maison de celui-ci, à Florissant, pendant une séance.
Parce que le psychologue porte un costume qui pourrait être moderne (veston court et pantalon), alors qu'Hélène, en robe noire, paraît "d'époque", il semble voir une photo de plateau. Hélène serait l'actrice, causant, entre deux plans, avec Flournoy, le metteur en scène, assis sur son pliant.
En réalité, à examiner la photo attentivement, Hélène n'est pas "entre deux plans", mais en transe, d'où son air extatique, tandis qu'elle regarde sans le voir un crayon (?) qu'elle tient en l'air. Hélène est, selon nos canons, qui ne sont pas forcément ceux de la fin du 19ème siècle, une très jolie femme.
Une autre preuve, négative celle-là, de l'influence de Flournoy, est donnée par les petites séances. A côté des grandes séances, il y a les petites séances, où la transe est moins profonde, de plus courte durée, et où le médium se réveille plus vite. Sous le luxe de détail sur les contractures du médium, sa résistance à la douleur ou son allochirie, Flournoy dissimule que les petites séances se font le plus souvent... sans lui.
"Mes pensées ne sont pas
tes pensées, et tes volontés
ne sont pas les miennes"
La rivalité de Théodore et de Léopold, l'esprit-guide d'Hélène, est réelle. Il y a, chez notre psychologue, un agacement non dissimulé, aggravé par ce secret de polichinelle que Flournoy n'arrive décidément pas à garder: Léopold n'est qu'une personnalité secondaire du médium, autrement dit un nom mis sur frein, sur une réticence, sur un mauvais prétexte ou un mauvais-vouloir.
La rivalité Léopold-Théodore est précisément la rivalité de deux hypnotiseurs. Léopold est la réponse d'Hélène à Flournoy.
Léopold, en effet, n'est autre que Joseph Balsamo. Le célèbre comte de Cagliostro s'était déjà manifesté à M. et Mme Badel, un couple de spirites genevois aux séances de qui Hélène était invitée; comme le rappelle Flournoy, le roman de Dumas "a redoré son blason d'hypnotiseur avant la lettre".
Léopold est aussi la personnification de ce que nous appellerions aujourd'hui le sur-moi du médium. Flournoy parle de "quintessence des ressorts les plus cachés de l'organisme psycho-physiologique. Il jaillit [ajoute-t-il] de cette sphère profonde et mystérieuse où plongent les dernières racines de notre être individuel, par où nous tenons à l'espèce elle-même et peut-être à l'absolu, et d'où sourdent confusément nos instincts de conservation physique et morale, nos sentiments relatifs aux sexes, la pudeur de l'âme et celle des sens, tout ce qu'il y a de plus obscur, de plus intime et de moins raisonné dans l'individu. Quand Hélène se trouve dans un milieu, je ne dirai pas dangereux, mais où elle risque simplement, comme dans le groupe N., de se laisser aller à quelque inclination contraire à ses aspirations fondamentales, c'est alors que Léopold surgit soudain, parlant en maître, revendiquant la possession du médium tout pour lui, et ne voulant qu'elle s'attache à quelqu'un ici-bas."
Théodore contre Léopold, c'est un magnétiseur à la Swengali contre le sur-moi d'Hélène. On ne peut d'ailleurs qu'être frappé, avec Flournoy, de ce que le ton habituel de Léopold ressemble furieusement à celui d'Hélène quand elle est dans sa veine sentencieuse, moralisatrice et exhortatrice.
Le combat avec Léopold est suffisamment âpre pour que Théodore perde un tantinet ses repères. Il finit par parler de Léopold comme d'une personne réelle.
Il est vrai que, pendant les transes, l'autre est là pour ainsi dire en direct; que lors des accès d'hémisomnambulisme, il se pose un peu là - tandis que les incarnations martiennes, royales ou hindoues sont beaucoup plus ténues, plus flottantes et surtout restent attachées à demi à leur temps et leur décor, gracieuses images du passé ou de lointaines planètes.
Le conflit entre l'hypnotiseur et l'auto-hypnotisée est congrûment résumé par cette communication, en date 21 avril 1895, adressée par le célèbre thaumaturge au psychologue.
"Mes pensées ne sont pas tes pensées, et tes volontés ne sont pas les miennes, ami Flournoy. Léopold." *
* Par une surabondance de sens, un lapsus d'Hélène lui a fait écrire "mes volontés".
suggestibilité et susceptibilité
Devant cette prépondérance de la suggestion, on décèle parfois chez Flournoy un certain embarras.
Le seize octobre 1896, il revint à charge, pour la persuader que son martien était du français déguisé, auprès d'une Mlle Smith "qui paraissait être dans la plénitude de son état normal". Une note en bas de page précise: "La suite prouve bien que ce n'était qu'une apparence, et qu'en réalité Hélène se trouvait encore dans l'état de suggestibilité qui se prolonge plus ou moins longtemps après les séances, et qui ne prend peut-être jamais fin avant le sommeil de la nuit."
La preuve de l'état de suggestibilité, c'est, on l'a deviné, qu'Hélène va modifier son martien pour tenir compte des observations de Flournoy, ce qui nous vaudra l'ultramartien puis les autres langues planétaires.
Mais tout le passage est curieux. On se demande pourquoi Flournoy s'est assuré de parler à une Mlle Smith en possession de ses moyens puisque son but, il l'annonçait en début de chapitre, était de bousculer les séances de martien, parce qu'il "commençai[t] à en avoir assez". En parler à une Mlle Smith lucide était-il le moyen le plus efficace de toucher son subliminal et n'eût-il pas mieux valu faire la critique à Hélène intrancée?
(Et à l'inverse, puisque Flournoy croit, avec Myers, à une porosité de la membrane qui sépare le supraliminal du subliminal, et sait atteindre au moins partiellement le moi profond en parlant au médium réveillé, quel besoin de préciser que ce médium lui a si bien obéi parce qu'il était encore dans une demi-transe?)
Cette incohérence nous révèle peut-être un Flournoy honteux de "suggestionner son médium" - y compris à l'état de veille. Ce qui ne l'empêche pas de noter ailleurs, avec un accent de triomphe: "Ce résultat [l'invention de l'ultramartien, suite aux reproches adressés au martien] corrobore avec éclat l'idée que tout le cycle martien n'est qu'un produit de suggestion et d'autosuggestion."
Flournoy écrit après la rupture qu'il n'est pas bon qu'un même expérimentateur étudie un médium trop longtemps, comme on fait généralement en sciences psychiques "parce que ce dernier, malgré ses précautions, finit inévitablement par façonner la subconscience si suggestible de son sujet et par lui imprimer des plis de plus en plus persistants, qui s'opposent à tout élargissement possible de la sphère d'où jaillissent les automatismes." Il craint même l'"ankylose psychologique" du médium. (Nouvelles Observations.)
C'est, au-delà de la blessure d'amour-propre, une tardive prise de conscience de l'impasse méthodologique de Flournoy.
III. LES AMANTS ROYAUX
OU
LA MEPRISE SENTIMENTALE
Tout dans l'histoire de Théodore Flournoy et de la femme qu'il baptisa, ou qui se baptisa, Hélène Smith renvoie à la complicité ou, si l'on veut, à la séduction.
On se demande pourquoi le médium se prête si complaisamment aux ordres de Flournoy, et si l'hypnotiseur n'est pas à son tour fasciné par son sujet.
La séance est suspecte, et jusqu'aux productions oniriques qui sont pour Flournoy ce que le médium produit de plus personnel.
Tout médium produit des phénomènes pour un cercle de savants, de croyants, de curieux. Mais, chez Flournoy et Hélène, les merveilles supposent toute une incubation subconsciente, et pour tout dire la préparation d'un véritable spectacle, avec ses pièces de résistance. C'est une chose inouïe en médiumnité qu'un tel travail de préparation.
Il est à craindre évidemment que ces déploiements de subconscience n'aient quelque effet néfaste pour le médium.
Et d'abord sur le plan de la dépense nerveuse. "Mais les séances qui ont été trop longues ou mouvementées, écrit Flournoy, lui laissent une grande fatigue pour le reste du jour." Et encore: "Il lui est même souvent arrivé de rentrer dans le somnambulisme (dont elle n'était probablement pas complètement sortie) au cours de la soirée ou en retournant à la maison, et de ne recouvrer son état parfaitement normal qu'à la faveur du sommeil de la nuit."
Et, deuxièmement, du point de vue de la psychopathologie, n'y a-t-il pas quelque péril pour Hélène à marcher ainsi aux frontières du réel et du rêve, de la vie et de la mort?
Rien ne s'oppose en principe à une récupération "positive" des facultés médiumniques, vers quoi Flournoy lui-même semble lorgner, une sorte de religion médiumnique scientifique. Aussi longtemps que le couple Flournoy-Hélène vit dans l'entente, ils trouvent dans cet échange des satisfactions mutuelles. Il y a même, chez Flournoy, une admiration amoureuse, qui n'est évidemment pas séparable de la production rêverique d'Hélène. Ce que Flournoy, tout à l'heure, décrira avec agacement, l'infantilisme du subliminal d'Hélène, le caractère frauduleux des manifestations, c'est précisément ce qui d'abord l'attachait au médium.
le jeu de la séduction
S'il n'y a pas séduction effective, on est du moins dans une situation qui mime la séduction.
Dans Des Indes, Flournoy, sachant qu'il va heurter, dans son étude, les convictions de son médium, en fait pour se faire pardonner, un portrait flatté et quasi-amoureux.
Il n'est pas jusqu'aux réticences de Flournoy qui ne trahissent son inclination. Il fait, devant les phénomènes, la petite bouche, trouve tout cela joli, mais un peu lassant à la longue. On distingue derrière cet agacement, l'amoureux qui se dédit, qui a compris le petit jeu de sa belle et qui n'y coupe plus.
Le livre de Flournoy sent parfois la buanderie, c'est à dire qu'il lave son linge sale devant nous. Hélène lui en fait voir de grises.
Flournoy est d'une timidité d'adolescent lorsqu'il en vient à l'aveu de son idylle avec le médium. Il devient pédant, donne des citations granitiques de Sigmund Freud, parle de lui-même à la troisième personne, et s'attribue une initiale, c'est-à-dire qu'il se dédouble, lui aussi, comme le médium s'est dédoublé, pour pouvoir confesser son inclination.
Dans les Nouvelles Observations, et surtout dans la correspondance publiée dans Théodore et Léopold, Flournoy et Hélène sont brouillés, échangent des aigreurs, puis, là-dessus, ont des retours de flamme, des crises d'attendrissement, avant de reprendre la mouche.
On fera certainement quelque jour un livre d'histoire révisionniste sur Flournoy et Hélène Smith, qui prétendra apporter les preuves de la liaison. Mais cette hypothèse, dénuée de fondement, nous paraît avant tout dénuée de sens. Le cas de Flournoy et d'Hélène Smith illustre parfaitement la pente des amourettes de médiums qui est celle de l'angélisme. Les amours spirites sont chastes et sublimes, elles se perdent dans les merveilles de l'au-delà, des planètes et des incarnations.
Flournoy et la psychanalyse
Quelle est la place Flournoy dans la préhistoire de la psychanalyse?
Son intérêt pour le spiritisme, pour l'hypnose, l'aspect vaguement scandaleux de l'affaire Hélène Smith, ont valu à Flournoy une durable défaveur. Mais, après une longue éclipse, il fut remis au jour, avec les précurseurs de Freud, comme le père putatif de l'inconscient, l'homme qui a failli inventer la psychanalyse.
Vision simpliste, puisque l'idée d'inconscient, à ce temps-là, ne se portait pas mal; Flournoy adopte, on l'a vu, la conception de Myers, celle du moi subliminal.
A considérer rétrospectivement les théories des psychologues, on trouve effectivement Flournoy plus proche de Freud que (par exemple) Janet, Charcot, - et a fortiori que les psychistes anglais ou les métapsychistes continentaux. Du coup, décrire en Flournoy l'homme qui a "raté le coche", l'homme qui a failli être Freud, en s'aidant par exemple de la citation que nous donnions plus haut sur la "quintessence des ressorts les plus cachés de l'organisme psycho-physiologique", en déduire qu'il ne lui manquait, pour inventer la psychanalyse, que la découverte de la libido ou du refoulement ou de la "vertu curative du contre-transfert" (comme l'écrit René Louis dans un numéro de la revue Autrement) est tentant.
Mais en réalité, des idées pré-freudiennes, on ne trouve sous la plume de Flournoy que celles que celui-ci, lecteur scrupuleux et omnivore, a pu emprunter au maître viennois.
Flournoy, en faisant démarrer Léopold dans la "sphère psycho-sexuelle" du médium, nous offre un pastiche du "Freud d'avant Freud", où les états hypnoïdes commencent à sous-tendre des préoccupations sexuelles. Puis il passe outre. Ayant vu en Léopold une incarnation des défenses morales d'Hélène, il recourt à la thèse contemporaine de l'accumulation de tendances coupées du sujet, agrégées en une personnalité secondaire (Morton Prince).
la recherche du père
Du point de vue d'un freudien, Flournoy commet une double bévue:
-D'abord, il méconnaît la sexualité et, en tous cas, l'attirance qu'il exerce sur son médium, attirance partagée.
-Ensuite, il méconnaît la névrose chez Hélène, quitte à trouver ses manifestations pittoresques - ou au contraire à s'indigner de leur enfantillage.
On devine ce qu'O. Flournoy, le petit fils de notre Flournoy, psychanalyste de son état, va tirer des livres de son grand père. Séduction, libido, transfert, contre-transfert sont au menu, sans compter le roman familial, le père d'Hélène (grand absent des livres de Flournoy, en effet; l'affaire Smith paraît fabriquée à dessein et semble appeler ces révélations freudiennes), et plus précisément la langue du père (le magyar, réapparaissant dans le martien) et les voyages du père (non de la planète Mars aux Indes, mais du moins de Hongrie en Algérie, c'est à dire - selon les conceptions du temps et nonobstant le mouvement apparent du soleil - en "orient").
Le double reproche rétrospectif de la psychanalyse à Flournoy repose une fois encore sur l'idée implicite que Flournoy est un proto-Freud, un quasi-Freud ou un pseudo-Freud, pour ensuite, et en toute contradiction, lui reprocher ses manques par rapport à la psychanalyse, le principal étant l'inobservance de ce "pas touche!" progressivement dégagé par Freud, et qui conduisit au cérémonial de la séance psychanalytique, qui jusqu'à nos jours impressionne tant le bon peuple, le patient sur le divan, le thérapeute assis derrière lui, hors de sa vue. Flournoy, avec sa manie de s'installer au milieu de la séance, et de tripoter son médium paraît presque libidineux.
Flournoy n'est pas le benêt qu'on a voulu peindre. L'ami Claparède défendra notre psychologue dans sa nécrologie [Archives de psychologie, XVIII, 1923]. Flournoy, ni bigle ni obtus, avait parfaitement vu que le médium en pinçait pour lui, mais n'en a rien dit, par délicatesse, ce qui nous a malheureusement privé d'une belle étude sur les aspects psycho-sexuels de la médiumnité d'Hélène.
Et pour ce qui le concerne, Flournoy sait parfaitement ce qui se joue en lui. Il en fait péniblement le pénible aveu.
Même son de cloche chez Ellenberger (The Discovery of the unconscious). Flournoy a compris la notion de transfert.
le cahier bleu
ou
les enfants cachés
Olivier Flournoy fait très justement observer qu'il y a quatre personnes en jeu: les adultes Théodore et Hélène et les enfants qu'ils cachent, eux aussi fascinés l'un par l'autre.
On peut verser à l'appui la vision hindouiste enfantine du 10 sept. 1899 (Nouvelles Observations) où la petite Hélène-Simandini feuillette un cahier bleu de vues d'orient, en présence d'un enfant qui est déjà son futur fiancé hindou. Scène clé parce qu'elle est, selon Flournoy, le ressouvenir d'une expérience de la petite enfance d'une Simandini, ou plutôt d'une Hélène, âgée d'à eu près cinq ans - tandis que Sivrouka aurait, dans la vision, une douzaine d'années.
Cette scène enfantine, transportée à Genève et non en Arabie ou en Inde, n'est-elle point précisément la genèse du roman hindou? Flournoy le croit.
Et voici le coup de théâtre, Flournoy se demande s'il ne serait pas lui, Théodore Flournoy, le petit garçon de douze ans de la vision (les familles se connaissaient et la petite Hélène a parfaitement pu rencontrer le jeune Flournoy). Auquel cas le transfert s'explique par des voies normales, encore que "subliminales". En "reconnaissant", en état de transe, Sivrouka dans Théodore, Hélène reconnaîtrait effectivement le petit garçon qui est venu chez elle le jour où elle a feuilleté le fameux cahier bleu, départ du roman hindou.
Hâtons-nous de dire que cette hypothèse, impossible à vérifier, représente plutôt une création fantasmatique de Flournoy, une tentative de généalogie, une révélation concernant le passé pour expliquer le présent; c'est, en somme, un fantasme de Flournoy pour expliquer le fantasme d'Hélène.
L'utilité immédiate de cette élaboration est d'éliminer l'hypothèse de la séduction ou même de l'infatuation. Hélène-Simandini n'est pas tombée amoureuse de Flournoy-Sivrouka mais, simplement, en état de somnambulisme, elle a reconnu dans l'adulte l'enfant qu'elle avait associé au feuilletage du cahier bleu et aussitôt paré de couleurs orientales, dans ce qui était peut-être une flamme enfantine mais plus probablement un rêve éveillé.
Cas de cryptomnésie, de mémoire cachée, associée à un prodigieux déploiement d'automatisme - la fabrication en quelque sorte instantanée d'un roman à l'eau de rose intégrant le petit visiteur de douze ans.
La "scène du cahier bleu", scène initiale, fonde les rapports entre Hélène et Théodore, par-delà les merveilles spirites ou subliminales, dans un passé commun, une première rencontre, un premier coup de pouce du destin, et les fait passer, selon une structure canonique, dans la catégorie des amours célèbres.
Flournoy à la puissance deux
L'histoire du cahier bleu, livrée par un auteur qui écrit en courant ses Nouvelles Observations et surveille moins sa plume, nous donne, non l'aboutissement, mais une sorte de concentré de la théorie de Flournoy, une limite, une exagération, un Flournoy au carré.
Au centre de son système, il y a l'enfance; le subliminal est infantile. Il n'est que la survivance de l'enfance. Il est un vieil enfant momifié, enkysté dans l'esprit d'un adulte.
Ensuite, Flournoy tire à l'extrême l'idée de la réminiscence, de la cryptomnésie. Une demi-heure calme d'un dimanche après-midi vieux de vingt cinq ans, passée à feuilleter un album de photos, fonde, après incubation, un roman subliminal.
Enfin, selon lui, la puissance d'imagination du subliminal est prodigieuse et sa vitesse de réaction extrême.
Il y a, chez Flournoy, toute une théorie sous-jacente de la vitesse de travail du subliminal. Des Indes contient une sorte de journal des progrès de l'imagination d'Hélène, à partir des suggestions de Flournoy. Les estimations sont largement conjecturales, car le psychologue n'a jamais la preuve que telle de ses phrases fut effectivement le déclencheur d'un nouveau cycle ou la cause de l'orientation nouvelle d'un cycle ancien.
Il faut du temps pour que le subliminal d'Hélène Smith élabore un nouveau cycle. Mais certaines créations subliminales semblent instantanées, comme le montre l'histoire du cahier bleu. Les créations anciennes sont, elles aussi, remises à jour en un éclair, la version nouvelle, ou contenant un élément nouveau, remplaçant instantanément la précédente, à peu près de la manière dont nous enregistrons un fichier sur un disque d'ordinateur.
Poussant à son degré ultime la notion contemporaine de l'inconscient créateur, Flournoy postule même, c'est le plus curieux de son système, qu'il existe alentour, dans le coin le plus retiré de l'esprit humain, des romans complets, complexes, achevés, des visions et même de vastes fresques, dont les porteurs ne sont pas conscients, parce qu'ils n'ont pas la chance d'être des sujets automatistes, et qu'aucun psychologue ne mettra jamais en lumière.
Il existerait, à jamais enfouie sous les sables de l'esprit humain, une littérature (ou une peinture) fantastique qui restera inconnue.
Combien de visions et de récits nous demeurent étrangers, plus inaccessibles, dans nos subconsciences, que s'ils appartenaient à la plus lointaine planète; combien de chefs-d'oeuvre ignorés habitent les cervelles d'un enfant ou d'un commis d'épicier, pour un jour s'éteindre avec eux, sans qu'ils aient eu seulement l'intuition - non de ce qu'ils eussent pu peindre ou écrire, mais de ce qu'à leur insu, leur esprit avait déjà achevé!
On sait le parti que tireront les surréalistes de cette idée, prise au pied de la lettre, d'un inconscient réservoir pléthorique d'une admirable littérature. Mais, chez André Breton, le procédé de l'écriture automatique, emprunté aux spirites, est supposé débonder les réservoirs et permettre l'accès instantané à ces productions.*
* Voir André et la métapsychique, The Adamantine, vol. 11, 2nd cahier.
la lettre à Elise
Ce serait mal connaître son monde que de supposer un épilogue pacifique à l'histoire d'Hélène Smith et de Théodore Flournoy.
Il y eut, à partir de Noël 1899, date de la parution de Des Indes, brouille, rupture et toute une série de raccommodements. Puis une révélation finale, tardive, par une femme docteur. La malheureuse Hélène Smith, apprenions-nous, était délirante.
Après la rupture avec Flournoy, l'attitude d'Hélène-Elise est équivoque, comme si, en bonne hystérique, elle décidait de faire payer cher au psychologue une liaison... qu'ils n'ont pas eue.
Le terrain est préparé. Un certain dévergondage d'Hélène Smith, en particulier dans le cycle hindou, a pu donner des doutes sur son honnêteté. Théodore est remonté à l'assaut et répète qu'on n'est pas responsable de son subliminal.
Là-dessus, il semble qu'un malin génie prenne plaisir à glisser sous la plume d'Elise les termes les plus ambigus. Une réponse de notre médium à un article de la Gazette de Lausanne (4 janvier 1902) contient les passages suivants: "Peut-être monsieur Flournoy eût-il été plus galamment inspiré [souligné dans le texte] en évitant dans sa nouvelle brochure de renseigner le lecteur sur des détails intimes"; "Si, après m'être dévouée pour lui pendant cinq ans...."; enfin, cette énormité: "Abusée j'ai pu l'être mais dans un tout autre sens qu'on ne paraît le supposer."
La réponse est insérée dans le journal en date du 7 janvier. Théodore proteste auprès d'Hélène le 9 janvier. "Je regrette que par une accumulation de phrases ambiguës, équivoques, pleines de mystérieux sous-entendus, vous autorisiez les pires suppositions sur mon compte et le vôtre de la part des lecteurs malveillants qui ne font jamais défaut."
Flournoy conclut: "Il faut être prudent et peser ses expressions quand on écrit des lettres aux journaux; et je crains bien que, dans vos cinquante lignes à la Gazette, il n'y ait plus de danger pour votre propre réputation, que dans les cent cinquante pages de ma brochure, et tous les articles que tous les journalistes ont pu vous consacrer depuis deux ans."
La lecture de la correspondance recueillie dans Théodore et Léopold est décevante pour l'admirateur d'Hélène Smith qui a pris pour argent comptant les compliments que Flournoy fait à son médium.
Lisant les petits poulets à la grosse écriture pâteuse d'Hélène-Elise, on découvre une femme assez sotte, assez inculte, quoiqu'elle se pique de belles lettres et de beau langage. Dans les bourdes de la fameuse lettre à la Gazette de Lausanne, il entre autant de maladresse que de passion refoulée. C'est la bêtise qui prépare le terrain, c'est l'inaptitude à s'exprimer simplement, clairement, sans recourir à des joliesses ou des afféteries, qui prépare la bourde. C'est l'obligation qu'on s'est faite de chercher quelque phrase lourde de sens qui met au jour ces énormités, non de façon inopinée, par une irruption fortuite à la faveur d'un relâchement de l'attention, mais de manière quelque sorte délibérée, en tous cas lente et précautionneuse et, pour tout dire, inexorable.
Flournoy fait le mort
Les lettres de Flournoy et d'Hélène furent écrites dans la perspective d'être utilisées et publiées; ce sont presque des "lettres ouvertes", comme on dira plus tard, en tous cas des lettres complètement rédigées (c'est-à-dire qu'elles font l'instruction de l'affaire pour un hypothétique lecteur) et, en dernière analyse, nous pouvons nous bercer de l'illusion que c'est à nous, à un siècle de distance, qu'elles sont destinées.
Flournoy se met à l'abri. A l'en croire, c'est par hasard (et réserve faite de l'histoire du cahier bleu) qu'il s'est trouvé, lui, bombardé réincarnation de Sivrouka, parce qu'il était dans les parages, parce qu'il n'y avait que lui de disponible quand Hélène s'est lancé dans le cycle hindou.
Et de faire la comparaison avec le mort, Alexis Mirbel, promu, quant à lui, martien, parce que sa mère était présente à une séance et désireuse d'évoquer la mémoire de ce fils, au moment précisément où débutait le roman martien.
Il ne faut donc pas supposer, conclut Flournoy, d'intention particulière, mêmes subliminale à la somnambule.
On ne peut se défendre tout à fait de l'idée que Flournoy use de bon sens, dans une situation qui n'en comporte guère.
Même si les ragots sur leur compte vont bon train, Flournoy et Hélène ont du mal à se disputer au sujet d'une liaison imaginaire.
La question financière est de meilleur profit aux querelleurs. Leur correspondance n'a rien à envier sur ce plan à celle d'amoureux ou de fiancés ayant rompu et qui règlent leurs comptes, chaque lettre ne faisant, naturellement et à leur insu, que les enferrer davantage.
Théodore a promis que les bénéfices de Des Indes, si le livre faisait ses frais, iraient à Hélène. Comme entre-temps la spirite américaine Mrs Jackson fait une rente au médium, il se sent délié. Du reste, il a déjà donné une libéralité à son médium longtemps avant que le livre ait gagné un centime. Il se délie pour l'avenir et surtout parce qu'Hélène, chauffée par ses amis, l'accuse de s'être enrichi sur son dos et le met en demeure de bailler finance.
La correspondance ultérieure est de la veine: J'ai bien reçu votre carte postale anonyme et je vous en accuse réception.
Théodore écrit des lettres censées, balancées, argumentées. Elle répond, le plus souvent en volapük, en soupirant, en jurant ses grands dieux et en s'auto-exhortant à la patience.
De brouille en raccommodage, les liens finissent par se distendre. Il y a même une réconciliation tardive et sans revoir, et plutôt sur le mode nostalgique et avec cette constatation implicite que les jeux sont faits - ce qu'on appelle souvent, chez les personnes d'âge mûr, "la sagesse". Nos deux énervés se sont rendus compte que cette histoire fait partie d'eux, et, après tout, que Des Indes est effectivement leur livre à tous deux, celui en tous cas qui assurera leur postérité.
L'histoire s'achève dix ans plus tard sur le rapport d'une femme médecin, venue visiter le médium. Hélène, en transe, se masturbe, possédée par Léopold, et s'exprime comme une femme de la halle.
Rapport dont on ne sait trop que conclure, et qu'O. Flournoy a inséré peut-être à la fin de son livre pour tirer la morale de l'histoire. Après tout, l'état d'Hélène avait empiré. Les troubles dévastateurs d'une névrose non soignée s'étaient tournés en délire érotique. Hélène, à présent, couchait avec son sur-moi.
Flournoy s'est un peu moins occupé de subliminal et un peu plus de Freud (dont il a enseigné les théories à Genève). D'où peut-être cette idée d'envoyer une matrone à Hélène-Elise, pour creuser la question sexuelle chez le médium. La doctoresse (qu'on imagine jeune et peu aguerrie) en eut pour son argent. En témoigne son rapport horrifié et trémulant.
l'argent
Hélène reçoit le 13 octobre 1900 de l'argent d'une riche américaine amatrice de spiritisme, Mme Jackson, et obtient "l'indépendance et la sécurité matérielle [qu'elle] rêvait, consciemment et subconsciemment, depuis tant d'années," note Flournoy agacé (Nouvelles Observations). Hélène est rentière.
Indépendance et sécurité sont aussi ce qu'on obtient par le mariage. Mlle Smith est contrainte de gagner sa vie parce qu'elle est célibataire. Elle ne manque pas de signaler ce célibat devant les attaques de la presse, dans la pure rhétorique de la "faible femme". Dans son cas, le mariage est impossible à cause de l'intransigeance de Léopold. La rente de Mrs Jackson est donc une façon d'installer Hélène dans sa virginité, en lui conférant un statut quasi ecclésiastique, celui d'une prêtresse du spiritisme.
"Heureusement, on ne meurt pas de joie, poursuit notre psychologue (qui ne peut décidément cacher son dépit), surtout quand on possède comme soupape de sûreté aux émotions violentes le bienfaisant canal de dérivation des phénomènes subconscients. Lorsqu'Hélène ayant quitté sa bienfaitrice voulut prendre le tramway pour rejoindre sa mère au plus vite, Léopold lui apparut sur le marche-pied de la voiture, l'empêcha d'y monter, puis, se tenant à son côté gauche tandis que sous sa direction elle allait comme en rêve, à travers les rues populeuses, il la mena malgré elle à son bureau, et la fit sur-le-champ prendre congé de ses chefs dans une scène qu'il ne m'appartient pas de narrer. Ayant ainsi définitivement rompu en quelques minutes avec un passé de vingt ans, Hélène put rentrer chez elle et conter l'aventure à sa mère." (Nouvelles Observations)
Dès ce moment, la question est tranchée. Hélène se rend aux spirites (qui affluent chez elle depuis le livre de Flournoy). L'ayant libérée de tout souci matériel, les croyants la transforment en pythonisse.
Le cycle des peintures
De la planète Mars en Terre sainte
En juillet 19O7, Auguste Lemaître, qui est toujours professeur au Collège de Genève, publie dans les Archives de Psychologie, la revue de Flournoy, une nouvelle étude sur Hélène Smith, sous le titre Un Nouveau Cycle somnambulique de Mlle Smith, Ses Peintures religieuses.
Etude complétée en 1923 par De La Planète Mars en terre sainte, livre de W. Déonna, conservateur du Musée de Genève et préposé aux monographies sur les artistes du cru.
Hélène peignait déjà à l'époque où Flournoy l'étudiait. En témoignent les belles aquarelles martiennes, ultra-martiennes, etc. Mais, à partir de 1901, après avoir essayé d'apprendre l'anglais, puisque sa bienfaitrice était américaine, elle prend des cours de peinture.
Suivront, à partir de 1904, des dessins et des tableaux religieux peints en dormant, par courtes siestes d'un quart d'heure, d'abord une tête de Christ, un portrait de la vierge, puis un Christ en Gethsémané, puis une crucifixion.
A l'emploi des pinceaux et d'une spatule en fer est progressivement substitué celui de l'auriculaire et, pour ses plus grandes oeuvres, Hélène ne peindra plus qu'avec le petit doigt.
Rien de tout cela ne va vite et Hélène est perpétuellement en train de recevoir de son subliminal des dates d'achèvement qu'elle est incapable de tenir.
Ses modèles lui parviennent sous forme d'hallucinations. Pour le premier crayon du Christ, annonciateur de tout le cycle de peinture, le visage du Christ se penche et se pose sur le papier (?). Le jour de l'achèvement du Christ en Géthsémané, le Vendredi-Saint 1907, le Christ apparaît à côté de son portrait, comme pour permettre de juger de la ressemblance.
"Il leva deux doigts, l'index et le médius, les bouts du pouce et des autres doigts se touchant, et il me dit: «Ne crains pas, ma face te suivra! Dans les heures tristes et douloureuses de la vie ,je serai avec toi. Ne crains pas!» Je sanglotais. Christ posa sa main sur mon épaule droite. Je levai la main gauche pour toucher sa main, mais il disparut." (Hélène Smith dans une lettre dictée à M. David; A. Lemaître, loc. cit)
La tentation est grande, évidemment, de parler de délire mystique. Il n'en est rien. Hélène demeure la même et, si elle tient à quelque chose, il semble que ce soit, comme précédemment, au phénomène même de ses somnambulismes, et non à un éventuelle réalité de leur contenu.
Pour autant qu'on puisse en juger sur pièces, la santé mentale d'Hélène n'a souffert aucune évolution défavorable. Les certificats de bonne santé décernés à la somnambule par Flournoy dans Des Indes valent toujours, et sont repris par le bon Lemaître.
"Sans doute, écrit celui-ci, comme pour les révélations martiennes, etc., elle a la conviction absolue que ses peintures religieuses ne sortent pas de son propre fond et qu'elles sont d'origine supranormale; mais pour ce qui est de leur vérité objective, de leur authenticité absolue, il est probable qu'elle ne se pose pas nettement cette question ou qu'elle reste à ce sujet hésitante avec elle-même, suivant les convictions présumées des spectateurs d'après leur attitude - quelques uns vont jusqu'à s'agenouiller - en face de ses tableaux."
(Toute cette peinture somnambulique est en effet exécutée - et exposée - dans le salon de Mlle Smith, où les curieux et les croyants affluent.)
Il faut être quelque peu de mauvaise foi pour décréter que, tant qu'Hélène produit, à l'instigation de Flournoy, du martien et des scènes de harem, elle est une brave et honnête somnambule, mais que, sitôt qu'elle échappe au psychologue, ses élaborations deviennent des délires religieux ou érotiques.
Il semble, encore une fois, que les exégètes soient un peu trop désireux de tirer la leçon de l'affaire Smith et n'aient de cesse qu'ils n'aient récrit toute l'histoire selon un schéma canonique. La moindre des choses, dans leur version, est qu'ayant échappé au psychologue, Hélène sombre dans un état paranoïde, voie sa personnalité définitivement clivée et finisse délirante.
Avec la peinture religieuse, c'est en réalité une troisième carrière qui s'ouvre à Hélène, après celle, scientifique, de somnambule glossolale, et celle, à la fois scientifico-religieuse, de médium. C'est à présent sous une forme purement religieuse et inspirée qu'elle fabrique du miracle.
Quant au succès public de cet oeuvre (Il s'agit, à en juger d'après les reproductions qu'on en a, d'une peinture de type naïve sans beaucoup d'originalité), il démontre que la somnambule est capable d'inspirer l'admiration et la fascination, quelle que soit la forme que prend l'expression de ses facultés inconscientes, et qu'en somme elle n'annonce pas mal, son extrême bêtise mise à part, la race hypothétique des prêtresses du subliminal.
Accès à la deuxième partie de Théodore Flournoy et Hélène Smith.