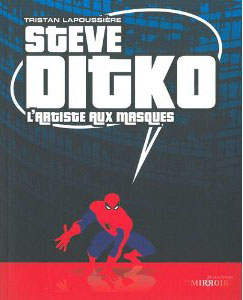|

MISCELLANÉES STRIPOLOGIQUES DE L'ANNÉE 2011
Mythopoeia - Æsthetica - Critica
LIVRES REÇUS
BEAUX ARTS HORS-SÉRIE HUMOUR & BD
Beaux Arts magazine, TTM éditions, s. d., dépôt légal décembre 2011
Un petit panorama de la bande dessinée humoristique, honnête travail de journaliste, brossé au moyen d'une suite de courts articles. C'est aussi, de fait, une petite anthologie de la bande dessinée pour rire. Le lecteur y trouvera ce qu'il lit ordinairement et découvrira le reste. Du côté de la production actuelle, le pire côtoie le meilleur. Par contre, dans les classiques, on trouvera dix-sept planches bien reproduites et bien commentées, qui nous mènent des Katzenjammer Kids à Régis Franc.
LIVRES REÇUS
BANANAS n° 4
Éditions Bananas BD, février 2012
Retour de Bananas, la revue d'Evariste Blanchet, toujours variée et intéressante. Ce numéro propose un entretien avec Jimmy Beaulieu et huit pages inédites du même, un petit dossier sur Pratt et les Italiens en Argentine avec une interview de Sergio Tarquinio, une lecture du Pinocchio de Winschlus, un entretien inédit avec Raymond Reding, réalisé en 1972, qui, avec le temps, a pris valeur de document sociologique (les dessinateurs ont désormais le droit de dessiner des filles avec des poitrines dans le bel hebdomadaire Tintin), une intelligente analyse des Anges de l'enfer, série qui paraissait dans le petit format Kiwi à la fin des années 1960, et pour finir le numéro une brève histoire de la littérature savante sur les littératures dessinées, par Harry Morgan.
LIVRES REÇUS
STEVE DITKO L'ARTISTE AUX MASQUES
Tristan Lapoussière
Les Moutons électriques, Bibliothèque des miroirs, 2011
Tristan Lapoussière propose une vie et œuvre de Steve Ditko particulièrement bien documentée. Notre auteur a le mérite de ne pas se focaliser sur Spiderman et le Dr Strange, mais de parcourir toute l'œuvre de ce singulier dessinateur américain, en proposant une hiérarchie de ses travaux pour la période qui va du départ de Marvel en 1965 à aujourd'hui. Les influences de Ditko, Mort Meskin, Will Eisner, Jerry Robinson, sont bien montrées. La mystérieuse rupture avec Stan Lee, qui intrigue et interroge tant les fans, est à juste titre décrite comme logique et sans mystère. Le choix des illustrations est remarquable.
On regrettera une certaine tendance de l'auteur à céder à l'encyclopédisme au détriment de l'analyse. Manque aussi une synthèse des thèses de l'auteur qu'on sent constamment, mais qui restent sous-jacentes.
LIVRES REÇUS
SUPER-HÉROS LA PUISANCE DES MASQUES
Jean-Marc Lainé Les Moutons électriques, Bibliothèque des miroirs, 2011
L'ouvrage s'ouvre sur une genèse des super-héros où toutes les sources connues de Superman et Batman sont convoquées, à l'exception notable des serials cinématographiques. (On peut observer en effet que The Iron Claw, 1916, avec Pearl White, ou The Master Mystery, 1920, avec Harry Houdini contiennent à peu près tous les ingrédients de Batman.)
L'auteur propose ensuite une histoire des super-héros où malheureusement la spécificité du médium bande dessinée est peu prise en compte, hormis les contraintes éditoriales de la publication en périodiques (les comic books). Dans cette histoire, notre auteur glisse une typologie des super-héros et de multiples considérations sur leur rapport avec le contexte culturel, social et politique.
Dans un second temps, M. Lainé disserte sur les super-héros à la télévision et au cinéma. En prime, un chapitre sur les super-héros japonais, bien documenté, et un autre sur les cousins européens des super-héros, critiquables à maints égards. Pour l'Italie, il nous semble que Diabolik et ses héritiers ont tout à voir avec Raffles the Amateur Cracksman, Zigomar, Fantomas, et rien avec le comic book. Par contre les illustrés britanniques, contrairement à ce que laisse entendre l'auteur, proposent bel et bien des super-héros tels que Captain Universe, Electroman, Thunderbolt the Avenger (en français dans Télépoche, Météor l'homme à la montre), qui ne diffèrent de leurs homologues américains que par leur britannicité.
On déplorera aussi certains simplifications abusives. Il nous paraît ainsi téméraire de soutenir que dans les comics du golden age la science ne susciterait « aucune méfiance », que « le progrès est le garant de l'avenir », et qu'il en irait autrement dans une après-guerre échaudée par la bombe atomique. L'opposition dialectique de la foi dans le progrès et de la méfiance de la technique structure l'ensemble de ces littérature.
Du bon côté, M. Lainé fait œuvre utile quand il dénonce certains poncifs largement remployés dans la littérature secondaire.
RÉFLEXIONS NARRATOLOGIQUES
DEUX ADAPTATIONS TÉLÉVISUELLES DE
CHARLES DICKENS
Vu deux adaptations de Dickens pour le petit écran, Bleak House (2005) et Little Dorrit (2008), toutes deux produites et réalisées par la BBC.
Adapter Dickens est naturellement une tâche impossible, non parce que ses romans ne s’y prêtent pas, ils s’y prêtent au contraire merveilleusement, il suffit de découper les dialogues pour avoir les scènes toutes prêtes, mais parce que le dickensien est tapi là, le volume en main, de sorte que s’il venait à manquer une réplique, une scène ou, pire, un des nombreux personnages secondaires, ou bien s'il se découvrait que l’un des acteurs ait négligé de se faire la tête qu’a son personnage dans les gravures de Phiz, l’affaire risquerait fort de se terminer par une interpellation à la chambre.
Fort heureusement, le cinéma britannique est, de par son histoire, essentiellement littéraire et théâtral, et l’évolution l’a donc doté des caractères qui le rendent naturellement apte à adapter Dickens et Shakespeare. Ce qui, de l’autre côté de l’Atlantique, tomberait immanquablement dans le snobisme, l’imbécillité et la boursouflure, donne des productions prosaïques et sans grande imagination, mais qui fonctionnent comme des illustrations filmiques des romans.
Je n’ai pas été très impressionné par Bleak House, qui avait beaucoup plu à la presse britannique, mais pour des raisons de marketing plus que de forme : le feuilleton a été produit comme un soap opera, et les épisodes d’une demi-heure, diffusés en prime time, ont attiré un public nombreux et populaire, qui n’aurait pas accès normalement aux classiques, même filmés. (Mais l’affaire est compliquée, parce que l’adaptation d’un roman victorien se range elle-même dans un genre télévisuel éminemment populaire, le costume drama, sorte de soap opera glorifié, qui bénéficie des atouts des beaux costumes et des jolis décors, et qui a aussi la fonction sociale de renforcer le sentiment d’identité nationale, en familiarisant les britanniques avec leurs ancêtres victoriens.)
Le résultat de la soapification de Bleak House est qu’on voit essentiellement des têtes qui parlent, en très gros plan. Quand, d’aventure, on aperçoit pendant une demi-seconde un décor en entier, on constate qu’il est très joli, et on regrette de ne pas le voir mieux. De même, les plans généraux, en particulier dans les scènes d’intérieur, imitent des tableaux victoriens, et fort bien, composition et couleur.
Ceci étant, il n’y a pas de récit filmique à proprement parler, et Bleak House pourrait parfaitement consister en images fixes accompagnées de la bande son, sans qu’on n'y perde rien.
Je déplore aussi dans Bleak House des tics post-modernes qui, sept ans après la date de première diffusion, semblent déjà leur propre parodie. Le plus gênant est le bruit de fer à vapeur qui accompagne les changements de lieux ou les establishing shots. Qui se signale ainsi ? Est-ce le « narrateur filmique » qui, à défaut de dire « je », dirait « pshhh » ? Est-ce le guide ectoplasmique que je postule dans ma propre naratologie des récits en images, qui aspire bruyamment dans son sillage les fantomatiques voyeurs que sont les téléspectateurs ? Est-ce la mécanique filmique elle-même, qui est réglée pour aller enregistrer le récit à l’endroit où il se déroule ?
Little Dorrit est beaucoup plus conventionnel que Bleak House et, pour commencer, il y a un vrai récit filmique. Je veux dire que le plan contient réellement des gens qui accomplissent des actes, par exemple un libraire qui se dépêche de rentrer ses livres à cause de l’ondée, tout à fait comme si on était dans une adaptation de Dickens pour Le Théâtre de la jeunesse de Claude Santelli, produite par l’ORTF dans les années 1960. Il y a même des morceaux d’écriture filmique classique. Quand Amy Dorrit refuse la demande en mariage du jeune John Chivery, le fils du gardien de la Marshalsea, John dégoûté jette son beau haut-de-forme dans un panier de pêcheur, et Amy ramène le chapeau au gardien, une minute avant la fermeture de la porte de la prison, cette remise in extremis du couvre-chef rescapé suffisant pour raconter toute l’histoire au père du soupirant déçu.
Les adaptateurs de Little Dorrit se sont efforcés de montrer comment Dickens gardait sa pertinence pour notre époque, tout à fait comme s’ils faisaient un cours de littérature pour des étudiants de première année. Amy Dorrit est le caregiver, l’« aidant principal », du vieux Dorrit, ce qui évoque le soin donné aux vieux parents en notre époque de vieillissement de la population et d’Alzheimer généralisé.
Plus conventionnellement, Rigaud est dépeint comme un serial killer. Quant à Tattycoram, la fille adoptive des Meagles, mi--compagne, mi-servante de leur fille, elle est jouée par une actrice de couleur et le personnage a donc des « griefs » (« issues ») qui préfigurent les post-colonial studies, ou les subaltern studies. La contrepartie est que la caméra fait une trop grande place à ces personnages relativement à leur importance dans le récit, de sorte que, au dernier épisode, le spectateur a du mal à se convaincre que l’histoire est bien terminée et qu’on n’a oublié personne.
LIVRES LUS
ALAN MOORE UNE BIOGRAPHIE ILLUSTRÉE
Gary Spencer Millidge
Huginn & Muninn/Dargaud, 2011
Traduction de Alan Moore Storyteller. Sur plus de 300 pages au format album, la vie et l'œuvre d'Alan Moore, dans l'ordre chronologique, avec une foule de documents rares et intriguants, tous dûment commentés. Toutes les bandes dessinées, de Maxwell the Magic Cat à Promethea, mais aussi les textes de fiction, les activités de l'homme de spectacle et du mage élisabéthain, et encore les inachevés, et Alan Moore poète, les articles, les préfaces, les notes de lecture pour le Fortean Times. Pas d'analyse au demeurant (mais le lecteur n'en cherche probablement pas, hypnotisé qu'il est par ce qu'on lui montre). En prime, une chronologie dépliante et un CD. Préface de Michael Moorcock.
LIVRES LUS
MA VIE MANGA
Osamu Tezuka
Kana, 2011
Traduction de Boku no manga jinsei, transcription de conférences faites par Tezuka dans les années 1986-1988. Le père d'Astro le petit robot raconte son enfance et sa jeunesse, parle de l'élan vital et du bonheur d'exister (Tezuka est un enfant de la guerre), de la signification de son œuvre (le respect de tout ce qui vit, le danger de la technique), du dessin animé, de l'éducation des enfants.
Témoignages de l'ami d'enfance, de la sœur, de l'homme d'affaires qui aida Tezuka après la faillite de Mushi Productions. « J'ai racheté la totalité des droits d'exploitation des œuvres alors existantes de Tezuka. Et dix ans plus tard, je lui ai tout rendu. »
Tezuka nous donne bien sûr le point de vue d'un homme de lettres, antidote au discours des politiques, mais aussi des médias, qui « nous illusionne plus que la fiction, car il se fait passer pour la réalité, alors que la fiction ne se cache pas d'être une illusion. »
LIVRES REÇUS
L'ASSOCIATION : UNE UTOPIE ÉDITORIALE ET ESTHÉTIQUE
Sous la direction d’Erwin Dejasse, Tanguy Habrand et Gert Meesters
Les Impressions nouvelles, 2011
L’année 2011 aura été une année importante pour L’Association et pour Jean-Christophe Menu. Ce dernier a soutenu sa thèse de doctorat en Sorbonne en janvier, et il s’est retiré de la structure éditoriale dont il était l’âme en mai. Le moment n’est pas mal trouvé pour faire un livre sur le petit éditeur unanimement crédité d’avoir lancé la bande dessinée d’auteur. C’est ce à quoi s’est appliqué le collectif liégeois ACME.
Le groupe ACME entend étudier la bande dessinée « en soi », au lieu de l’utiliser à fin d’illustration de « thèses hégémoniques ». (C’est à peu près ce que prétendaient faire MM. Morgan et Hirtz quand ils notaient dans Les Apocalypses de Jack Kirby, Les Moutons électriques, 2009, p. 12, que la stripologie est une science autotélique, c’est-à-dire que l’investigation « a pour finalité la connaissance des récits dessinés eux-mêmes et non de leurs sources ni d’aucun autre élément périphérique (par exemple ce que ces récits révéleraient de l’imaginaire de leur société ».) ACME, quant à lui, revendique une approche pluridisciplinaire (sociologique, institutionnelle, esthétique, historique, etc.). Mais concrètement le discours des chercheurs est structuré d’une part par une approche socio-économique et d’autre part par une approche sémiotique. La première de ces préoccupations explique la place éminente que tiennent dans l’ouvrage les péritextes de l’éditeur (catalogues, bons de commande, primes, suppléments divers). La seconde explique que, dans les études d’auteurs, soient privilégiées la planche et la case. Et la première de ces approches le cède progressivement à la seconde à mesure qu’on avance dans l’ouvrage.
Si la notion d’utopie éditoriale annoncée dans le titre de l’ouvrage évoque irrésistiblement l’utopie sonore du catalogue de l’éditeur de musique Frémeaux et associés, le propos de nos théoriciens est plutôt de mettre en lumière la cohérence du projet éditorial de L’Association. À cet égard, nos auteurs évitent de survaloriser les vedettes ou les best-sellers, qui sont traités à leur place, dans les analyses d’auteurs ou dans les articles thématiques. Pour ce qui est de l’approche socioéconomique, le fil conducteur de nos théoriciens est le subtil équilibre de L’Association entre rupture affichée et réalités économiques (celles-ci incluant, le cas échéant, le succès commercial). Du côté de la création, nos chercheurs mettent en lumière le goût pour le détournement, la parodie, la contrainte, mais aussi la mise en scène d’eux-mêmes par les auteurs (article d’Erwin Dejasse sur l’autobiographie dessinée), ainsi que la capture de la réalité et le style « sur le vif » (étude sur le reportage dessiné par David Vrydaghs). Il arrive cependant que la méthodologie convoquée donne peu de résultats, et nous avouons ne savoir que penser des savants comptages par Gert Meesters, censés cerner la spécificité de la narration imagière des auteurs de L’Association par comparaison à un corpus de référence (l’hebdomadaire Tintin/Hello Bédé).
L’article conclusif de Dick Tomasovic, ostensiblement consacré à Shenzen de Guy Delisle, déborde son sujet et offre du coup une excellente analyse du style Association. Guy Delisle appartient à L’Association sur le plan stylistique par « la revendication du crayonné et de l’esquisse comme dessin terminé, le récit par épisodes sous forme de journal quotidien, la dérision réflexive comme point de vue sur le monde, le goût du détail qu’il soit graphique ou narratif et le recours général à la synecdoque ou la métonymie pour exprimer la subjectivité ». Quant aux choix éditoriaux de L’Association, ils sont caractérisés par « l’étrangeté des traits dessinés, le goût de l’anecdote aux dépens de la grande forme du récit, la réinvention perpétuelle des mises en page, la variété des formats des ouvrages, la revendication d’une morgue ironique envers le champ de la bande dessinée, le ludisme laborieux des exercices oubapiens (...), les démarches visant à accrocher le regard et la lecture ».
LIVRES REÇUS
AU COIN DE MA MÉMOIRE
Francis Groux
PLG, collection Mémoire Vive, 2011
Mémoires de Francis Groux, cofondateur du festival de la bande dessinée d'Angoulême, avec Jean Mardikian. Avec une modestie de bon aloi, l'auteur nous raconte sa vie et celle du festival, en nous régalant de savoureuses anecdotes, que l'historien prendra naturellement avec toute la prudence qui est de mise.
L'ouvrage est agréablement illustré de planches originales et de dessins dédicacés offerts à M. Groux par les dessinateurs reconnaissants.
Ouvrage indispensable à qui s'intéresse à l'histoire sociale de la bande dessinée.
Préface de Thierry Groensteen.
REVUES REÇUES
LA CRYPTE TONIQUE
Le magazine du magasin
n° 0 sept-ct. 2011
n° 1 nov. déc. 2011
Philippe Capart
16 galerie Bortier 1000 Bruxelles
Singulière entreprise que celle de Philippe Capart, qui a racheté le fonds du libraire et éditeur Michel Deligne, l'a installé dans sa crypte, et qui, dans le numéro zéro de sa revue, brosse l'histoire des librairies bruxelloises spécialisées en bande dessinée, mais aussi du fandom et des fanzines. Le numéro un est à la gloire de Félix le chat et de Charlie Chaplin. Les articles signalés dans le magazine par un astérisque sont disponibles dans le magasin.
LIVRES PARUS
BANDE DESSINÉE ET NARRATION
Système de la bande dessinée 2,
Thierry Groensteen
PUF collection Formes sémiotiques, 2011
Le deuxième volume de Système de la bande dessinée, paru douze ans après le premier (Système de la bande dessinée, PUF, collection Formes sémiotiques, 1999), en constitue d’une certaine façon une mise à jour, et le livre peut fonctionner à la façon du « patch » d’un logiciel informatique, l’auteur nous informant de tels progrès théoriques qu’il a accomplis sur les problématiques de la solidarité iconique, de la séquentialité, de la mise en page, etc.
Mais c’est essentiellement sous l’angle de la narratologie, annoncé dans le titre même de l’ouvrage (Bande dessinée et narration), que l’auteur considère son sujet, ce qui peut surprendre, car les thématiques abordées débordent largement cette approche narratologique, soit que Thierry Groensteen interroge les limites du médium bande dessinée — d’où des étude sur la bande dessinée abstraite, la bande dessinée sur support numérique, la bande dessinée et l’art contemporain —, soit qu’il propose des analyses qui relèvent plus largement de la poétique.
Relève ainsi de la poétique l’introduction par Groensteen, dans un passage d’esprit très barthésien, de la notion d’advenu, concurrente de celle de signifié d’une image (en gros, il y a advenu quand une case nous dit : voilà la chose qui est arrivée ensuite ; mais il y a dans les bandes dessinées des signifiés plus complexes, qui ne relèvent pas de l’advenu).
Relève également de la poétique l’introduction de la notion de multicouche, à côté du multicadre, permettant notamment de rendre compte de la rhétorique des émotions dans le manga, ou bien l’investigation sur la représentation de la subjectivité et du monde intérieur, ou encore la réflexion sur le rythme (au sens d’une scansion, d’une métrique) dans la bande dessinée.
Le fil conducteur de cette poétique groensteenienne est le passage d’une bande dessinée traditionnelle, dont le sens s’épuise dans les rapports de causalité et de consécution des vignettes successives, à une bande dessinée moderne (ou plus exactement post-moderne), où les rapports entre les vignettes ne relèvent plus d’inférences logiques de type temporel et causal, mais d’une discursivité savante, demandant une participation du lecteur, et qui superpose des ontologies multiples, le réel se mêlant au souvenir, au rêve, au fantasme, aux affects, etc. (Un exemple parfait de cette bande dessinée post-moderne est le Jimmy Corrigan de Chris Ware.)
D’un autre côté, c’est bien la problématique de la narration qui occupe la position centrale de l’ouvrage (pp. 85-132). Thierry Groensteen se montre ici partisan d’une via media, renvoyant dos à dos (p. 88) les théoriciens qui postulent qu’il y a toujours un narrateur dans tout récit (les partisans du « tout narrateur ») et ceux qui pensent que les récits dessinés se « racontent tout seuls », et qui ne font place au narrateur que lorsque celui-ci intervient spécifiquement ou laisse des traces incontestables (nous-même faisons partie de cette dernière école, en bon disciple de Franz Karl Stanzel). Groensteen se place sur un plan strictement pragmatique et cherche quelles sont les instances de narration minimales qui sont nécessaires pour « raconter » une bande dessinée. Inspiré par la théorie du cinéma, et spécifiquement par celle d’André Gaudreault [Du Littéraire au filmique, Méridiens Klincksieck, 1988], notre auteur réduit cependant considérablement les catégories par rapport à celles que Gaudreault postulait pour le cinéma, puisque Groensteen fait place à un narrateur fondamental, un monstrateur (chargé des images) et un récitant (chargé des récitatifs). Gaudreault, quant à lui, avait recours à tout un zoo de narrateurs, tous plus spécialisés les uns que les autres, monstrateur profilmique (mise en scène), monstrateur filmographique (mise en cadre), réunis tous deux par un méga-monstrateur filmique (mise sur film), qui voisinait avec un narrateur filmographique (mise en chaîne), et les deux étant coiffé finalement par un grand imagier (ou méga-narrateur filmique, chargé de la mise en film) [Du littéraire au filmique, op. cit., p. 113.]
Thierry Groensteen prend soin d’expliquer (p. 87) que son narrateur fondamental, son monstrateur et son récitant ne sont pas des sortes de fantômes, hantant l’atelier du dessinateur, mais qu’ils correspondent à des opération narratives identifiables et séparables. C’est ce qui fait l’intérêt de son modèle, puisqu’il montre, en convoquant à l’appui une connaissance encyclopédique de la bande dessinée, de quoi sont capables, pour ainsi dire, ces différentes instances, d’où de beaux développement sur le narrateur actorialisé, la modalisation, la polygraphie.
D’un autre côté, Groensteen semble faire un pas en arrière par rapport à Système de la bande dessinée 1, puisqu’il repère le responsable des textes et le responsable des dessins, revenant de facto à une conception de la bande dessinée comme alliance (et collaboration) de l’un et de l’autre. Quant aux opérations fondamentales (non triviales) mises en lumière dans Système 1 — découpage, mise en page, tressage —, elles sont mises au compte du narrateur fondamental, dont monstrateur et récitant sont les myrmidons zélés.
Plus délicate est la mise en compatibilité de la narratologie groensteenienne avec les propositions théoriques de Système 1 inspirées de Gilles Deleuze (Système 1, p. 125 ssq). Si Groensteen disait de l’image qu’elle était un énonçable (et aussi un descriptible et un interprétable) c’était précisément pour lui refuser, à la suite de Deleuze, la qualité d’énoncé (« Ce n’est pas une énonciation, ce ne sont pas des énoncés », écrivait Deleuze dans L’Image-Temps, Minuit, 1985, p. 44). Pas de place apparemment, dans cette optique, pour la narration (la narration est une énonciation ! Le récit est un énoncé !). Notre théoricien se tire d’embûche, si nous suivons bien sa pensée, en distinguant le plan de la production et celui de la réception. La transformation d’un énonçable en énoncé, c’est le travail du lecteur (p. 36, p. 40, passim). Mais quant à la production, Groensteen affirme dans Bande dessinée et narration que les images de bande dessinée sont le produit d'une narration et pose explicitement que « le montré est un dit » (p. 89). En effet, son point de départ est que celui qui ouvre une bande dessinée le fait pour « s’exposer à un récit » (p. 88). Et puisque récit il y a, Groensteen cherche les instances productrices de ce récit (ou les opérations fondamentales qui y président, puisque, encore une fois, l’auteur ne postule pas des fantoches chargés respectivement de dessiner, de réciter et d’articuler). Reste qu’on peut se demander pourquoi l’auteur ne continue pas sur sa lancée, en posant d’emblée que, en l’absence d’énonciation et d’énoncé, il n’y a pas d’énonciateur, et que le récit de bande dessinée se raconte « tout seul ».
Allons plus loin. Il n’est pas assuré qu’on puisse échapper à la querelle qui sépare les narratologues. Groensteen, tout partisan qu’il soit de la via media et du pragmatisme, amène des problématiques qui sont bien celles des narratologues adeptes du « tout narrateur », telle que la question de l’unreliable narrator (il donne, p. 100 sqq, des exemples de narrateur déceptif dans le dessin, autrement dit d’unreliable monstrator). Il est évident que si l’on pense que le récit se raconte « tout seul », cette question de la déceptivité ne se pose pas. On nous dira que cela revient à traduire comme relevant d’une « événementialité » ambiguë ce que Groensteen met au compte d’un narrateur non fiable, mais la querelle n’est pas uniquement de terminologie ou de modèle. Groensteen explique (p. 100-101) à propos d’un récitant qui, devant la succession des événements, se demande ce qui se passe (dans L’Ombre du Z de Franquin), qu’il est déjà unreliable (Groensteen écrit « trompeur »), puisque, en tant que voix autoriale, ce récitant sait pertinemment ce qui se passe (pour raconter l’histoire, il faut bien qu’il la connaisse). Nous avions, quant à nous, dans notre thèse (Formes et mythopoeia dans les littératures dessinées, 2008), introduit la notion de bonimenteur à propos d’un tel récitant (nous pensions aux textes emphatiques de Stan Lee au sommet des cases de Jack Kirby). Le bonimenteur peut parfaitement découvrir l’histoire en même temps que nous. Bref, il n’est aucunement besoin de postuler, dans les récitatifs, une voix autoriale, et il devient inutile dès lors de chercher de la déceptivité quand le récitant se place en situation d’information incomplète.
Mais c’est naturellement à propos de la représentation de la subjectivité que le parti que prend, tout en s’en défendant, Groensteen pour le « tout narrateur » se décèle le plus, parce qu’il est amené à postuler à chaque fois l’intervention d’un narrateur qui nous donne accès à ladite intériorité (alors qu’on pourrait poser que cette intériorité nous est accessible de façon immédiate). Ainsi, à propos du narrateur actorialisé (c’est-à-dire présent dans son histoire), notre théoricien, étudiant (p. 141) une séquence muette du tome 3 du Journal de Fabrice Neaud, pose que le « Fabrice » qui est dessiné continue à être le narrateur actorialisé, même s’il a renoncé à être le récitant. De fait, nous sommes dans le fantasme amoureux de « Fabrice » qui rêve bientôt, dans sa douce euphorie, d’un café « fin de siècle », de champs de blé, etc. Mais n’est-il pas dans ce cas plus simple de dire qu’on est en « focalisation interne », exactement comme dans les romans de Virginia Woolf, en faisant l’économie d’un « Fabrice » narrateur, nonobstant le fait qu’il soit un personnage muet), que Groensteen ne retrouve que par un faisceau de présomption ? (« Fabrice », même muet, continue à être le narrateur parce que l’œuvre s’appelle Journal, parce que dans le reste du tome, Fabrice est le récitant, et parce que nous n’avons accès à l’intériorité que de Fabrice.)
Mêmes les bulles de pensée des personnages (si pratiques comme on sait pour les auteurs, puisque le héros communique au lecteur ce qu’il a vu et ce qu’il a l’intention de faire) sont mises par Groensteen (p. 134) au compte d’un narrateur qui se positionne explicitement comme omniscient et se montre capable par conséquent de pénétrer l’esprit de ses personnages (c’est la définition de la focalisation zéro de Gérard Genette). Mais les bulles de pensée en elles-mêmes ne permettent nullement de conclure à un narrateur omniscient. Un récit réflectorisé, c’est-à-dire perçu en entier « à travers » un personnage, qui est donc l’exact contraire d’un récit « narratorisé », et dont l’exemple canonique, depuis Percy Lubbock, est Les Ambassadeurs de James, est précisément basé sur le fait qu’on partage les pensées du personnage. (Il est entendu au demeurant que le personnage du réflecteur peut changer à tout moment dans un récit.)
Bref, il nous semble que l'auteur n'est pas tout à fait clair dans sa définition du narrateur. Il nous présente pragmatiquement un narrateur chargé de la production du récit (par exemple, son narrateur fondamental est chargé des opérations de mise en page, de découpage et de tressage ; il confie au monstrateur le soin de représenter les agissements des personnages). Mais d'un autre côté, la question que pose Groensteen est bien celle que pose la narratologie depuis Genette : « Qui parle ? » Et dans cette conception, c'est bel et bien la thèse du « tout narrateur » que défend Groensteen.
Finalement, la catégorisation introduite par Groensteen, qui est censée rendre compte de façon économique de l’ensemble des problèmes narratologiques dans la bande dessinée, n’atteint que partiellement son but. Contentons-nous ici d’un exemple. À propos d’un graphic novel de Mazzucchelli, Asterios Polyp, où tous les personnages sont dessinés dans un style différent, qui reflète leur intériorité, comme dans le célèbre dessin The Party, de Saul Steinberg, le théoricien parle (p. 144) d’un régime « d’objectivation subjectivée » ajoutant : « Nous voyons les personnages de l’extérieur, mais à la façon dont eux-mêmes perçoivent le monde et s’y projettent ». « D’une façon générale, poursuit Groensteen, la question de l’expression du monde intérieur d’un personnage ne peut être étudiée qu’à l’intérieur d’une théorie narratologique de la bande dessinée. » Et l’auteur ajoute que « la façon dont un auteur s’y prend pour donner accès à la subjectivité de ses personnages ne peut être décrite sans une identification précise des interventions respectives du récitant et du monstrateur, et de leurs modalités croisées. »
Mais suffit-il d’affirmer qu’une même instance (ici, le monstrateur) assure simultanément (Groensteen parle d’une « fusion » et d’une « synthèse ») la présentation objective d’une situation (« nous voyons les personnages de l’extérieur... »), et la représentation subjective des personnages (« ... mais à la façon dont eux-mêmes perçoivent le monde et s’y projettent ») ? Cela ne nous dit pas comment le monstrateur s’y prend pour opérer cette quadrature du cercle. Il faudrait distinguer ce qui permet, dans le dessin, l’un et l’autre procédé. Et dès lors, ce n’est plus de synthèse qu’il est question, mais de deux modalités distinctes, qui restent à définir.
On peut rendre compte complètement et élégamment de ce qui se passe dans un dessin comme The Party de Saul Steinberg ou dans une grande case d’Asterios Polyp de Mazzucchelli, en distinguant deux notions empruntées à Franz Karl Stanzel (mais dont la combinaison dans les littératures dessinées est spécifique), la perspective et le mode. La perspective, notion à la fois visuelle et cognitive, peut être extérieure ou intérieure. Nous avons déjà fait allusion plus haut au mode. On est en mode narrateur quand l’action est racontée par un tiers, dont l’intermédiation est détectable, en mode réflecteur quand tout est vu subjectivement à travers le personnage. Je puis raconter ainsi : « Au moment où Billy Bunter se glissait hors du dortoir des quatrièmes, une voix sévère l’arrêta sur place. — Encore en retard, Bunter, tonna Mr Quelch. » Je suis en mode narrateur. Mais je puis aussi raconter ainsi : « — Encore en retard, Bunter ! Billy Bunter se figea sur place au seuil du dortoir des quatrièmes. Le terrible Mr Quelch, jailli de nulle part, se tenait à deux mètres devant lui. » Je suis alors en mode réflecteur. Tout est vu « à travers » Billy Bunter.
Dans l’exemple que cite Groensteen la perspective est extérieure, mais le récit graphique est (multi)réflectorisé. C’est précisément ce qui permet la présentation objective de la scène mais la représentation subjective des personnages.
Comme on le voit, il n’est nul besoin de mettre le narrateur à toutes les sauces pour décrire ce qui se passe dans les récits dessinés. Et dès lors que c’est l’intériorité des personnages qui prédomine, que la prémisse du récit est la primauté de la conscience plutôt que l’existence d’un monde réel, il y a un gain technique à disjoindre les notions de perspective et d’instance de médiatisation, ce qui empêche de conserver la figure unique d’un narrateur, fût-il imagier.
LIVRES PARUS
DICTIONNAIRE DES LIVRES ET JOURNAUX INTERDITS
2e ÉDITION
Bernard Joubert
Cercle de la Librairie, 2011
On se demande parfois à quoi servent les blogs consacrés à l'actualité de la bande dessinée. Il faut consulter la deuxième édition, entièrement revue, et augmentée de plusieurs dizaines de notices, du Dictionnaire des livres et journaux interdits, de Bernard Joubert, pour apprendre que la célèbre loi du 16 juillet 1949 a été modifiée, dans le silence complet des médias, par la loi du 17 mars 2011, une de ces lois fourre-tout dont l'intitulé, imaginé par des humoristes, est désormais « loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ». Ce toilettage s'est fait sous prétexte de rendre le droit interne conforme au droit européen, en l'occurrence à la célèbre directive Services.
Si la finalité du texte n'a pas changé — il s'agit toujours de donner à une commission de siphonnés, qu'on recrutera exprès, la faculté de menacer les éditeurs de bandes dessinées de poursuites pénales, sous un prétexte d'ordre moral —, la définition de cet ordre moral, et par conséquent la base philosophique du texte, a été profondément modifiée. Citons, d'après Légifrance, la version initiale et la version actuelle du fameux article 2 de la loi du 16 juillet 1949, correctionnalisant la publication de mauvaises bandes dessinées. Voici la version d'origine :Les publications visées à l'article 1er ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisime, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche et tous actes qualifiés crimes ou délits ou de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse.
Elles ne doivent comporter aucune publicité ou annonce pour des publications de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse.
Et voici la version 2011 du même article :
Les publications mentionnées à l'article 1er ne doivent comporter aucun contenu présentant un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique ou lorsqu'il est susceptible d'inciter à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, aux atteintes à la dignité humaine, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes, à la violence ou à tous actes qualifiés de crimes ou de délits ou de nature à nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral de l'enfance ou la jeunesse.
Elles ne doivent comporter aucune publicité ou annonce pour des publications de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse.Comme on le voit, les principes de morale catholique laïcisée de 1949, inspirés des dix commandements, ont été remplacés en 2011 par les principes de ce qu'on appelle de façon plus ou moins impropre la rectitude politique, la bien-pensance, ou l'idéologie victimaire. Dans la version initiale, la présentation sous un jour favorable du mensonge faisait naturellement référence au huitième commandement, celle du vol au septième, celle de la haine au cinquième, celle de la débauche au neuvième ; et si la liste commençait par une très invraisemblable « présentation sous un jour favorable du banditisme », c'est parce que les milieux catholiques d'avant-guerre s'étaient habitués à qualifier les journaux pour enfants commerciaux du temps — à commencer par Le Journal de Mickey — d'« illustrés gangsters », sous prétexte qu'ils publiaient des strips américains, remplis comme chacun sait d'émules d'Al Capone, saluant chaque aube de rafales de mitraillettes.
Dans la nouvelle version du texte, c'est, très victimairement, le danger pour les mœurs des petits enfants qui ouvre la série, la pédophilie étant considérée comme le crime suprême dans une société où les petits enfants sont, dans l'échelle du grief et de la réclamation, les victimes par excellence. Et vient en second lieu l'incitation à la discrimination ou à la haine, autrement dit le délit de « racisme », déjà réprimé par l'article 24 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, mais qu'il faut réprimer davantage encore, puisqu'il constitue, dans le logiciel des médias, des politiciens et des « associations », la faute originaire, source de tout mal.
Et on notera au passage que le marketing a fait des progrès non moindres que le droit, puisque la longue litanie du texte initial sur ce qu'on peut imprimer dans un journal (une illustration, un récit, une chronique, une rubrique, une insertion), est remplacée par un seul mot : tout cela, mon bon monsieur, cela s'appelle des contenus.
LIVRES REÇUS
KAMI ET MECHA : IMAGINAIRE JAPONAIS
Yellow Submarine n° 135, 2011
Plus de 200 pages bien tassées sur l'imaginaire fantastique japonais, dont une histoire de la science-fiction japonaise (Tony Sanchez), une histoire du robot japonais (Raphaël Colson) l'œuvre de Tezuka (M. Hirtz), le manga d'horreur (Anne Adam), les superhéros japonais (Julien Sévéon), la réception de la culture populaire nippone en France (Olivier Richard).
RÉFLEXIONS NARRATOLOGIQUES
LE ROMANCIER COMME VOYANT ET COMME FANTÔME
Le romancier comme voyant. Idée très présente chez Julien Green. « ... et s’il fallait résumer en quelques mots ma méthode de travail, je dirais simplement que j’écris ce que je vois. Cette phrase dit à peu près tout. Si je ne vois rien, en effet, je ne puis écrire. Je veux dire que si je n’ai pas devant les yeux de l’esprit une représentation très nette de la scène que je me propose de décrire, je ne puis rien faire de bon, et je dis bien : une représentation, comme on dit une représentation théâtrale. » (Journal, 16 octobre 1949.)
Cette idée du romancier comme voyant, j’ai toujours pensé qu’elle était le point aveugle de toutes les théories du narrateur. Le narrateur nous donne à voir ce qu’il voit lui-même. C’est précisément ce qui rend inextricables les querelles de théoriciens sur l’existence ou non d’une instance de narration, en particulier dans ceux des récits écrits où l’on est, de bout en bout, « au point de vue » d’un personnage, et dans les récits en images (bande dessinée, cinéma).
Dans le cas des récits imagiers, on est également fondé à affirmer qu’il y a un narrateur, puisque quelqu’un nous donne les images que nous voyons (telle est, par exemple, la position de mon ami Thierry Groensteen), ou qu’il n’y en a pas, puisque ces images se présentent comme une représentation analogique du monde (c’est par exemple la position de l’universitaire Jean-Marie Schaeffer). Le pragmatiste que je suis conclut que, chacune de ces analyses fonctionnant ni mieux ni moins bien que sa rivale, elles se valent, et que la querelle est sans objet.
Quant à moi, toujours pragmatiquement, j’introduis dans mon modèle un narrateur lorsque l’intermédiation de celui-ci se fait sentir pour le lecteur (je reste fidèle ici à la notion de Mittelbarkeit de Stanzel). Or poser que le narrateur nous donne à voir ce qu’il voit lui-même, c’est concevoir l’auteur et son lecteur comme des sortes de fantômes, qui hantent les lieux et assistent aux scènes du récit. Le plus souvent, ces spectateurs sont discrets, et ils finissent par oublier eux-mêmes qu’ils existent, pour ne retenir que la scène dont ils sont les témoins. Mais de temps à autres ce guide fantomatique qu’est l’auteur accomplit quelque chose de décisif, qui nous rappelle qu’il a la main haute et c’est alors qu’on peut parler d’un récit narratorisé, d’un point de vue autorial, etc.
Cela se voit très bien au cinéma, où la succession des plans et des mouvements d’appareil ne fait pas impression sur nous, qui observons les faits et gestes des personnages (Jean-Marie Schaeffer est fondé à nous dire que nous sommes alors devant une représentation analogique de la réalité), jusqu’au moment où la caméra prend les devants, et passe inopinément dans un couloir dans lequel les personnages n’ont pas encore pénétré, ou bien s’arrête soudain sur un détail révélateur de quelque élément-clé de l’intrigue. À ces moments, le guide fantomatique prend l’initiative. Il ne nous dit plus seulement : « Chut ! entrons ici sans faire de bruit », mais : « Attention ! vous allez voir ce que vous allez voir ! »
LIVRES LUS
LE PETIT LIVRE BLEU
ANALYSE CRITIQUE ET POLITIQUE DE LA SOCIÉTÉ DES SCHTROUMPFS
Antoine Buéno
Hors Collection, 2011
Ce bref essai, désinséré par son auteur d'un roman (Le triptyque de l'asphyxie ou chronique de la mort des macchabées, La Table Ronde, 2006), dans lequel il était censé représenter la thèse de doctorat de l'une des protagonistes, réussit à combiner les défauts de l'ignorance à ceux de l'outrecuidance. L'auteur, qui se présente comme enseignant à Science Po, et qui ne serait pas mal avisé, en effet, d'y suivre quelques cours, ignore qu'il existe sur le sujet « bande dessinée et politique » une littérature secondaire qui remplit aujourd'hui quelques bibliothèques. Le lecteur de cet opuscule devra se contenter, comme base théorique, d'un unique mémoire de master 2, certainement génial, mais écrit par un illustre inconnu, et demeuré inédit. Les questions de corpus n'intéressent pas davantage M. Buéno, qui mélange les albums de Pierre Culliford, dit Peyo, et ceux, d'une teneur toute différente, de Thierry Culliford, fils du précédent et continuateur de son œuvre. Quant à demander à M. Buéno une connaissance quelconque des littératures graphiques, de leur histoire et de leur esthétique, une telle proposition relève à l'évidence de la loufoquerie. M. Buéno ignore en particulier que les Schtroumpfs continuent une vieille tradition graphique mettant en scène des peuplades conjecturales de lutins distingués seulement par des attributs secondaires (le plus souvent, leur état social, ou un trait de caractère), auxquels nous avons donné l'appellation de myrmidons (d'après une peuplade achéenne, dans la mythologie grecque). Des exemples canoniques de myrmidons sont les Brownies de Palmer Cox, dans le St Nicholas Magazine de New York, à la fin du XIXe siècle, et les Teenie Weenies de William Donahey dans le Chicago Tribune, dans les années 1920. Au cinéma, les nains du Blanche Neige de Walt Disney, obéissent grosso modo au même principe : ils se distinguent, y compris morphologiquement, par leurs attributs, soit d'état (Prof), soit de nature (Atchoum, Simplet, etc.). Tirer d'un procédé de l'humour graphique des interprétations de type idéologique, comme le fait M. Buéno (les Schtroumpfs étant supposés, du fait de leur stéréotypie et de leur comportement de groupe, incarner une utopie totalitaire, soit fasciste/nazie, soit stalinienne), — et, a fortiori, tirer des interprétations de l'organisations sociale supposée des Schtroumpfs (en déduisant par exemple des spécialisations professionnelles un mode d'organisation économique sur le modèle de la corporation) — relève de l'aberration mentale. On pourrait démontrer au moyen des mêmes sophismes que les Brownies de Palmer Cox sont eux aussi imbus de nazisme et de stalinisme, alors qu'ils précèdent l'invention de ces idéologies d'un demi-siècle.
M. Buéno conclut son essai en se félicitant du succès de son entreprise et en lançant un appel pour que soit appliqué le même type d'analyse paranoïaque à n'importe quelle autre œuvre en apparence innocente et qui aurait la faveur du public. Que M. Bunéo soit, comme nous le croyons, dans la facétie, ou qu'il ait fini par croire à ses propres romans (ou plus exactement aux thèses que défendent les personnages de ses romans), force est de constater, au vu de l'incroyable faveur médiatique que rencontre son calamiteux pensum, qu'il n'est pas sans danger de proposer de tels programmes à l'encontre de littératures qui, comme nous l'écrivions naguère, ont été constamment victimes des discours qu'on tenait sur elles.
LIVRES REÇUS
GRANT MORRISON (R)ÉVOLUTIONS
Yann Graf
Les Moutons électriques, Bibliothèque des miroirs, 2011
Monographie sur un scénariste britannique vedette, pilier de la collection Vertigo, qui appliqua dans un second temps ses idées iconoclastes aux comics mainstream, redéfinissant par exemple la Justice League of America, les X-Men et Superman. M. Graf présente sur 150 pages un scrupuleux historique de l'œuvre de l'inventif Écossais, où ne manquent ni un back-up, ni un synopsis refusé, ni même une idée lancée en l'air. Afin d'éviter que le lecteur ne se perde, les travaux importants bénéficient d'un encadré.
Dans un second temps, l'auteur présente sur 50 pages une analyse formelle, claire et intelligente. L'amateur regrettera cependant que M. Graf n'interroge pas les prétentions parfois exorbitantes de son auteur, le caractère iconoclaste d'une idée ne la rendant pas nécessairement géniale et notre scénariste n'étant parfois pas loin du détournement de mythe.
LIVRES REÇUS
COMIC : INTERMEDIALITÄT UND LEGITIMITÄT EINES POPKULTURELLEN MEDIUMS
Thomas Becker (HG.)
Ch. A. Bachmann Verlag, 2011
Cet ouvrage, destiné au grand public cultivé, constitue les actes d’un colloque tenu à la Freie Universität de Berlin en novembre 2009. Le volume donne une bonne idée de la recherche savante sur les littératures dessinées en langue allemande. Les fils conducteurs de la recherche sont l’intermédialité (les comics étant une forme d’art universellement définie comme hybride) et la question de la légitimité d’une forme littéraire considérée comme relevant de la culture populaire.
Ces deux questions de la légitimité et de l’intermédialité donnent lieu à l’émergence de deux problématiques, la première de nature sociologique, la seconde de nature esthétique.
Sur un plan sociologique, les contributeurs à ce volume s’accordent en général à reconnaître que la bande dessinée ne se situe ni tout à fait dans la culture de masse ni tout à fait dans la culture savante. (C’est peut-être cette indétermination qui conduit Dietrich Grünewald (« Die Welle ») à proposer comme outil pédagogique le graphic novel allemand, par Stefani Kampmann, tiré du célèbre roman La Vague de Tod Strasser (Morton Rhue) : pour le contenu, c'est une bande dessinée ; pour la forme, c'est un « vrai » livre, paru chez Ravensburger.) Dans l’ensemble, nos auteurs font preuve d’un optimisme prudent pour ce qui concerne la possibilité du développement d’une bande dessinée d'auteur, dans une perspective le plus souvent évolutionniste. Bernd Dolle-Weinkauf (« Vom Autoren-Comic zum Comic-Roman ») identifie ainsi les sources du graphic novel dans la bande dessinée française d’auteur des années 1960. Stephan Ditschke (« Die Stunde der Annerkennung des Comics ») étudie les références aux graphic novels dans cette institution germanique qu'est le « feuilleton », autrement dit la chronique littéraire, très sensible à l'air du temps, des grands journaux d'outre-Rhin.
S'il est une référence sociologique qui domine la pensée de nos auteurs, c'est celle à Pierre Bourdieu. Thomas Becker, organisateur du colloque et editor de ces actes, est un enragé bourdieusien, et c’est en termes d’accumulation du capital culturel qu’il analyse la légitimation des comics (« Comiclibido der Nouvelle Vague un die Folgen »). Chemin faisant, notre auteur trace un parallèle entre Moebius et Jean-Luc Godard, dans une esthétique de l’exagération. Jaqueline Berndt, dans une présentation de l’International Manga Museum de Kyoto (« Manga museal, oder : Wer legitimiert wen ? »), dépayse la problématique de la légitimité en montrant l’ambiguïté de la notion même de musée des mangas, l’institution en question fonctionnant somme toute sur le modèle ludique d’une gigantesque bibliothèque.
En ce qui concerne l’esthétique, c’est à la fois la dimension universelle de la bande dessinée et les problèmes de l’hybridation qui sont soulevés. Friedrich Weltzien (« Hybrider Legitimationsdruck ») reprend cette dernière question à son origine, dans sa communication sur la bâtardisation du texte et de l’image chez Töpffer, et il refait un constat déjà fait en France par un Thierry Groensteen : l’hybridation des formes est à l’origjne du déficit de légitimité des comics.
Cette problématique de l’hybridation conduit Jörn Ahrens (« Übersetzungsprobleme ») à comparer Sin City en bande dessinée et au cinéma. Jakob F. Dittmar (« Grenzüberschreitung ») étudie quant à lui le dessin technique (par exemple les notices de montage d'une armoire Ikea en images muettes) et le pop-up book comme formes limitrophes de la bande dessinée. Sebastian Gießmann (« Im Theater der Operationen ») examine le motif du tourbillon comme forme diagrammatique tendant à s’échapper du dispositif, chez Marc-Antoine Mathieu.
Harry Morgan (« Gibt es eine Ästhetik des Comics ? ») se demande s’il existe une esthétique propre aux comics et tend à répondre par la négative, tout en identifiant des constantes commandées par les contraintes graphiques et narratives de ces littératures (simplification du trait, caractère signifiant du tracé de contour). L’auteur oppose la « belle ligne », d’un tracé ferme, à une ligne informe et incomplète, qui est plutôt l’apanage du dessin d’humour, mais qui passe dans la bande dessinée à la fin du XXe siècle.
Il faut noter encore que ces deux problématiques, de la légitimité et de l’esthétique, se rejoignent sans cesse. Eva Kristin Stein, dans son étude sur le vertige (« Schwindel, eine illegitime Erfahrung für Superhelden »), pose en principe que les comics sont des dérivés du cinéma (ce qui choquerait beaucoup de stripologues français) qui ont fini par développer leurs propres solutions, en particulier dans les problèmes de focalisation et de point de vue subjectif.
L’ensemble des communications est d’un sérieux tout germanique et les auteurs multiplient à l’envi les références savantes, ce que leurs confrères de l'aire francophone n’osent plus faire (et qu’ils ont peut-être moins besoin de faire, parce que la stripologie française s’est largement constituée comme science autonome). Sont convoqués ainsi par nos auteurs, non seulement le canon de la sémiologie (Peirce), de la théorie littéraire (Bakhtine) ou de la narratologie (Monika Fludernik), sans compter l'indispensable Bourdieu, mais aussi la philosophie dans son intégralité (d'Aristote à Heidegger et à Deleuze). Paradoxalement, nos auteurs se montrent à la fois d’une extrême prudence dans leur approche des problèmes soulevés et d’une singulière audace dans certaines conclusions tirées. Ceci n’est pas sans lien avec la littérature secondaire convoquée. Si les corpus de littérature secondaire germanophone, et dans une moindre mesure anglophone, sont connus et dûment cités, les auteurs ignorent dans leur ensemble la littérature secondaire francophone, sans doute à cause de la barrière de la langue. Ceci les amène à problématiser des question qui, pour un stripologue français, seraient considérées comme résolues depuis longtemps.
Notons pour finir que la question de la légitimation des littératures dessinées, et les questions subséquentes de leur originalité et de leur intérêt sur le plan esthétique, se posent de façon très abrupte dans l’aire culturelle germanique, qui a très longtemps fait une distinction nette entre littérature noble et littérature populaire (Trivialliteratur).
LIVRES REÇUS
MYTHE ET SUPER-HÉROS
Alex Nikolavitch
Les Moutons électriques, Bibliothèque des miroirs, 2011
Abstraction faite de l’introduction et du début du premier chapitre, consacrés au mythe, on trouvera dans cet ouvrage un plaisant panorama, fort documenté, des principaux super-héros, leur description comme une « mythologie moderne » faisant partie du reste de la littérature critique française depuis les années 1960. L’auteur nous montre sous la forme d’un puzzle l’évolution des Superman, Batman et consorts, en témoignant d’une compréhension fine des stratégies éditoriales de DC, de Marvel et de leurs concurrents.
Sur le plan esthétique, nous ne ferons reproche à l’auteur que d’une phrase, qui nous paraît inexcusable. Parlant des années 1960 et des comic books, l’auteur écrit que « en tant que forme d’art, la bande dessinée en est encore au mieux à l’époque dans une phase d’adolescence ».
Comme ouvrage d’introduction, comme ouvrage de critique, le tome de M. Nikolavitch n'en conserve pas moins toute sa valeur. Malheureusement, on ne peut pas dire la même chose sur le plan scientifique. Le sujet annoncé avec pompe au début de l’ouvrage, celui du mythe, référence à Dumézil à l’appui, n’est tout simplement pas traité. Pour commencer, l’auteur confond mythe et mythologie. Mais de surcroît, il est incapable de se tenir à ses propres définitions, et il qualifie les séries qu’il analyse de « mythiques » parce qu’elles ont des liens lâches avec un mythe connu, parce que leur structure même serait celle du mythe, parce qu’elles mettent en scène un univers complet et ordonné, parce qu’elles relèvent de la science-fiction (et la science est, comme chacun sait, un mythe moderne), parce que leurs personnages sont des « mythes littéraires » comme Faust et Madame Bovary, et pour maintes autres raisons encore (« mythique » est aussi, tout simplement, un qualificatif mélioratif dans le fandom, qui se situe approximativement entre « incontournable » et « culte »).
Dernière observation : le médium bande dessinée n’est jamais pris en compte. C’est d’autant plus regrettable que la propre collection dans laquelle paraît l’ouvrage de M. Nikolavitch abrite un volume de MM Morgan et Hirtz sur la structure mythique des univers dessinés de Jack Kirby, dont la méthode consiste précisément à partir des contraintes graphiques, narratives et éditoriales, pour arriver à la création du mythe. En le lisant, Alex Nikolavitch aurait découvert par exemple que le chaos, sur lequel il disserte à l'envi en n’en tirant rien et en ne concluant rien, relève dans le cas de Kirby d’une structure topologique tout à fait originale et s’intègre dans une cosmogonie particulière.
LIVRES REÇUS
FRANK MILLER : URBAINE TRAGÉDIE
Jean-Marc Lainé
Les Moutons électriques, Bibliothèque des miroirs, 2011
Jean-Marc Lainé propose tour à tour un historique scrupuleux des travaux de Frank Miller, une introduction au « Millerverse », un catalogue descriptif des sujets fétiches du dessinateur, le roman noir, le Japon, le catholicisme, les médias, etc. Ajouter un consistant chapitre sur Miller et la politique, où l’auteur du Dark Knight est décrit comme un individualiste de droite. Jean-Marc Lainé achève sur les rapports de Miller avec le cinéma.
On regrettera que notre auteur ne dégage pas plus nettement ses conclusions. Si nous lisons bien, à partir de Sin City, le dessinateur n’a plus fait que décliner son œuvre précédente. Ceci aurait gagné à être dit clairement.
On eût également apprécié que l’auteur fît jouer entre elles certaines de ses analyses. Il nous dit fort justement que Miller est un disciple de Steve Ditko. Il constate d’autre part que le protagoniste de Sin City est graphiquement apparenté aux personnages de Jack Kirby. Mais dès lors, cette dichotomie-même n’est-elle pas à l’origine de la tension dramatique de Sin City ? M. Lainé se garde bien de conclure.
RÉFLEXIONS NARRATOLOGIQUES
LE FANTÔME ET LE RÉFLECTEUR
THE INNOCENTS DE JACK CLAYTON
Revu The Innocents (1961) de Jack Clayton d’après The Turn of the Screw de Henry James. C’est une adaptation fidèle de la longue nouvelle de James, le seul élément de bizarrerie provenant de l’auteur du script, Truman Capote, qui a introduit dans le domaine de Bly une ambiance de décadence morbide à la Poe, au point qu’on doute si l’on est en Angleterre. Cependant l’ambiguïté sur la nature des événements du récit de James, qui est conforme au canon du récit de fantômes victorien (les enfants sont-ils possédés par des revenants ou la gouvernante imagine-t-elle toute l’histoire ?), n’est guère maintenue dans le film, puisque seule la gouvernante, Miss Giddens, voit les fantômes. Les enfants ne les voient pas. On pourrait certes penser qu’ils mentent, surtout s’ils sont possédés, encore que le cri du cœur de la petite Flora, qu’elle ne voit rien, qu’elle n’a jamais rien vu et que Miss Giddens est cruelle et méchante, apparaît des plus sincères. Mais au surplus, la brave et innocente Mrs Grose ne les voit pas non plus.
Le fait est cependant que le spectateur, lui, les voit, ces terribles fantômes, en même temps que Miss Giddens.
Dans ces conditions, il est probable que le film change de sens selon le degré de litératie du spectateur.
• À un premier degré de litératie, celui du public filmiquement peu éduqué, ce que montrent les images fait foi. Dans ce cas, le film est équivoque puisque, d’une part, on voit bel et bien des fantômes, mais qu’il est suggéré très fortement d’autre part que la gouvernante est toquée et qu’elle persécute les enfants. Le résultat le plus probable est que le spectateur ne comprenne pas grand chose au film.
• À un degré de litératie plus élevé, le spectateur rapporte ce qu’il voit au point de vue d’un personnage (que James, précisément, appelait un réflecteur). Le film devient alors parfaitement univoque. Une gouvernante névrosée et sans expérience imagine la possession de deux enfants normalement pervers et qui ont subi l’influence de deux domestiques à la moralité douteuse (une gouvernante et un palefrenier), morts tous deux. La petite fille en est quitte pour être réduite par la gouvernante persécutrice à un état d’hystérie, mais le petit garçon que la gouvernante séquestre à Bly dans un terrible face à face meurt de choc nerveux (?).
Cependant, dans cette seconde lecture, le fait que le spectateur voie les fantômes — et qu’il les voie frontalement — quand la gouvernante les voit, n’est pas sans poser des problèmes théoriques. Freddy Buache, qui considère le film strictement comme l’étude d’une névrose, trouve que les fantômes montrés frontalement sont une erreur théorique. Constatant que la nouvelle de James est narrée par la gouvernante, Buache écrit : « Clayton a mal défini la place de celui (ou de celle) qui parle en utilisant la caméra. Du coup, il commet plusieurs erreurs, notamment celle qui consiste à visualiser certaines « apparitions » alors que la perspective dramaturgique choisie commandait impérativement de les suggérer. » (Le Cinéma anglais, L’Âge d’homme, 1978, p. 174.)
Que d’approximations théoriques en si peu de lignes ! Pour commencer, la comparaison avec le récit de James narré à la première personne par la gouvernante n’a aucune pertinence, précisément parce que les images d’un film ne sont « narrées » par personne. Personne ne « parle en utilisant la caméra », n’en déplaise à Freddy Buache et aux théoriciens qui postulent que tout « récit », fût-il imagier, a un « narrateur ».
En second lieu, le choix de Jack Clayton de visualiser les apparitions ne peut être étiqueté comme une bévue, même répétée, car il est la convention fondamentale du film, qui fonctionne bel et bien, quoi qu’en dise Buache, la meilleure preuve étant qu’il flanque une peur bleue à une proportion non négligeable de ses spectateurs.
The Innocents repose tout entier sur le fait que les fantômes sont visibles dans le même plan que la gouvernante (le bas de la robe de Miss Jessel passe au bout du couloir que longe Miss Giddens, le palefrenier Quint sort de l'obscurité de la terrasse alors que Miss Giddens joue à cache-cache derrière le rideau, Miss Giddens découvre Miss Jessel assise au bureau de la salle d’étude). Ces plans sont repris aussitôt en ocularisation (on voit alors ce que voit Miss Giddens, le terrifiant palefrenier Quint écrasant sa tête sur la vitre et respirant lourdement, Miss Jessel tout au bout de la longue salle d'étude, ou debout au bord de l’étang).
Du fait de cette visibilité des fantômes, Deborah Kerr, affublée de la même robe noire que le fantôme de Miss Jessel, acquiert le même statut sémiotique que cette dernière, et devient à son tour une sorte d’anti-fantôme, à telle enseigne qu’elle traverse elle aussi les rideaux (de feuillage en l’occurrence) pour venir hanter Flora qui danse dans la gloriette sur le lac.
Pourquoi dire alors que le film est raté, que cet effet ne peut pas fonctionner ? Le raisonnement sous-jacent à la critique de Buache est vraisemblablement le suivant : dans la novella de Henry James, on peut montrer sans inconvénient l’apparition des fantômes, puisque le récit entier est de la main de Miss Giddens et qu’il est donc subjectif par définition (après tout, il est parfaitement possible que cette dame travaille du bonnet et qu’elle appartienne par conséquent aux unreliable narrators dont la narratologie anglo-saxonne a fait ses choux gras depuis Wayne C. Booth). Mais au cinéma, dès lors qu’on verrait dans le même plan Miss Giddens, bien réelle, et le fantôme de Miss Jessel, tout aussi réel, c’en serait fait de l’ambiguïté, les fantômes seraient bien là. D’où la conclusion de Buache : « la perspective dramaturgique choisie commandait impérativement de les suggérer. » Selon Buache, si l’on est « au point de vue » de Miss Giddens, il faudrait indiquer au spectateur, par quelque artifice (floutage ? bougé ? coup de gong dans le lointain ?), que ce que voit cette dernière est peut-être imaginaire. Faute d'un tel artifice, montrer Miss Jessel dans le même plan que Miss Giddens, reviendrait — encore une fois — à affirmer que Miss Jessel était bel et bien assise au bureau de la salle d’étude.
Or je crois qu'il faut, pour bien comprendre ce qui se passe dans le film de Jack Clayton, introduire, à la suite du théoricien de la littérature (écrite) Franz Karl Stanzel, la distinction entre perspective et mode (distinction que j'ai, pour ma part, triomphalement introduite dans l'analyse des littératures dessinées). La perspective est une notion à la fois visuelle et cognitive. Elle peut être externe ou interne. Si elle est externe, l’action est vue de loin (aspect visuel) et par conséquent elle est vue aussi dans son ensemble (aspect cognitif). Si la perspective est interne, on est « dans l’action » (aspect visuel) et par conséquent notre connaissance en est limitée (aspect cognitif). Le mode est une notion technique relative à l’agent de transmission. Soit le récit est le produit d’un narrateur, soit il passe à travers un personnage de réflecteur, au sens de James. Comme ces notions de perspective et de mode sont distinctes, le fait que Miss Giddens et Miss Jessel apparaissent dans le même plan et pour ainsi dire d’égales à égales, ne signifie nullement que l’apparition de Miss Jessel serait parfaitement constatable le cas échéant par la Society for Psychical Research. Ce qu’on voit est bel et bien référé à la gouvernante, qui est le réflecteur. Du reste, l'étagement perspectif des plans facilite la lecture modale. Quand on voit les fantômes de Miss Jessel ou du palefrenier Quint dans le même plan que la gouvernante, ils sont toujours derrière elle, ce qui montre qu'elle est le personnage de réflecteur.
On peut donc conclure que The Innocents repose sur la combinaison « perspective intérieure » et « mode réflecteur » et en tire ses effets terrifiants. Un puriste dirait qu’on n’est en perspective intérieure qu’en cas d’ocularisation (correspondant au cinéma à la caméra subjective : on voit strictement ce que voit le personnage), mais c’est un peu trop demander. Il y a évidemment un gain narratif immédiat à étager les plans en mettant le personnage devant et ce qu'il voit au fond. De cette façon, le spectateur voit pour ainsi dire par dessus l’épaule de Miss Giddens et il a peur avec elle. L'effet est encore plus réussi dans le cas des personnages enfants. Miss Giddens veut les obliger à dire qu'ils voient un être que le spectateur voit aussi, mais qui n'existe pas.
RÉFLEXIONS NARRATOLOGIQUES
LE MOTIF DU SOSIE DANS A TALE OF TWO CITIES
Je relis A Tale of Two Cities (1859) de Charles Dickens, puis le comic book qui en a été tiré dans la collection des Classics Illustrated (n° 6, édition de 1964, dessiné par Joe Orlando), après quoi je revois la belle adaptation filmique réalisée par Jack Conway pour la MGM en 1935. Le maître de l’intrigue qu’est Dickens use d’un effet dramatique très sûr. La ressemblance entre l’accusé Charles Darney et le barrister Sydney Carton est assez forte pour que, au premier cinquième du roman, un témoin ne puisse plus identifier Darnay à coup sûr, de sorte que le procès de Darnay à l’Old Bailey pour intelligence avec les rebelles américains échoue.
À la fin du roman, c’est cette même ressemblance qui permet à Sydney Carton de se substituer à Darnay à la Conciergerie et de mourir à sa place sur la guillotine.
Il est instructif de comparer l’adaptation dessinée et l’adaptation filmée d’un pareil motif. Le comic book reste en-deçà du motif romanesque. Les deux scènes sont simplement illustrées, sans que leur point commun, la ressemblance entre Darney et Carton, soit le moins du monde mise en avant, et il est même possible que le scénariste n’ait pas du tout repéré le motif qui les relie. Le récit dessiné (c’est d’ailleurs la faiblesse générale des Classics Illustrated) se présente comme un simple bout à bout d’illustrations, plus ou moins heureuses, sur un canevas qui est un résumé du roman.
Inversement, l’adaptation à l’écran va au-delà du motif romanesque de la ressemblance, qui est de toute évidence jugé insuffisant pour faire une bonne histoire. Aussi le film double-t-il ce motif, le recouvre-t-il exactement d’un autre motif qui est une complexe histoire de chantage. Sydney Carton s’arrange pour rencontrer John Barsad, qui est, dans le film, le témoin-clé contre Darnay, et se saoule crapuleusement avec lui. Carton confie des crimes imaginaires et Barsad décrit en revanche comment il est en train de faire condamner à mort Darnay à l’Old Bailey, en portant faux témoignage contre lui. Lors du procès, Barsad reconnaît donc dans Carton, au moment où celui-ci ôte dramatiquement sa perruque, non seulement une sorte de sosie de Darnay, mais aussi et surtout son compagnon de beuverie de la veille, et un possible maître-chanteur, et c’est précisément pourquoi Barsad se récuse, en ne reconnaissant soudain plus l’accusé.
De façon similaire, au moment de la substitution fatidique à la Conciergerie, Carton menace Barsad de révéler qu’il espionne pour le compte des Anglais, pour l’obliger à devenir son complice. C’est donc à la fois la ressemblance entre Carton et Darnay et le fait que Carton fait chanter Barsad qui permettent la substitution. Dès lors, la scène du procès de Darnay à l’Old Bailey fonctionne, conformément au régime narratif du cinéma hollywoodien, comme la scène source dont la scène de substitution à la Conciergerie constitue la réplique.
Reste qu'il est curieux que le motif des sosies se suffise à lui-même en littérature écrite, alors qu’il est insuffisant dans un récit filmique. Mais le motif imagier des sosies est étranger à la matière même du roman de Dickens, qui est langagière, nonobstant les illustrations, et le romancier peut donc tirer le meilleur parti de cette ressemblance, en y recourant comme à quelque chose de transcendant, Darnay et Carton finissant par devenir pour Dickens, de façon quasi fantastique, le même homme dans sa version lumineuse et sa version ténébreuse. Au cinéma, par contre, qui repose par définition sur l’image, le motif devient un peu trop évident, et c’est par conséquent par les péripéties qu’il faut mettre en lumière la logique du récit. On aurait pu imaginer cependant une version radicale de A Tale of Two Cities, où Darnay et Carton seraient joués par le même acteur. Une telle version aurait pu se passer du motif du chantage en insistant sur cette ressemblance véritablement miraculeuse et en confrontant dans le même plan, par toutes sortes de trucages, les deux personnages joués par le même acteur, comme le cinéma l’a fait si souvent.
VIEILLES LUNES
UNE BELLE ÉTUDE DE CONTENU
L’autre semaine, les presses universitaires de Strasbourg soldaient leur fonds en appliquant le sage principe « tout à un euro ». Nous y avons récupéré Jeunesse et livre en zone française d’occupation 1945-1949, de Monique Mombert, paru en 1995, excellent travail d’historien sur la politique du livre dans le cadre de la rééducation de la jeunesse allemande, ainsi que L’Europe en automobile (2009), actes d’un excellent colloque consacré à Octave Mirbeau écrivain-voyageur, qui s’était tenu pour le centenaire de la parution du récit automobile La 628-38 (1907).
Nous avons aussi dégotté dans cette grande braderie du savoir Le Livre pour adolescents et ses fonctions, actes d’un colloque tenu en 1978, chastement reliés à l’aide d’un épais ruban adhésif de couleur noire, sous une couverture en papier marron. Le contenu est à la hauteur du contenant, les communications se révélant d’un vide abyssal, et les chercheurs partageant une ignorance à peu près complète du sujet dont ils sont en théorie des spécialistes. Quant aux éditeurs invités, ils entreprennent de vanter leur marchandise en dénigrant au passage leurs collègues, le pompon revenant à Walter Lewerenz, venu de RDA, qui explique, guilleret, que le but des éditions Neues Leben est de décerveler les jeunes Allemands de l’Est pour en faire de bons communistes.
Comme il n’y a pas, à cette époque-là, de bon colloque sur la littérature de jeunesse sans au moins une communication incohérente sur les littératures dessinées, Freddy Raphael et Josiane Brupacher nous gratifient d’une étude de contenu d’hebdomadaires de bandes dessinées, étude charitablement intitulée « Aspects de la presse-gadget : Tintin, Pif et Spirou. »
Notons d’abord que rien ne justifie cet intitulé de « presse gadget » hormis la volonté de dénigrer (il n’y a que Pif qui offre un gadget à ses lecteurs). Le choix de ces trois hebdomadaires pour jeunes, parmi la dizaine de ceux qui existent alors, n’est pas davantage justifié (où sont le Journal de Mickey, l’écologiste Pistil, les illustrés catholiques ?) Quant à la brièveté de la période étudiée (on nous précise que « la présente étude a débuté en 1976 et s’insère dans un travail plus vaste »), elle amène les auteurs à poser que « Tintin abandonne les bandes policières américaines (exemple de Steve Canyon ou Agent secret X9) au profit des aventures (exemple Corin Section R ou Taka [sic pour Corentin, Section R ou Taka Takata]) ». Il se trouve que Tintin fut brièvement confié aux soins de Paul Winkler pour une nouvelle série, commencée le 16 septembre 1975. L’intéressé en profita évidemment pour remplir le journal des bandes américaines que diffusait son agence de presse, Opera Mundi, ou des bandes qu’il faisait produire par l’agence elle-même. Mais comme l’intermède Winkler dura moins d’un an, ce que les auteurs notent du reste (« le journal a changé deux fois de main en un an : il a passé de Dargaud à Edi-Monde puis à Ifford »), on ne peut strictement rien tirer de « l’abandon des séries américaines ». Elles ne figuraient pas au sommaire de Tintin un an plus tôt, elles n’y figureront plus un an plus tard. Mais la prudence n’est décidément pas le fort de nos chercheurs qui écrivent : « Tintin illustre parfaitement l’exemple [sic] du journal évoluant au gré de la production commerciale de bandes dessinées : en 1976, la bande dessinée américaine de science-fiction ou policière domine alors qu’en 1978 les séries belges font leur apparition. »
Mais c’est l’analyse de fond de nos deux énergumènes qui pose le plus de problèmes. Voici un extrait de leur conclusion : « Par l’utilisation de thèmes douteux (mythe du bon blanc sauveur dans Chinatown ou Doc Justice) et un conformisme troublant, ces bandes dessinées véhiculent à travers l’image qu’elles donnent de leurs héros, un mode de pensée réactionnaire. Le héros n’hésite pas à employer la force et la violence pour mener à bien une action qui se justifie par elle-même. » (p. 146). Cette charge contre le héros justicier, vieil ennemi des éducateurs hostiles à la bande dessinée (c’est le héros « bagarreur » dénoncé pendant toutes les années 1950 et 1960 par les professionnels de l’enfance œuvrant à la Commission de surveillance) est ici réactivée par une référence à Vicky du Fontbaré (« Codes culturels et logique de classe », dans le célèbre numéro 24 de la revue Communications (1976)).
Les mystères de Chinatown (dans Tintin), Dr Justice (dans Pif-Gadget). Il était impossible aux auteurs de plus mal choisir leurs exemples.
Le docteur Justice n’est pas, contrairement à ce que soutiennent nos chercheurs, « le bon blanc en mission en Corée du Sud qui met ses qualités de militaire et de lutteur (éloge des arts martiaux) au service de sa mission accomplie avec sagesse et intelligence », mais un médecin volant attaché à l’OMS, qui exerce ses fonctions aux quatre coins du monde. Il pratique les arts martiaux parce que c’est à la mode dans la fiction du temps, tout simplement, et il a été le disciple d’un vieux maître japonais donné comme un humaniste dépositaire de la sagesse orientale. Il y a pire comme incarnation du militaire bien blanc et bien réactionnaire. De surcroît, le scénariste Jean Ollivier s’arrange pour glisser un discours explicitement antiraciste dans la plupart des épisodes, sans craindre la lourdeur.
Quant aux Mystères de Chinatown, dessinés par Antonio Parras sur scénario de François Truchaud pour Tintin, il s’agit d’une série semi-humoristique (ce que nos chercheurs ne jugent pas utile de relever), mettant en scène un détective qui est un sympathique benêt, assisté par une adolescente chinoise qui résout l’énigme à sa place, épisode après épisode, et lui sauve la vie de surcroît, avant de lui laisser, bonne fille, s’attribuer la gloire de ses enquêtes. Par ailleurs, le message récurrent de la série est que les Chinois des États-Unis sont, par-delà leur particularisme culturel, des Américains comme les autres. Ici encore, le mythe du blanc sauveur des inférieurs de couleur paraît sérieusement malmené.
La conclusion qui s’impose est donc que nos chercheurs pratiquent le procès d’intention, puisqu’une série montrant un blanc face à des non-blancs est forcément entachée à leurs yeux, sinon de colonialisme, du moins d’ethnocentrisme, alors même les séries incriminées se démarquent clairement d’un tel modèle (qu’on trouvera tout à fait clairement par contre, et assez tard dans le siècle, dans la presse confessionnelle des éditions de Fleurus et des éditions Bayard). Rappelons au surplus que dans le Tintin que sont censés étudier nos universitaires paraissent Buddy Longway de Derib, Jonathan de Cosey, Simon du fleuve d’Auclair. On n’est pas plus réactionnaire !
Et que dire de l’analyse de nos savants quant au statut de la femme dans les séries étudiées ? « les rôles féminins quasi-inexistants, se réduisent à des personnages d’associées : faire-valoir ou traîtresse, la femme s’inscrit dans un rapport de force avec le héros. Le mode de l’action, voire de l’engagement (ou du changement) relève de décisions masculines, auxquelles les femmes ne participent que de façon accessoire (rôle de matrone, rôle d’épouse) ou ambiguë (rivalité, comme dans le cas de Jeannot et de Corinne). » (p. 147) Soit. Mais dans le Spirou de la période étudiée, pour nous borner à cet exemple, on trouve Yoko Tsuno de Leloup, Natacha de Walthéry, Isabelle de Will, Sophie de Jidéhem et Sibylline de Macherot. Rôles féminins inexistants ? Personnages accessoires ? Comme on le voit, ici encore, l’absence de méthodologie scientifique se combine au préjugé et à l’intention démonstratrice. Nos chercheurs piochent au petit bonheur, à l’intérieur de ce qui leur tient lieu de corpus, ce qui peut à la rigueur conforter leur thèse. Et on ne convaincra pas M. Raphael et Mme Brupacher que la bande dessinée franco-belge des années 1970 peut tenir un discours féministe, comme elle peut tenir un discours antiraciste ou progressiste, parce M. Raphael et Mme Brupacher ont décidé au départ que la bande dessinée, c’était forcément mauvais. La fameuse étude de contenu n’a pas d’autre fonction que de retrouver ce postulat implicite. — Manuel Hirtz
Depuis maintes années, les tintinophiles se plaisent à pratiquer sur le corpus hergéen une critique généalogique, en cherchant sources et influences. Mais il nous semble qu'on n'ait pas encore convoqué Edgar Wallace (1875-1932).
Wallace fut un auteur prolifique de romans policiers, genre dominant dans les années 1920 (mais le policier wallacien intègre nombre d'éléments du roman populaire), et il fit partie des lectures obligées de la petite-bourgeoisie européenne. The Avenger (1925, publié aux États-Unis sous le titre The Hairy Arm, et traduit en France sous le titre Le Vengeur) pourrait bien avoir inspiré L'Île noire (1937). On y trouve en effet un personnage singulier.
« C'était un grand orang-outan de plus de deux mètres de haut qui, voûté, mi-assis, examinait le visiteur de ses yeux malins. Sa poitrine velue était énorme, ses bras, qui touchaient presque le plancher, était presque aussi épais qu'une jambe humaine. Il était habillé d'un pantalon de toile bleue retenu par des bretelles qui se croisaient sur son large dos.
Bhag ! appela sir Gregory d'une voix si douce que Brixan put à peine l'entendre. Viens ici.
La bête gigantesque traversa la pièce à grand pas. »
Sir Gregory, un riche débauché, essaie d'enlever la jeune héroïne à l'aide de son orang-outan. (Rappelons qu'Edgar Wallace aimait les grosses bêtes puisqu'il écrivit le scénario de King Kong.) À la fin du récit, Bhag trouve refuge dans un château en ruines, Griff, et le lecteur a droit à une confrontation finale dans les souterrains du château. Edgar Wallace et Hergé partagent donc deux topoï, le château en ruine, la caverne, et un personnage, l'orang-outan, devenu un gorille dans l'album de Hergé. Y a-t-il ici une réminiscence ? C'est ce qu'il est impossible de déterminer, précisément parce que les éléments remployés par Hergé sont ceux de la littérature d'aventures (la tour en ruine, le souterrain). Quant au grand anthropoïde occupant la position quasi-humaine du subalterne muet, il a été réactivé au cinéma, en 1932, avec Murders in the Rue Morgue, le beau film de Robert Florey avec Bela Lugosi.
Retenons seulement que le monde hergéen, monde clos sur lui-même et qui frappe par sa singularité, est bâti avec des fragments de la fiction populaire du temps, que l'œuvre du maître belge transcende et immortalise. — Manuel Hirtz
La Cité de la bande dessinée met régulièrement en ligne des dossiers parus autrefois dans la revue Neuvième Art, ce qui leur donne une nouvelle jeunesse et leur ouvre un lectorat bien plus vaste que celui de cette très belle mais assez austère revue. En relisant sur la Toile, au milieu d'un dossier consacré à Art Spiegelman, mon propre article, datant de 2004, sur les rapports de Spiegelman avec le New Yorker, je retrouve deux caractéristiques de mon style, qui sont, premièrement, ma tendance à me plonger sans crier gare dans des propositions théoriques et, deuxièmement, ma propension à pousser des hurlements lorsque je détecte l'odeur de la sottise, de la démagogie ou du snobisme.
Mon morceau (mal écrit au demeurant, et qui a l'air d'avoir été pensé en anglais et transcrit hâtivement en mauvais français) démarre ainsi :« Pour ceux qui ne lisent pas le magazine ou qui le lisent irrégulièrement, les couvertures de Spiegelman fonctionnent métonymiquement pour celles de tous ses confrères, et même un peu pour le New Yorker tout entier. (Des critiques bien intentionnés ont noté à diverses époques de la vie du magazine que le New Yorker était plus remarquable graphiquement que pour son contenu et, à la limite, que c’était de très loin le meilleur magazine pour des gens ne sachant pas lire.)
Spiegelman entra au New Yorker en 1993, dans les valises de Tina Brown, rédactrice en chef dans le bon ton, arrivée à la direction de l’hebdomadaire l’année d’avant dans l’intention de donner un coup de jeune à cette vénérable institution, mais qui arriva seulement à rendre le magazine toc et prétentieux, tout en se mettant l’équipe à dos et en dégoûtant les lecteurs. »
REVUES REÇUES
BANANAS n° 3
REVUE CRITIQUE DE BANDE DESSINÉE
Rédaction Évariste Blanchet
22 Bd du Général Leclerc B5, 95100 Argenteuil
janvier 2011
Quand parut Bananas n° 2, dans l'hiver 2006-2007, il existait, en fait de revues d'études, Neuvième Art, publié par la Cité de la bande dessinée d'Angoulême, L'Éprouvette de Jean-Christophe Menu, qui connut trois numéros, fort épais, et Comix Club, que les éditions Groinge nous donnaient avec une régularité métronomique. Aujourd'hui, il n'y a plus que Bananas, et son existence même prend donc valeur de manifeste.
Ce numéro s'ouvre sur une étude de Dominique Petitfaux qui rend compte des recherches de son cercle d'érudits, et des siennes propres, sur la période anglaise de Hugo Pratt. David Turgeon procède à une intelligente réhabilitation de la part maudite de l'œuvre de Raymond Macherot, les aventures de Sibylline, et explique de quelle façon il conviendrait de rééditer ce corpus (rappelons qu'il en existe 250 pages, non reprises en album, parues dans l'hebdomadaire Spirou).
Evariste Blanchet se penche sur les débuts dans Spirou d'Archie Cash, qu'il propose comme une petite rupture dans l'histoire de la bande dessinée belge. Renaud Chavanne donne une conférence sur la composition de la planche, prononcée naguère à la Conciergerie, et qui fait le pont entre ses deux ouvrages, Edgar P. Jacobs et le secret de l'explosion (PLG, 2005) et Compositions de la bande dessinée (PLG, 2011).
Un long entretien avec Georges Pichard, partiellement paru dans Bédé X, nous fait découvrir un homme charmant, extrêmement cultivé, sans aucune illusion sur la nature humaine, qui tient à s'éloigner autant qu'il est possible de la bande dessinée érotique bas de gamme qu'il appelle « des petites éditions bon marché pour obsédés », qui renvoie dos à dos le puritanisme religieux et l'hédonisme, et qui note à très juste titre que, pour ce qui est de la censure, ce sont les socialistes qui se sont montrés les plus ardents. Et comme, après tout cela, Christian Marmonnier demande à Pichard s'il se considère comme subversif dans ses bandes dessinées, l'auteur répond poliment : « Je suis comme tout le monde : j'ai horreur qu'on vienne s'occuper de mes affaires, m'empêcher de penser et de m'exprimer. » Ceci pourrait être une paraphrase de ce qu'écrit Julien Green dans son Journal, à propos de la politique (4 avril 1932) : « Je hais la politique. Elle est cause que ce que j'aime est en danger, elle menace la liberté individuelle, elle menace le bonheur, elle me dérange dans mon travail. »
Belle étude thématique, par un spécialiste de Max Jacob et des relations entre les peintres et les écrivains. David. B., le plus littéraire de tous les auteurs issus de L'Association, ne pouvait qu'intéresser notre auteur, qui trace le périmètre des formes littéraires (l'autobiographie, le récit historique, le récit de rêve), repère des thématiques (la quête, la métamorphose), des motifs (l'ombre arrachée), des topoi (le jardin, le souterrain, la ville), des procédés rhétoriques (le coq-à-l'âne) et des références littéraires (Le Capitaine écarlate est une réécriture du Roi au masque d'or de Schwob).
Nous ne ferons qu'une restriction. S'il est question tout le temps de textes et de dessin, les questions de forme ne sont abordées que par exception (réflexion stripologique p. 129, réflexion sur l'esthétique du dessin de David B. p. 131).
Dans une collection Pour débutants, imitant la célèbre collection Pour les nuls (qui, c'est la dure loi du petit commerce, intentera fatalement un procès pour contrefaçon, et qui le gagnera peut-être, parce que « pour les débutants » s'abrège sur la couverture en « pour les déb » [débiles], ce qui introduit un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne), paraît un ouvrage qui serait mieux titré Histoire de la bande dessinée par un débutant. On y apprend entre autres que Robert Crumb faisait un fanzine tiré à quelques centaines d'exemplaires qui s'appelait Zaps, que le début des années 1950, où paraît Fils de Chine dans Vaillant, est l'époque où les maoïstes tenaient en France le haut du pavé, que Tezuka Osamu, qui s'appelle aussi Osamu Tezuka (cela change d'une ligne à l'autre), a été renié par les dessinateurs de gekiga à cause de son dessin jugé trop enfantin. On pourrait citer les perles ou les coquilles à l'infini. Mais à vrai dire, l'ouvrage échappe à toute analyse, parce qu'il est tellement mal écrit, tellement mal bâti, tellement mal relu, qu'on n'y démêle plus rien. L'infortuné lecteur se retrouve devant une collection de propos décousus, aberrants, ineptes et contradictoires. Et malheur au non-spécialiste qui recopierait dans ce calamiteux ouvrage un nom, une date, un fait, car il risque fort de recopier une ânerie.
Patiente étude de 300 pages format 24 X 31, sur l’organisation des cases dans l’espace de la planche. Le point de départ théorique de Renaud Chavanne, déjà exposé dans son ouvrage Edgar P. Jacobs et le secret de l'explosion (PLG, 2005), est la centralité du strip dans la dispositif de la bande dessinée, la planche étant postulée comme une démultiplication du strip. Dans ce nouvel ouvrage, où l'ensemble du champ de la bande dessinée est mis à contribution, l’auteur, très pédagogue, part de la « composition régulière », ce que Franquin appelait le gaufrier, passe à la « composition semi régulière », où le dessinateur conserve la composition en strips de hauteur égale, mais varie le nombre de cases à l’intérieur du strip, puis il théorise la « composition rhétorique », notion inspirée de Benoît Peeters, et arrive enfin à la « composition fragmentée », qu’il subdivise à l’envi.
Dans le chapitre « Compositions à l’œuvre » Renaud Chavanne examine ce que donne le mélange de tout cela. Dans la dernière partie de l’ouvrage, « Au-delà de la bande », il identifie des planches qui s’affranchissent de la prégnance du strip, tirées des œuvres de Michel Crespin, Chris Ware, Gianni De Luca et Alex Baladi.
L’auteur se montre clair et raisonnable dans son propos, et adopte une démarche résolument empirique, chaque stratégie compositionnelle étant illustrée par de nombreux exemples, reproduits et dûment commentés. Renaud Chavanne fait des remarques intéressantes sur l’usage de la gouttière et a le bon goût dans sa conclusion de dresser la liste de « ce qu’il n’a pas fait dans son ouvrage », pour éviter à son lecteur de possibles contresens.
Dans ses commentaires de planches, il arrive à Renaud Chavanne de quitter son sujet stricto sensu pour faire une analyse du contenu des cases, dans leur rapport dialectique avec la composition de la planche, donnant une tension bien venue à un ouvrage qui sinon pourrait devenir par trop aride.
LIVRES REÇUS
DADA : LA BANDE DESSINÉE UN 9e ART
Éditions Arola/Cité internationale de la bande dessinée, s. d., 2011
Cette revue d’art destinée aux enfants propose comme elle l’avait déjà fait par le passé (n° 35, 1997), une honnête introduction à la bande dessinée, à partir de documents bien choisis, d’auteurs classiques. On pardonnera volontiers aux contributeurs de donner une version quelque peu schématique de l’histoire du médium, marquée par un évolutionnisme confiant. Ainsi, il est entendu une fois pour toute que la bande dessinée est inventée par Töpffer, et qu’elle est renouvelée dans les années 1990 par l’Association.
Le risque d’une telle entreprise est celui de la condescendance vis-à-vis d’un public qu’on suppose arriéré. Si les contributeurs de Dada y échappent pour la plupart, regrettons cependant une analyse particulièrement mal venue d’une planche du Maus de Spiegelman, celle où le cartoonist se demande comment animaliser son épouse, Françoise Mouly, qui est Française. Le dessinateur a tracé sur un carnet de croquis un élan (peut-être à cause d’associations avec le Canada francophone), un caniche (French poodle), une grenouille (froggy), d’autres animaux encore. Cela est interprété ainsi : « Spiegelman révèle ici l’absurdité de la notion de race. Nous possédons tous de multiples identités… » Le journaliste prend ici son auteur en otage pour caler un préchi, précha bien-pensant, en faisant dire à l’œuvre le contraire exactement de ce qu’elle dit, puisqu’il n’aura échappé à personne (et pas même aux enfants) que Maus repose précisément sur une spécification des protagonistes (les nazis sont des chats, les juifs, des souris).
Version librairie de la thèse en Sorbonne soutenue par Jean-Christophe Menu en janvier 2011. Il s’agit d’un essai fourni et assez fin, marqué par une démarche réflexive de type égo-archéologique, dans laquelle l’auteur examine la place que tient la bande dessinée dans son enfance, et son rapport au médium comme auteur et comme éditeur. La finalité de cette double activité est la recherche de nouveaux territoires à explorer, représentant précisément le « double » évoqué dans le titre, qui est naturellement un emprunt au Théâtre et son double d’Antonin Artaud.
Deux de ces au-delà de la bande dessinée, dans lesquels M. Menu s’est engagé comme auteur et comme éditeur, sont l’autobiographie et la contrainte oulipienne. L’auteur considère d’autres ouvertures possibles, en particulier par l’investissement d’autres supports que le papier, et par le prolongement vers une sérialité infranarrative (l’auteur adopte en effet une conception ultra-extensive du médium et des variations sérielles relèvent toujours pour lui de la bande dessinée).
La thèse de Jean-Christophe Menu relevant de l’histoire de l’art, l’auteur se positionne par rapport aux écoles et aux courants. A cet égard, il faut, pour comprendre la pensée de M. Menu, garder à l’esprit que son point de départ est essentiellement polémique. L’auteur prend comme repoussoir la mauvaise bande dessinée commerciale, et le microcosme bédéphile, ce qui l’amène à privilégier un avant-gardisme généralisé, qui pousse des racines dans le naturalisme, le symbolisme, le surréalisme et le situationnisme, mais aussi, en une apparente contradiction, à vanter un classicisme, qui regroupe selon lui les grands auteurs du passé.
On regrettera un certain flou dans l’appareil théorique et conceptuel, y compris celui de la stripologie, l’auteur ayant tendance à faire feu de tout bois à l’appui de sa thèse. Il est vrai que Jean-Christophe Menu n’est jamais plus intéressant que quand il parle de son propre travail.