|



|



MISCELLANÉES LITTÉRAIRES ET POPULAIRES
Splendeurs des Pulp Magazines
• DEUX NUMÉROS DE WEIRD TALES
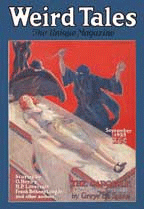
Lu en entier plusieurs numéros du pulp magazine de fantasy gothique Weird Tales. Je vais décortiquer ici, à titre d’exemple, les numéros de septembre et d’octobre 1925. La revue en est alors à sa troisième année de parution.
Les textes de ces numéros sont inégaux, même s’ils restent lisibles pour la plupart. Le meilleur écrivain de la revue est sans conteste Lovecraft, présent dans le numéro de septembre avec « The Temple », une histoire d’U-Boot qui échoue dans les ruines de l’Atlantide.
Le feuilleton dans ces deux numéros est « The Gargoyle » de Greye La Spina (dont je n’ai pas la fin). Il s’agit d’une histoire de satanisme, pas particulièrement convaincante sur le plan du style, située dans un château gothique édifié dans un bois de Pennsylvanie. Le châtelain est un être défiguré, qui n’apparaît jamais en pleine lumière. Adonné au satanisme, il médite quelque horrible sacrifice humain sur la personne d’une jeune femme qu’il élève à cette fin. (Je suppose sans en avoir le cœur net que l’adepte de Lucifer cherche à se reloger dans un corps qui ne soit pas difforme, le motif de la transmigration étant très fréquent dans la revue).
Le château médiéval au milieu d’un paysage complètement banal des États-Unis et l’être si monstrueux qu’il cache son visage à tous (y compris à sa mère, qui devrait en toute logique avoir eu le temps de s’y habituer), voilà des caractéristiques qu’on retrouvera chez le Doctor Doom, dans les Fantastic Four de Stan Lee et Jack Kirby (apparition dans le n° 5, juillet 1962), sans qu’on puisse évidemment démontrer une filiation directe, mais plutôt une proximité d’ambiance. (Doom est présenté initialement comme un luciférien, un sorcier, même s’il est aussi un savant fou.)
Fait sa première apparition dans le numéro d’octobre, dans la nouvelle « The Horror on the Links », l’enquêteur de l’occulte de Seabury Quinn, le Pr Jules de Grandin, de l’université de Paris et de l’hôpital Saint Lazaire (sic), mais qui travaille beaucoup pour la Sûreté, et dont le Dr Watson s’appelle le Dr Trowbridge. De Grandin a l’habitude de couper son babil en anglais fracturé par du très mauvais français (« Now, friend Trowbridge, I tell you some time ago this Beneckendorff were reported in le Congo belgique. Yes ? »), ce qui confère un charme supplémentaire aux nouvelles pour le lecteur francophone, qui se demande de quel univers parallèle émerge un bonhomme qui jure continuellement par la barbe d'un bouc noir ou par un petit cochon rose.
Les courtes nouvelles de E. Hoffmann Price sur le monde islamique (« The Sultan’s Jest » et « The Prophet’s Grandchildren ») sont très enlevées et relèvent de cette école du conte oriental qui part des Mille et Une Nuits, passe par Beckford, et finit chez Conan Doyle et Lovecraft.
La section des classiques (Weird Story Reprints) permet d’étoffer le sommaire à bon marché en offrant d’excellents textes, respectivement « the Furnished Room » d’O. Henry et l’extraordinaire « The Severed Hand » de Wilhelm Hauff.
Cependant, si la nouvelle à chute à la Hoffmann Price ou à la O. Henry trouve sa place naturelle dans Weird Tales, l’humour burlesque ne semble pas très adapté à la revue. Une histoire de puce géante, résultat d’une expérience scientifique idiote, qui poursuit les chiens dans une banlieue pavillonnaire, « The Wicked Flea » de John Ulrich Giesy (l’auteur des aventures de Jason Croft sur la planète Palos), a droit à la couverture du numéro d’octobre. Mais elle s’attire dans le courrier des numéros suivants les reproches des lecteurs, qui n’apprécient pas ce genre de texte humoristique, et trouvent qu’il ne se range tout simplement pas sous l’intitulé du conte bizarre (weird tale).
Par contre, les mêmes lecteurs réclament à cor et à cri des histoires de planètes, d’animaux géants, d’inventions pseudo-scientifiques, bref, de la science-fiction (qui ne sera inventée que l’année suivante, sous l’intitulé de scientifiction, par Hugo Gernsback, dans Amazing Stories, mais qui fait depuis longtemps les beaux jours des Munsey Magazines, dans des récits inspirés par Wells et par E. R. Burroughs).
Je suis frappé par l’importance, au milieu de l’horreur gothique, qui prédomine dans la revue, de textes ressortissant à un occultisme vague et spiritualisant, tel que le second texte publié de Nictzin Dyalhis, « The Eternal Conflict » (numéro d’octobre), où l’adepte d’une secte mystique fait un voyage astral et participe à un combat allégorique entre les forces de la Lumière et celle des Ténèbres. Sous leur apparence ésotérique, de telles histoires sont toutes imbues d’un christianisme lacrymal.
Enfin, si le sommaire des deux numéros s’étale sur deux pages et propose respectivement dix-sept et quatorze textes de fiction (plus un poème et la rubrique de correspondance), cette apparente richesse est due à la présence de nouvelles courtes, voire très courtes, de « fillers », souvent signés de collaborateurs très occasionnels, et d’une qualité discutable (idées rebattues, étiques, mal développées). On y trouve par ailleurs des textes qui seraient mieux à leur place dans un pulp d’aventures — ce qui témoigne de la difficulté qu’a Farnsworth Wright à boucler son sommaire — tels « Jean Bauce » de W. J. Stamper (numéro de septembre), histoire de révolutions en Haiti, qui contient un peu de sadisme gothique, mais qui est essentiellement un récit d’aventures.
Bref, l’examen de la revue confirme ce que m’avait déjà appris la lecture de deux anthologies de textes d’auteurs de pulps et d’editors, destinés à des apprentis écrivains, dans le Writer’s Digest et Author and Journalist des années 1920 à 1940 (Pulp Fictioneers, Adventure House, 2004 et Pulpwood Days, Off-Trail publications, 2007). Il était plus simple pour un rédacteur en chef, plutôt que de chercher de bons textes dans les manuscrits reçus par la poste, travail qui ressemble à la recherche de la proverbiale aiguille dans la proverbiale botte de foin, de s’attacher une écurie d’auteur, en les encourageant à écrire dans un certain genre, quitte à les brutaliser à l’occasion pour qu’ils révisent un peu leurs textes (Carl Jacobi, habitué de la revue Weird Tales, raconte qu’il avait découvert que s’il laissait reposer un texte plusieurs semaines ou plusieurs mois, il pouvait le renvoyer à Farnsworth Wright en lui disant avoir fait toutes les modifications demandées, et que le texte était alors accepté. (R. Dixon Smith, Lost in the Rentharpian Hills, Spanning the Decades With Carl Jacobi, 1985, Bowling Green State university Popular Press, p. 20.)
Mais d’un autre côté, comme il fallait bien compléter des sommaires pléthoriques (Weird Tales paraissait chaque mois sur 144 pages en double colonnes), force était de traiter la pile de manuscrits d’inconnus, avec l’espoir d’y trouver la perle rare.
Pareil système était voué à sa propre défaite. Les auteurs, établis ou débutants, soumettaient de préférence leurs textes aux pulps qui payaient le plus (qui étaient naturellement les pulps d’aventures). Puis, en cas de refus, leur prose amorçait une lente descente aux enfers en étant envoyée aux revues plus pingres (or Weird Tales ne paya jamais bien, faute de ventes suffisantes). D’autre part, au moment du bouclage, l’urgence de trouver un « filler » conduisait au choix de textes tout à fait inférieurs qui, tirés de la pile à tout autre moment, ne fussent jamais parus.
Ainsi, si l’impression générale qui se dégage de l’examen de l’école Weird Tales in vivo est celle d’un travail d’un honnête niveau, caractérisé par une écriture « moyenne », celle d’un bon romancier populaire, quoique inévitablement marqué par une impression de répétitivité, les contraintes de la périodicité et la logique même de la production des pulps (la sélection par l’échec) font que cette qualité ne peut être maintenue à travers la revue entière. Ceux des lecteurs qui déclarent dans le courrier lire chaque numéro de bout en bout, avec un plaisir constant, font acte de foi.Harry Morgan