|

l'étrange
|

 Etrange
ne signifie rien d'autre qu'étranger. C'est ce qui
échappe aux moeurs communes et paraît
exorbitant.
Etrange
ne signifie rien d'autre qu'étranger. C'est ce qui
échappe aux moeurs communes et paraît
exorbitant.
Mais la notion suppose un attrait louche, produit d'une défiance et d'une attirance simultanées. Ou, si l'on préfère, d'un sentiment diffus de reconnaissance venant brocher sur l'inconnu.
Car l'étrange réconcilie les contraires. Freud - dans son article bien connu sur l'Inquiétante Etrangeté (1919), article lui-même très étrange parce qu'il consiste partiellement en une très longue citation de dictionaire - relève que les contraires heimlich et unheimlich finissent par signifier la même chose.
Mondialisation aidant, l'étrangeté tend à disparaître. Un Persan paraissait étrange aux lecteurs de Montesquieu ("Comment peut-on être persan ?") Un Iranien n'a rien d'étrange à nos yeux. Mais l'étrangeté revient dans ces photographies d'Iraniennes en tchador - noires colonnes brandissant un pistolet au bout d'un bras nu - prises pendant le cours d'instruction militaire de la section féminine islamique et populaire ; elles ressemblent à la sorcière des mers dans Popeye.
L'étrangeté d'un pays n'est pas intrinsèque. C'est le caractère irréconciliable du voyageur et du pays qui fait l'étrangeté de la description. Sans cette différence de vues, il n'y a plus d'étrangeté. Le roman scientifique en a fait la démonstration : La description de Mars par un Martien n'a rien d'étrange. Mais le Paris de la Régence vu par l'ambassadeur ottoman Mehmed Efendi est le comble de l'étrange, parce que le narrateur pense en mahométan. Mehmed Efendi note par exemple que le mélange d'hommes et de femmes dans les rues fait paraître Paris plus peuplé qu'il n'est. Cette reflexion d'un musulman, habitué à ce que les femmes soient cloîtrées, qui voit le nombre des badauds soudain doublé, et perd ses repères, nous fait considérer le spectacle d'hommes et de femmes mêlés dans les rues, d'un oeil neuf et même d'un oeil étonné.
Il y a par conséquent une symétrie de l'étrange. Elle naît indifféremment d'une vision banale qu'on a éloignée de nous ou d'une vision étrangère que confusément on reconnaît.
L'engouement de nos contemporains pour les relations de voyages s'explique par la distance qu'il y a entre les descriptions des anciens voyageurs et les poncifs actuels : le Tahitien de Bougainville ne ressemble pas à celui du Club Méditerranée, quoiqu'il reste parfaitement identifiable. Il est à la fois familier et louche, ce qui le rend étrange.
Il arrive naturellement que le voyageur, aveuglé par sa propre intelligence, ne voie rien, ou un imperceptible point de lumière, ce que le dictionnaire de Littré nomme un point de vue. Croyant écrire sur le Japon, Loti, Claudel ou Barthes n'ont produit que les tristes folichoneries de cervelles égarées. La protestation indignée ou peinée d'un Japonais contre cette littérature serait superfétatoire, car il ne s'agit point, dans ces espèces, de la description du Yamato par un lettré étranger, mais du choc d'un crâne épais contre un monde impénétrable. Michaux, dans pareille circonstance, a conscience de sa propre étrangeté ; d'où le titre Un Barbare en Asie, qu'on peut juger préférable à celui, un tantinet ambitieux, de Claudel : Connaissance de l'Est.
Dans les cas de Loti, Claudel et Barthes, l'inadéquation du voyageur le soustrait au monde où il est pourtant présent physiquement. Les réactions des Japonais face au marin au long cours, au poète diplomate et au professeur d'université sont de même nature que celles des Papous qui ne jugeaient pas utile de se lever à l'arrivée de Cook ou de La Pérouse, non par indolence ou parce qu'ils ne les voyaient pas, mais parce que l'irruption de ces individus blanchâtres et vêtus d'étoffes ne pouvait être que celle des morts - phénomène qu'ils s'accordaient cependant à trouver étrange.
Le potentiel d'étrangeté d'un pays est fonction de ses dimensions physique, humaine et temporelle. Ainsi, une petite île à la maigre population sans histoire ne peut fournir qu'une goutte infime d'étrangeté, par exemple dans le cadre d'un conte fantastique. A l'inverse, l'Empire de Chine, à cause de l'immensité de son territoire, des milliards d'habitants qui s'y sont succédés, et des millénaires de son histoire, crépite au moindre frôlement d'une formidable étrangeté. La plus médiocre chinoiserie décorant un salon parisien apporte la fascination inquiète d'un coup d'oeil jeté entre les nuages d'une planète géante, aux terres, aux océans et aux ciels grouillants d'une humanité nombreuse et polypode.
L'air de l'étrange
En musique, l'étrangeté provient d'un majeur qui sonne comme du mineur, d'un mineur qui sonne comme du majeur ou, comme chez Bach, d'une hésitation constante entre majeur et mineur. La signature musicale de Bach B, A, C, H est l'air de l'étrange.
On citera encore ces sons spiralés qui montent et descendent à la fois. (Jouez un do, à l'octave au dessous le do dièze, au dessous un ré, au dessous un ré dièze, etc.)
Pour beaucoup de gens, les gammes inhabituelles sont étranges, le mode dorien, Debussy, Ravel ou Dukas - mais il faut reconnaître que l'étrangeté musicale est rarement séparée d'un contexte féérique, la musique de Ravel pour Les Entretiens de la Belle et de la Bête, le Dukas d'Ariane et Barbe-bleue.
Les gammes autres qu'occidentales ont beaucoup perdu de leur étrangeté. On finit même par éprouver devant les mélodies des riverains de la Volga, ou du rio Pongos un sentiment las de fausse reconnaissance, qui n'est pas le sentiment de "déjà-vu" (le sentiment de "déjà-vu" les rendrait étranges).
La musique savante, après Schoenberg et Webern, n'inspire plus, à défaut d'étrange, qu'un profond ennui. Et cependant, pour le grand public, quelques mesures d'une mélodie traînante, sifflante, zézayante et atonale, sont la signature de l'étrange. Le cinéma fantastique à la Hammer en abuse.
La même remarque vaut pour les instruments électro-acoustiques. Ici encore, tout dépend du contexte. Servant à illustrer un film, les sons du Theremin ou de l'onde Martenot sont le comble de l'étrange, comme en témoignent les musiques de Forbidden Planet et The Day the Earth Stood Still. A l'époque de leur sortie, ces mélopées paraissaient modernistes ; elles nous semblent à présent provenues du fond des âges, comme les battements des pulsars ou le chant des baleines ; leur étrangeté demeure. Pourtant, présentées dans leur grande longueur, ces pièces perdent toute étrangeté. Les recherches acoustiques de l'IRCAM nous consternent ; "tired electronic sounds and naive light show", écrivait David Schiff (dans l'Atlantic Monthly de septembre 1995) à propos de Répons de Boulez (1981). "A recent Deutsche Grammophon recording of Répons makes one sympathize with the complaints that have been directed at IRCAM over the past two decades ; the institute has sucked up the lion's share of public money for contemporary french music, but its costly synthesizer, the 4X, sounds unremarkable and a little antiquated in the digital age", renchérit Alex Ross dans le New Yorker du 10 avril 2000.
A mettre en parallèle avec la pétulance musicale des Shadocks de Jacques Rouxel, quelques mesures de musique électronique s'harmonisant avec un dessin provenu de Saul Steinberg et un texte servi par Claude Piéplu, parodie géniale de la grande voix d'André Malraux - l'ensemble procurant, sur un registre loufoque, la même étrangeté que les dessins animés de Norman McLaren.
Zola et le bizarre
En littérature, l'étrange est représenté dans les productions du nonsense, de l'automatisme, et dans ce genre qu'il faudrait nommer le roman subliminal (illustré par la Gradiva de Jensen), plus que dans le merveilleux, le fantastique (exception faite d'un fantastique laiteux, calme, songeur, ayant peu recours aux accessoires) ou le roman scientifique, où on l'attendrait. Ces domaines, par contre, donnent fréquemment dans le bizarre.
Ce mot basque désigne un écart du goût ou des usages reçus, mais sans l'impression de familiarité ou de fausse reconnaissance qui est la marque de l'étrange. Un salon arabe, celui de Pierre Loti ou celui de lord Leighton, est bizarre. La Sainte-Chapelle est étrange.
Il y a des éléments de bizarre même chez des auteurs, ou dans des oeuvres, qui n'ont en elles-mêmes rien de bizarre et où il serait tout à fait vain de chercher de l'étrange.
Zola en est un bon exemple de bizarre. Dans La Curée, le personnage de Maxime est soigneusement présenté comme un homosexuel. Après quoi, l'auteur nous conte ses amours incestueuses avec sa belle-mère, ce libertinage étant, selon Zola, l'effet normal de sa prédisposition. Dans Le Ventre de Paris, les descriptions de la belle charcutière sont bissées, comme si l'auteur s'enchantait d'avoir si bien réussi cet effet. Dans Nana, c'est toute la fin qui est reprise, péripétie par péripétie, de La Curée, comme si l'auteur avait oublié son sujet théâtral et demi-mondain et récrivait par distraction ce dernier roman. Dans La Faute de l'abbé Mouret, les personnages de Désirée et d'Albine font doublon, toutes deux étant des sauvageonnes et l'incarnation de la nature féconde. Ce dernier roman comporte aussi, sans l'ombre d'une justification et au milieu d'un naturalisme à gros sabots où il ne manque pas un enfant naturel fait sur le fumier, cent quarante pages de la plus pure veine "jardin enchanté".
Quant au fameux thème de l'hérédité, si imprudemment annoncé par Zola au début de La Fortune des Rougons, on peut difficilement affirmer, comme le fit Jacques Bergier dans une préface demeurée fameuse, qu'il consiste en "stupidités sans pareilles" car il est, à la vérité, tellement obscur et embrouillé qu'on n'y démêle à peu près rien. Le lecteur est plutôt dans l'impression confuse que les personnages, changeant de fonction d'un roman à l'autre, mènent plusieurs vies et présentent plusieurs caractères - ce qui les met heureusement à l'abri du déterminisme de l'hérédité. Le lâche et ridicule Aristide, de La Fortune des Rougons, le bras en bandoulière pour n'avoir pas à prendre parti dans les troubles insurrectionnels du coup d'Etat de Louis Bonaparte, n'a presque aucun trait en commun avec le banquier de La Curée, grand brasseur d'affaires, lui-même assez éloigné du boursicoteur de L'Argent - et le changement va jusqu'à un changement d'état-civil (Aristide Rougon prend le nom de Saccard ; sa femme et son mioche meurent opportunément au début du second roman). En passant de Pot-Bouille au Bonheur des dames, Octave devient lui aussi méconnaissable.
Tout cela est bizarre, en dépit du "réalisme" ou du "naturalisme" affiché par l'auteur. Mais, encore une fois, on cherchera en vain dans Zola une trace d'étrange.
La maison du miroir
Dans le genre grotesque ou arabesque, une apparente étrangeté peut être due à une compréhension imparfaite par le lecteur (et parfois par le traducteur) des objectifs d'un auteur et des conditions de sa production. L'étrangeté de Poe tient pour beaucoup à son goût du pastiche, et plus encore à son intempérance. Il est très étrange par ailleurs que les français ne puissent le lire de façon satisfaisante dans leur langue, les éditions courantes reprenant les traductions de Baudelaire, qui sont farcies de contresens.
Poe qui, pour beaucoup de lecteurs, est un genre en lui-même, a beaucoup peiné pour trouver sa veine. il emprunta énormément à droite et à gauche. Le système du docteur Goudron et du professeur Plume provient d'un conte de Bulwer Lytton, intitulé Manuscrit trouvé dans une maison de fou. Un événement à Jérusalem est un plagiat, très contracté, d'un roman de Horace Smith : Zillah, conte de Jérusalem. Poe opta finalement, au milieu de beaucoup de contradictions, pour le récit horrifique. Ses contes prennent un tout autre aspect pour qui a feuilleté le Blackwood's Magazine, qu'il s'efforça d'imiter, de sorte que lorsqu'il raille cette publication (dans : "Comment on écrit un article à la Blackwood's"), il a l'air de faire son autocritique.
Un récit aussi étrange et décousu en apparence que L'Ange du bizarre devient parfaitement lumineux si l'on garde à l'esprit que Poe était alcoolique. Baudelaire a encore moins compris ce conte que les autres et le lecteur français aura du mal à saisir au travers des fautes de traduction que l'ange du bizarre (une collection de flacons et de chopines douée de la parole) essaie tout du long de faire avouer au narrateur qu'il est saoul perdu. Le malheureux, ayant perdu successivement l'heure, sa maison, ses cheveux et sa perruque, décide brusquement d'en finir et ôte tous ses habits dans l'intention de se noyer - comportement tout à fait typique d'un alcoolique - pour se retrouver tout nu accroché sous un ballon. La fin du conte laisse supposer que tout le reste n'était qu'un rêve d'ivrogne.
Ni épouvante ni surnaturel ne sont étranges. Frankenstein et Dracula, romans délicieux, sont tout sauf étranges. Les Mystères d'Udolphe ne le sont que par l'excès de leur recours aux airs de flûte et aux terreurs tapies dans le corridor de droite de la tour nord.
L'ouvrage de Montague Summers consacré au vampire est, de bout en bout, stimulant et attachant, avec son mélange d'antiquité, d'ethnologie à la Frazer, de fleur des saints et de droit canonique, et son érudition littéraire disparate, desservie par des fautes de composition - car le pauvre abbé n'avait pas, semble-t-il, les moyens de payer un typographe décent. L'ouvrage démontre surabondament l'existence des vampires. Cependant, loin de provoquer chez le lecteur le grelottement d'inquiétude de l'étrange, The Vampire, his kith and kin (le vampire, ses parents et amis), est l'ouvrage roboratif d'un esprit rassis.
On se demande si l'étrange peut subsister dans un savoir ou une doctrine systématisée - fût-elle aberrante et sans fondement. Chez Gustave Meyrink, l'étrangeté est inversement proportionnelle à la quantité d'ésotérisme ou d'occultisme qu'il fait ingurgiter au lecteur. A l'inverse, les deux Alice de Lewis Carroll, livres d'enfant assez sages dans leur intention - en dépit de la réputation alarmante qu'a faite à leur auteur une clique de snobs - sont étranges de bout en bout, par le simple recours - concerté et sans honte - à l'automatisme. L'étrangeté de Through The Looking Glass provient moins d'ailleurs de la ménagerie féerique qui y est décrite, fleurs, insectes, Tweedledum et Tweedledee, the old sheep, Humpty Dumpty, etc., que de la maison elle-même, looking glass house, parce qu'elle est vue par les yeux d'une enfant de six ans, et qu'elle est par conséquent, au lecteur, immédiatement familière, et mystérieuse à proportion. Le motif du miroir fait naître chez le lecteur un désir frustré de rester du bon côté, de sortir au grand jour, dans le monde non du miroir mais de la maison du miroir - c'est à dire d'émerger dans une enfance victorienne.
Semblablement, dans chaque grêle dessin et chaque vers de nonsense d'Edward Lear règne une étrangeté pure et parfaite, parce qu'elle est donnée comme naturelle et se passe entièrement de justification.
Le roman d'aventures ésotériques de Rider Haggard intitulé She (1887) est étrange. Mais la suite des aventures d'aysha et celles d'Allan Quatermain fatigue l'étrangeté au point que lorsque les deux personnages se rencontrent enfin (en 1921, dans She and Allan), le lecteur a le sentiment de revisiter des lieux familiers.
Talbot Mundy, populaire imitateur de Rider Haggard, est, au premier abord, d'une banalité presque anormale. Il ne manque, dans ses récits, pas un sergent rougeaud, pas un major culotte de peau, pas une beauté vénéneuse, pas un yogi farouche et décharné. Et les répliques elles-mêmes - qui paraissent découpées dans une hypothétique et monumentale Nomenclature des répliques et donnent volontiers dans le genre : "Pardieu, vous jouez un jeu dangereux ! Je vous donne carte blanche !" - signalent, par leur banalité même, quelque terrible défaut de l'âme, comme la conversation des schizophrènes.
Lorsque le lecteur et son auteur s'ennuient trop, les personnages de Talbot Mundy se mettent soudain à faire quelque chose d'extraordinaire sous son apparente banalité. Un tour de passe-passe diabolique avec le briquet, destiné à détruire le naïf agent secret, est aperçu et déjoué. There's more here than meets the eye, nous assurent à l'unison les personnages et l'auteur.
Ainsi, l'incompréhensible succès de Talbot Mundy découle de ce que l'étrange s'en est retiré - permettant au lecteur rassuré de s'aventurer à marée basse dans le territoire de l'ésotérisme - et, simultanément, d'un reflux d'étrange, au milieu des poncifs, qui vient lui éclabousser les pieds.
Espionnage et policier
Pour ce qui touche l'"espionnage", genre accablant où il n'y a pas place, apparemment, pour l'étrange, John Buchan a donné dans certains de ses récits (on n'ose appeler "roman" ces courts trajets à risque) un abrégé et presque une abstraction d'étrange. L'univers entier et le hasard lui-même, ligués contre le héros, font qu'il n'y a plus de rencontres fortuites, et que le sort du monde est suspendu au battement d'aile d'un papillon.
G. K. Chesterton obtient le même effet, de façon quasi-expérimentale, pour le récit policier (Les histoires du père Brown) et le roman de société secrète (The Club of queer trades, The Man who was Thursday, etc.)
Dans le roman policier classique, l'étrange est réservé : 1) à la tête du criminel (le chef d'oeuvre du genre étant le strip Dick Tracy, de Chester Gould, avec sa galerie de monstres humains, cruels, mous et hiératiques - et terriblement attachants), 2) aux moyens mis en oeuvre pour venir à bout de la victime (beaucoup de detective novels démarrent par des "morts étranges"), et 3) à l'accessoire ou à l'indice qui donne son titre au roman. Les lecteurs se sont habitués à trouver leurs enquêtes policières à l'enseigne de la Clé de verre, du Faucon de Malte et du Canari boiteux. Ellery Queen s'est moqué gentiment de cette habitude dans la Croix égyptienne (où ce mystérieux accessoire ne sert qu'à donner au roman un titre intriguant à souhait.)
Le Mars d'un martien
Le roman scientifique est, on l'a déjà signalé, le contraire de l'étrange. Tous les mondes sont banals du point de vue de leurs habitants, le Mars d'un Martien, le Centaure d'un Centaurien.
Du reste, les univers des space operas vus à la télévision ou au cinéma, Star Trek ou Star Wars, en dépit de l'éloignement dans l'espace et dans le temps, ne sont que des décalques de notre propre civilisation. Même le merveilleux y est commun - ce qui autorise ce poncif de l'analyse : la science-fiction est un conte de fée mis aux couleurs de la science.
Et si le narrateur nous dépeint un univers radicalement étranger ? John Wyndham - qui s'ingénia, sa vie durant, à écrire de la science-fiction comme s'il n'aimait pas ce genre - fait remarquer, dans la nouvelle Pillar to Post, qu'il est vain de décrire un environnement futuriste. "Franchement, dit son narrateur, je comprenais à peu près un pour cent de ce que je voyais." Et il parle d'un habitant des îles Trobriand (souvenir évident de Malinowski) qui tenterait de décrire Manhattan.
Pourtant, le point de vue du Papou fournit seul le déplacement qui permet à l'étrange de naître. Les meilleurs auteurs de romans scientifiques, H. G. Wells, Olaf Stapledon, C. S. Lewis, et quelques romanciers populaires avisés, ont introduit dans leur prose un Papou (ou, à défaut, un anglais du modèle courant) et ont ainsi échappé à la banalité.
Parfois, le style de l'auteur suffit à fournir un point de repère familier - et à nous le faire perdre aussitôt - ce qui fait naître l'étrange. C'est la grande trouvaille de Wells. Les illustrateurs de science-fiction ont adopté le procédé. C'est précisément parce qu'elles sont dans le style des couvertures de Mécanique populaire que les illustrations des pulps de science-fiction sont si étranges.
J.-H. Rosny aîné est un cas particulier. On se demande peut-être pourquoi cet écrivain pour distribution de prix et bibliothèque scolaire devrait être classé dans l'étrange ? C'est affaire de style. C'est précisément l'étrangeté du style de Rosny qui explique sa défaveur et qu'il ne soit plus lu que par les enfants et quelques amateurs de littérature conjecturale. Rosny écrit noblement et correctement. Mais, sans qu'il le sache et sans qu'il l'ait désiré, Rosny a agglutiné sous sa plume tout ce qui sera considéré comme vieillot, désuet ou pâlichon : style art-nouveau alangui et marqueté, rendu plus pénible par un goût du mot rare qui, lorsque l'action se passe dans un bocage normand plutôt que dans la selve équatoriale, pousse l'auteur vers une érudition de jardin potager. Même quand il écrit raisonnablement de l'anticipation, Rosny ne peut s'empêcher de tout gâcher par une élégance ; quand ses personnages communiquent par T.S.F., il écrit qu'ils se parlent sur une onde.
Le surréalisme a annexé l'étrange, au milieu de beaucoup d'autres choses. Mais l'image surréaliste, qui paraît fabriquée tout à dessein (deux éléments inconciliables sont donnés comme aussi vrai l'un que l'autre, sans qu'aucun puisse apparaître comme une figure de style - voir le photomontage d'un pré aux vaches devant l'Opéra Garnier, p. 46 du n° 12 de la revue La Révolution surréaliste), à la suite d'une erreur quelconque dans la formule, ne produit que rarement de l'étrange. La réclame (la pub, comme on l'appelle aujourd'hui), qui fait de l'image surréaliste un usage immodéré, parvient même à n'être jamais étrange.
C'est en peinture que le surréalisme a donné ses productions les plus étranges. Devant un très grand peintre comme Tanguy, force est d'ailleurs de reconnaître qu'il n'a rien de spécifiquement surréaliste, et ses toiles peuvent être considérées aussi bien comme des panoramas de la vie à la surface de planètes lointaines, peints par une sorte de douanier Rousseau égaré dans les mondes célestes.
Mervyn Peake
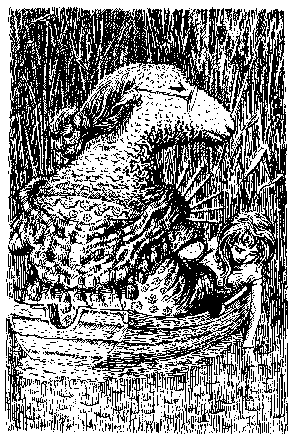
L'étrange est le plus aisément rendu par les titres (on l'a vu à propos du roman à énigme) et par l'illustration, parce que cette forme d'art graphique vise par essence à informer un texte familier (ou une connaissance familière). Les conventions artistiques changeant assez vite, n'importe quelle représentation un peu ancienne d'un lieu connu ou d'un être familier nous semble étrange. Ainsi, avant le dix neuvième siècle, les chats sont rarement mignons. Dans Buffon, ils ressemblent encore à des belettes.
Il y a dans le père Kircher l'image terrible et merveilleuse d'une divinité asiatique (voir en tête de ces feuillets). C'est une terrible indigestion d'Asie. On comprend par déduction que cet étrange tournesol doit être un Bouddha.
Chez Mervyn Peake, le dessin est ingrat et hanté par l'inquiétante étrangeté de Freud, dont Peake parle aussi, plus brutalement et plus à-propos qu'aucun critique : "Elle [l'illustration] doit avoir surtout le pouvoir de se glisser dans l'âme d'autrui", (cité par William Feaver, Les Images de notre enfance, 1976, Thames & Hudson).
Pour emprunter un poncif, Mervyn Peake n'était pas de ce monde. Sur sa photo d'identité militaire, il a l'air du martien typique s'efforçant de singer un humain et n'y parvenant pas tout à fait - quoique dans une guerre mondiale, il soit probablement passé inaperçu.
Le dessin du mouton dans son Through The Looking-glass est une pure image de cauchemar, n'utilisant aucune des ressources de la rhétorique de la terreur, mais flottant de façon caractéristique entre attirance et répulsion. L'écrasement de la perspective, les différences de proportion entre le mouton et Alice ont pour effet de figer l'image dans l'espace et le temps - et le fait que le mouton ait les traits d'un agneau pascal en biscuit ajoute à l'étrangeté.
Le propre du génie automatiste est l'extrême facilité apparente de sa production. On a fréquemment l'impression que l'auteur lui-même "ne sait comment il fait". D'où le recours, à propos des sujets automatistes (souvent classés dans l'art brut), aux sornettes banales de "l'inspiration" - artistique, religieuse ou, plus récemment, spirite.
Nombre d'images de Peake, qui souffrit de la maladie de Parkinson, semblent griffonnées sur un calepin pendant une conversation au téléphone. Automatisme purement martien, exprimant la présence spectrale du vrai Peake - de même que le nazi dans The Stranger d'Orson Welles, quand il parle au téléphone, a la compulsion de dessiner des croix gammées qu'il déguise ensuite en damiers. Toujours à cause de la maladie de Parkinson, beaucoup de dessins de Peake ont l'air d'avoir été exécutés les yeux fermés.
"He was no linguist," observait madame Peake à propos de son mari. Peake n'apprit qu'une langue humaine, l'anglais, et il l'utilisa de façon géniale mais aberrante pour faire de l'illustration avec des mots, dans la série des Titus (Titus Groan, Gormenghast, Titus Alone). Quoique assez en vogue dans les milieux artistiques, ces ouvrages sont presque illisibles, simple suite de croquis visionnaires, d'ailleurs le comble de l'étrange et du cauchemardesque. La femme de Peake précisait encore que "Words were shapes and sounds to him."
Peake était né en Chine, où ses parents étaient missionnaires. On imagine un pays confusément orientaliste, comme la ville de Perle dans Die Andere Seite de Kubin et comme les eaux-fortes "chinoises" dans Kircher.
La chance d'un Kipling avait été de "turn native" de devenir un petit habitant de Bombay, parce qu'il avait eu une nourrice sèche indienne, et avait baragouiné le bengali avant l'anglais. De la sorte, le jeune Rudyard connut une enfance normale. Peake, privé d'un tel avantage, dut absorber à l'âge tendre l'étrangeté d'un pays immense et à demi fabuleux.
James Thurber est une version pour la classe moyenne de Peake. Il dessinait, lui aussi, tout en étant à peu près aveugle et en ingurgitant de fortes quantités d'alcool. L'humour permet de faire passer des choses épouvantables sans épouvante. L'autobiographie de Thurber, qui est plutôt un recueil de souvenirs sur les siens, est un document d'une précision clinique sur ce qu'on appellerait aujourd'hui une famille de névrosés ; sa lucidité et son absence de parti pris dans la description de ces demi-fous la plonge aussitôt dans l'étrange.
Chez Edward Gorey, l'histoire de l'illustration populaire est recyclée sur le mode de la réminiscence, comme en témoigne son goût des alphabets illustrés. La forme du récit en images et sa technique de fines hachures font parfois naître l'illusion que ses personnages sont découpés dans des gravures victoriennes. Mais il cite aussi, au hasard des pseudonymes dont il décore ses petits livres, Cruikshank, Edward Lear ou Wilhelm Busch. Ses intrigues sont des cauchemars acidulés mettant en scène une collection de fantômes, de barbus redoutables, de mères habillées d'organdi, d'enfants médusés, de demoiselles exangues et de nondescripts impénétrables. La Gorey girl, à la frange en escalier, vêtant sa blondeur diaphane et anorexique d'une jupe plissée et d'un sweater (et, l'été, d'une jupe plissée et d'un col marin), est, par ses prédispositions au somnambulisme et son enfantine perversité, condamnée à la folie et à la mort violente. Mais ces événements sont présentés avec une sorte de jubilation, à contresens des faits divers tragiques, de la littérature médicale, des romans victoriens d'enfants martyrs, ou des "histoires en estampes" moralisatrices dont l'auteur s'inspire.
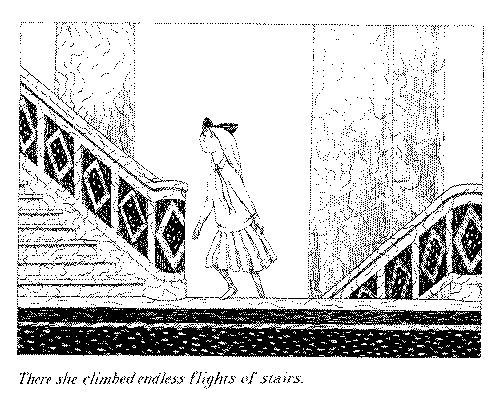
Etrange ethnologie
Dans le domaine des sciences, c'est l'ethnologie qui nous arrête puisqu'elle est, par définition, la science des peuples étranges. Ses précurseurs furent Hérodote et Jean de Mandeville.
A vrai dire, le principe de base de cette science est de ne s'étonner de rien et de ne pas porter de jugements de valeurs. "Ne porter aucun jugement moral. Ne pas s'étonner. Ne pas s'emporter," mentionne la sténographie du cours de Marcel Mauss (Instructions d'ethnographie descriptive). "La méthode scientifique moderne consiste à refuser tout jugement subjectif," écrit Robert Löwie dans son Histoire de l'ethnologie classique. Attitude qui nous prive des indignations dégoûtées des chers vieux auteurs à la Frazer.
Mais l'étrangeté est le refoulé de l'ethnologie et il faudrait récrire les titres de toutes les oeuvres, du vieux E. B. Tylor (Strange Primitive Culture) à C. Lévi-Strauss (Anthropologie structurale étrange) en passant par B. Malinowski (Strange Argonauts of the Western Pacific), Lévy-Bruhl (La Mentalité primitive étrange) ou Ruth Benedict (Strange Patterns of culture).
La seule chose qui soit plus étrange que les coutumes des peuplades lointaines est la théorie de l'anthropologue et de l'ethnologue. L'érudit Gladstone (qui occupait pour vivre les fonctions de premier ministre de la reine Victoria) croyait que les anciens Grecs voyaient en noir et blanc. Raison invoquée : le lexique d'Homère ne comprend pas de noms de couleurs ! Freud, dans un pastiche du Golden Bough de Frazer titré Totem und Tabu, s'autorisa de Darwin, d'Atkinson et de Robertson Smith pour avancer sans l'ombre d'une preuve que le premier état de la société des hommes était celui des herbivores : Un mâle (un père) gardait pour lui sa femme et ses filles et chassait ses fils à mesure qu'ils grandissaient. Les lascars se seraient ligués pour tuer le père abusif, l'auraient mangé au cours de la première fête que connut l'humanité, puis auraient eu avec leur mère et leurs soeurs un commerce de galanterie.
Bachofen supposait, quelques années plus tôt, que les femmes avaient été les maîtresses de la société (gynécocratie) - après une phase où tout le monde couchait avec tout le monde (Hetärismus) - et qu'elles avaient profité de leur passagère prééminence pour inventer la civilisation.
Le diffusionisme, vieille lune des anthropologues, très appréciée des hétéroclites, folâtres et autres saugrenus, est l'étrangeté faite théorie. Il s'agit de faire se visiter des civilisations très éloignées dans l'espace et le temps. Cette juxtaposition, proche parente de l'image surréaliste ou de l'illustration de science-fiction (des cosmonautes chez les hommes des cavernes), suffit à plonger certains esprits dans un ébahissement mêlé d'un suspect sentiment de reconnaissance, qui est la définition de l'étrangeté. Leo Frobenius soutenait que la civilisation de l'ouest africain (qu'il identifiait curieusement avec l'Atlantide) a emprunté ses traits principaux à l'Océanie. Elliot Smith faisait partir toutes les civilisations de l'Egypte ancienne. Ce sont les Egyptiens qui auraient appris les pyramides aux Mayas, avec, comme intermédiaires, les Cambodgiens et les Japonais. Et le colonel Churchward n'eut qu'un pas de plus à faire pour fixer le point de départ universel dans un continent englouti, l'antique Lémurie, qu'il appellait Mu pour la rendre plus étrange.
Etrangeté du quotidien
L'étrangeté anecdotique appartient à l'ethnologie du quotidien.
Il n'existe pas de livre sur l'étrangeté des petits faits. On la recueille dans des ouvrages sur les bizarreries et les bizarres (Le Livre des bizarres, Bechtel et Carrière, Laffont, 1981), présentés parfois comme des livres de références et de statistiques (The Book of lists, Bantam Books, 1977 ; David Letterman's book of top ten lists, 1995). Certains ouvrages ne tiennent pas leurs promesses. Le Livre Guinness des records n'est qu'une encyclopédie populaire, sans la moindre trace d'étrange ni même de singularité. Mais le Quid, de Dominique et Michel Frémy (Laffont), au fil du recopiage inintelligent de faits et de statistiques, renferme d'innombrables bizzareries, incongruités, sottises et lubies, et, comme une partie d'entre elles semble imputable aux auteurs, a l'air parfois d'être écrit par des furieux.
Une liste des thèmes de l'étrangeté anecdotique comprendrait probablement les têtes de chapitres suivants :
On s'abuserait d'ailleurs en croyant que tout ce qui est rangé généralement sous ces intitulés est étrange. Les théories des charlatans et des illuminés, esprits déséquilibrés et fertiles, sont souvent consternantes, à proportion de la médiocrité intellectuelle des concernés. Les singularités des grands de ce monde sont atterrantes, les coïncidences miraculeuses sont enjolivées, les curiosités de cabinets de curiosités sont banales.
Les parasciences, en réalité, échappent presque entièrement à notre sujet puisque, vrais ou imaginés, les phénomènes qu'elles décrivent sont attestés de tous temps et en tous lieux et sont, en conséquence, le contraire de l'étrange ; une maison hantée ou un enlèvement par des extraterrestres sont à peu près aussi excitants pour l'esprit qu'un cours sur la certification ou un séminaire sur l'évolution des taux d'intérêt en Asie.
Le chapitre des excentriques réserve de cruelles déceptions. Un grand nombre d'observations s'explique par la psychiatrie et ne paraît étrange qu'aux yeux du vulgaire. Par exemple, manies, compulsions, collections bizarres sont souvent le fait d'une personnalité obsessionnelle. Nombre d'observations sont à l'évidence mal faites ou mal interprétées, de sorte que l'étrangeté n'est qu'apparente. C'est souvent le cas pour les excentricités sexuelles. Enfin, un grand nombre d'excentriques sont alcooliques ; cette pathologie a pour effet de lever les inhibitions et de favoriser des comportements exubérants - mais sans augmenter de façon sensible le taux d'étrangeté du malade.
Somme toute, la composition des liste hétéroclites de l'étrangeté anecdotique est souvent plus étrange que leur contenu. On peut se demander ce qui motive la coexistence à l'intérieur de la même couverture (The Book of lists) de statistiques sur la consommation de savon et d'histoires d'esprits frappeurs ou d'accidents bizarres, ou pourquoi l'auteur du Quid inclut une liste de femmes à barbes célèbres et, au milieu de la rubrique Histoire de France, se croit tenu à des détails de psychopathologie sur Louis XVI - il n'était pas idiot, comme on le croyait, mais très myope (il ne reconnaissait pas les gens) et d'une timidité maladive (il ricanait et se dandinait).
Certains ouvrages d'anecdotes sont très spécialisés, sans qu'on puisse deviner chez l'auteur un système justifiant son choix. Chez Charles MacKay (Memoirs of extraordinary popular delusions and the madness of crowds, 1841) les thèmes vont des croisades aux maisons hantées en passant par les sorcières, les magnétiseurs, l'engouement pour les tulipes, et l'horreur de l'église pour les cheveux longs et les barbes. Même si, chez MacKay, l'extravagance des foules europénnes est clairement, encore qu'inconsciemment, la contrepartie des coutumes étranges des peuplades étrangères, la liste des sujets traités semble due entièrement au caprice de cet auteur.
On note dans tous les ouvrages de cette veine, une recherche délibérée - et donc une fabrication - de l'étrange. Les livres sur Jack l'éventreur (à verser à la section des crimes remarquables ou mal élucidés) en offrent une parfaite illustration. C'est, semble-t-il, le caractère particulier des meurtres de l'éventreur (dissection partielle des victimes, à peu près correcte du point de vue de l'anatomiste) qui autorise les spéculations. Cependant, celles-ci perdent aussitôt de vue ce repère médical pour partir dans tous les sens. On relève ainsi parmi les suspects :
Ripley
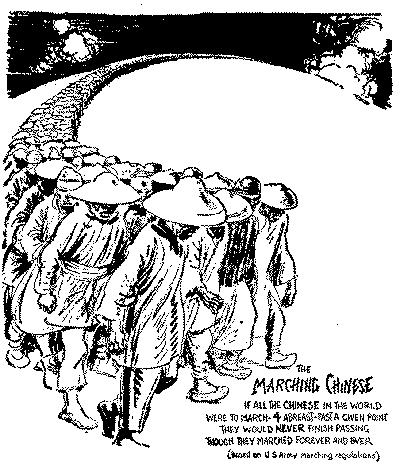
Robert L. Ripley reste le meilleur illustrateur de l'étrangeté du petit fait, de l'anecdote, de ce que les Anglais appellent trivia. Sa rubrique dans les quotidiens était intitulée Believe It Or Not. En français : Incroyable mais vrai.
Ripley (mort en 1949, mais la rubrique lui survécut) emprunte aux scientifiques (science amusante, mais aussi curiosités philologiques et mathématiques), manifeste une fascination pour les phénomènes de foire, monstres, prouesses et particularités physiques qui n'eût pas été déplacée au moyen âge et à la Renaissance (qu'on pense à l'essai de Montaigne sur les monstres), et montre une tendresse particulière pour ce qu'il faudrait appeler les célébrités inconnues, le Thug le plus meurtrier de tous (931 assassinats en 40 ans), le champion du monde du cri du cochon, etc. Il rafole des coutumes bizarres.
Tout cela remonte clairement à Jean de Mandeville et d'ailleurs Ripley se présente non comme un rat de bibliothèque, comme on s'y attendrait, lisant à longueur d'année des encyclopédies en mâchouillant des croissants, mais comme un globe-trotter qui s'est imposé la gageure de parcourir tous les pays de la Terre.
Ainsi, Robert L. Ripley touche d'un côté l'ethnographie, science des peuplades bizarres et de leurs coutumes étranges, et, de l'autre côté, l'anecdote locale et familiale sur l'homme qui a pendu 55 criminels ou le poussin à quatre pattes d'une fermière anglaise.
Ripley ne pénètre jamais dans le champ de ce qu'on appelle aujourd'hui le paranormal ou les parasciences. Il n'existe pas d'entrée de Ripley sur les soucoupes volantes. Pas de maison hantée, de cas de prémonition, de monstres antédiluviens. Le maximum de Ripley est la coïncidence remarquable.
Ripley s'adresse à l'enfance et à l'enfant dans l'homme. Partagé entre le jeu et la science, il appartient à l'univers de la petite école, comme les images de chocolat et les bons points illustrés.
On note chez notre auteur une agréable absence de rhétorique. Le ton de ses présentations n'est pas celui de l'aboyeur de foire ("Venez voir le phénomène le plus remarquable...") mais celui des légendes de photos amusantes dans les journaux du dimanche ("L'ours polaire : Monsieur X, de la ville de Z. prend des bains glacés dans l'étang par une température de moins dix degrés").
Ce qui, chez Ripley, se rapproche le plus d'une figure de style est une position intellectuelle. Il adore corriger et pinailler. Buffalo Bill n'a jamais tué un buffalo de sa vie. (Zoologiquement parlant, ses victimes étaient des bisons.) Lindbergh n'était pas le premier homme à traverser l'Atlantique en avion. (Il était le premier à traverser l'Atlantique en volant solo.)
Ce goût de la correction deviendrait rapidement insupportable chez un individu vivant. Mais, contenu dans les limites d'une rubrique quotidienne, rédigée de surcroît par un trépassé, il a le mérite de nous rappeler, que les faits sont acceptés le plus souvent dans leur version journalistique et légendaire. La culture générale est un tissu d'âneries et on ne se comprend si parfaitement, dans une conversation mondaine, que parce qu'on répéte à qui-mieux-mieux des erreurs. Règle immuable, quel que soit le domaine - en conséquence de quoi tout érudit, dans sa spécialité, fabrique lui aussi du paradoxe ripleyien dès qu'il ouvre la bouche : Walt Disney n'a pas inventé Mickey (créé par Ub Iwerks). Jules Verne n'a pas prévu les merveilles scientifiques du futur, telles le sous-marin et la fusée. (Le sous-marin existait de son temps et il n'y a pas de fusée dans son oeuvre.) Maria Callas n'a pas perdu sa voix parce qu'elle a maigri. (Elle la perdait depuis des années et dut finalement interrompre sa carrière.) Lamarck n'est pas transformiste et Darwin n'est pas darwinien. (Lamarck n'a jamais cru qu'il suffisait à une girafe de tendre le cou pour l'allonger et transmettre ce trait à sa descendance ; par contre, Darwin admet l'hérédité des caractères acquis !) Keynes n'est pas keynésien (dans le long terme, c'est sur la consommation qu'il faut agir pour résorber le chômage, et non sur l'investissement ou sur la dépense publique). Et ainsi de suite, ad nauseam.
Pour les sciences et techniques, le purisme de Ripley produit une étrangeté physique, due à la perte des repères habituels. Believe It Or Not nous apprend, entre autres :
On constate qu'avec un peu d'entraînement, on peut fabriquer à volonté du Ripley géophysique. Par exemple :
Le sujet des pôles, entre tous, semble inépuisable. Suggérons seulement :
On pourrait concevoir de façon théorique une culmination dans le paradoxe chez Ripley, qui fût le summum de l'étrange et tînt compte de tous les facteurs ripleyiens (un raisonnement ou au moins un calcul, plus un fait d'observation, et de préférence exotique.)
Ce que Robert L. Ripley a fait de mieux, de son propre aveu, ce sont les Chinois en marche. "Si tous les Chinois du monde se mettaient à défiler en rang par quatre, devant un point donné, ils ne finiraient jamais de marcher, même s'ils marchaient éternellement. (Basé sur le manuel militaire de l'armée américaine.)"
De façon caractéristique, l'étrangeté procédait ici de ce que Ripley n'ait pas justifié son paradoxe. Le lecteur, tout en se doutant qu'il devait y avoir une démonstration, qu'il était incapable de deviner, imaginait vaguement ces hordes inépuisables de Chinois et les trouvait convaincantes. L'explication est la suivante : vers 1930 les Chinois étaient 600 millions à travers le monde. Conformément aux réglements de l'armée américaine, ils eussent dû défiler devant le point P, quatre de front, approximativement à trois miles à l'heure et en ne dépassant pas 15 miles par jour ; de cette façon, une nouvelle génération serait née et eût atteint l'âge de marcher avant que la génération précédente ait passé devant le point P.
La rubrique de Ripley fut immensément populaire. Cependant, l'engouement pour Believe It Or Not ne va pas jusqu'à l'acte d'achat. Personne n'achèterait sous sa forme primitive un livre entier de Believe It Or Not *******, parce que l'épreuve de le lire excède les forces humaines. (Qui pourrait lire à la suite, par exemple pour s'endormir le soir, des milliers de faits renversants, amusants, étonnants, etc ?)
Parce qu'il n'y a pas d'achat, il n'y a pas consommation au sens économique du terme. Believe It Or Not est un supplément (une prime) ou une commodité, comme le fait que les pots de moutarde une fois vidés deviennent des verres de table. Le Believe It Or Not de Ripley est dans la nature et non dans le commerce. La lecture de Ripley est assimilable à l'observation d'un moineau prenant un bain dans une flaque ou de l'alignement fortuit de Vénus et de la Lune, avec le lampadaire du coin de la rue. De la sorte, Believe It Or Not exprime jusque dans son mode de consommation l'étrangeté du quotidien.
Charles Fort
Charles Fort ressemble à Ripley, étant comme lui un collectionneur maniaque de faits étranges. Mais, contrairement à Ripley, il semble que Fort n'ait écrit que de son vivant. De plus, l'aspect commercial de son entreprise est peu convaincant, l'auteur ayant vécu de ses rentes et occupé son temps à lire in-extenso le contenu des bibliothèques publiques. Parlant de ses lecteurs, il écrit "il", et même "tous les deux", en ajoutant cependant, "si j'ai cette chance".
Les premiers livres de Charles Fort (The Book of the damned, 1919, New Lands, 1923) sont des nomenclatures à la mode victorienne de données inhabituelles, avec une préférence marquée pour les pluies d'objets hétéroclites, grenouilles, cailloux de forme bizarre, glaçons, et pour les phénomènes curieux observés dans le ciel. Mais l'auteur mentionne aussi, au hasard des chapitres, des empreintes de pieds humains dans des couches géologiques anciennes ou des monnaies grecques trouvées dans des tumuli pré-colombiens. Cette moisson d'observations est ramassée dans de vieux bulletins scientifiques et dans la presse générale.
Dans ses deux derniers livres (Lo !, 1931, Wild Talents, 1932), l'auteur a élargi ses intérêts au poltergeist, aux animaux bizarres ou inconnus, à la combustion spontanée, aux apparitions ou disparitions subites de personnes, etc.
Tous ces faits inexplicables sont les "damnés" du titre du premier ouvrage de Fort, car les scientifiques ont eu tendance spontanément, non à les expliquer (explain) mais à les dissiper (explain away). L'auteur se gausse de ces tentatives, en émiettant en chemin des doutes sur la compétence, l'intégrité et la santé mentale des savants concernés. Des passages lyriques offrent des hypothèses de remplacement extrêmement aventurées et exprimées dans un style vigoureux et imagé, l'entreprise ayant pour but final de ridiculiser à la fois les scientifiques et les prétentions unificatrices de la science.
A côté des auteurs qui expliquent les faits (explain) et de ceux qui les dissipent (explain away), il faudrait sans doute créer une troisième catégorie, ne contenant que Fort, des auteurs qui abusent des faits (abuse facts). La méthode de Charles Fort échappe à toute logique. Il passe sans cesse et sans provocation des faits (tenant par principe pour l'authenticité d''un fait étrange et dénigrant le savant qui a essayé de le banaliser) à des hypothèses explicatrices aberrantes, tournant, dans The Book of the damned et New Lands, autour de l'idée qu'il existe des mondes en dehors de celui-ci (mondes qui ne sont pas des planètes, apparemment, mais peuvent avoir toutes les formes, y compris celle d'une roue ou d'un fuseau), dont les routes commerciales passent à proximité de la Terre. Tous les objets hétéroclites qui tombent en pluie sur notre globe sont donc soit des "objets trouvés" abandonnés par des visiteurs extramondains, soit des épaves drossées par les courants célestes. Pour expliquer des monnaies anciennes dans des tombes américaines, Fort imagine un univers baptisé Super-Romanimus, qui aurait visité la Terre et dont les anciens Romains ne seraient qu'une colonie perdue. Il fait aussi l'hypothèse que la race humaine est possédée par des maîtres invisibles.
Charles Fort emploie constamment le mot Intermediateness (nature intermédiaire), qu'il oppose à Positiveness (caractère positif). Rien n'existe positivement pour Fort - c'est l'erreur des savants. Il n'y a que des degrés insensibles, par quoi toute chose participe quelque peu de son contraire. Il parle aussi d'un "principe de continuité" - entendez que les choses se fondent l'une en l'autre de façon insensible et sans rupture.
Ces divagations philosophiques (très résumées ici) sont écrites dans un style pompeux et ennuyeux, quoique télégraphique, et ont peu d'attraits. Mais l'attitude qu'elles révèlent chez notre auteur est remarquable : Fort était probablement (avec G. K. Chesterton) le dernier esprit médiéval.
Le propre de la démarche scientifique est de dégager des lois, exprimables par exemple par des équations. Il appartient à chacun de décider si ces lois sont simplement des sortes de métaphores commodes ou si elles expriment "réellement" des propriétés fondamentales de l'univers. Quelle que soit la position adoptée, tout le monde s'accorde en tous cas sur la validité de la méthode et le caractère immuable de ses résultats. A l'exception de Charles Fort.
Charles Fort vivait dans un univers flou, inexact et fonctionnant mal. Il reconnaissait qu'il eût été extraordinaire que les planètes fussent toutes plates, et il donnait à la Terre une forme quelconque, grossièrement ronde ou, pour mieux dire, patatoïde, en tous cas non modélisable.
Fort exécrait les astronomes. New Lands leur est entièrement consacré, ainsi qu'aux phénomènes bizarres observés dans le ciel. Les amateurs de la planète Mars y glaneront une belle gerbe d'observations d'activité martienne et de signaux martiens, au début du siècle.
Les astronomes, selon Fort, se trompent tout le temps. Les comètes ne reviennent jamais l'année où elles sont annoncées, les pluies d'étoiles filantes n'ont jamais lieu à la bonne date et Le Verrier (que Fort s'obstine à orthographier Leverrier) n'a pas découvert Neptune. Ses calculs étaient faux et la découverte due au hasard ; pour faire bon poids, Charles Fort adore raconter l'aventure de la planète Vulcain, planète intra-mercurienne, imaginaire, celle-là, mais à laquelle le grand astronome crut éperdument.
Un bon exemple des méthode aberrantes de Charles Fort est fourni par le chapitre de New Lands consacré à Meteor Crater, qui, en 1923, s'appellait encore Coon Butte.
Les partisans d'une origine météorique du cratère supposaient alors l'astre visiteur enterré sous le cratère. L'illustre géologue G. K. Gilbert chercha des anomalies magnétiques liées à la présence d'une masse enterrée et n'en détecta pas. Il conclut à l'origine plutonienne du cratère. Un excentrique ingénieur des mines, D. M. Barringer, ayant fait le plan de s'enrichir en récupérant la montagne de nickel ferreux qu'il croyait enterrée, consacra sa vie à des forages, ne trouva rien et perdit son latin.
En fait, les géologues se trompaient tous. Meteor Crater est bien d'origine météorique mais le projectile n'est pas enterré en-dessous, car il s'est volatilisé au moment de l'impact.
Que tire Charles Fort de ce dilemme des chercheurs ? Il constate le cratère, note qu'on n'a pas trouvé de météorite géante en-dessous. Il estime par contre que, les nombreuse petites météorites trouvées alentour étant serties dans des terrains de diffférentes natures, elles ont des âges différents ! Il en tire que l'endroit a été régulièrement bombardé (sic) depuis "un point fixe" (?). Enfin, pour expliquer le cratère, il parle de la différence de potentiel entre les mondes et d'une gigantesque décharge électrique (souvenirs confus des expériences de Tesla) !
Charles Fort ignore l'âge du cratère mais précise que certains cèdres à son bord sont vieux de plus de 700 ans. (L'âge de Meteor Crater est estimé entre 50 000 et 22 000 ans.)
Notre auteur a, on le voit, laissé courir son imagination à partir de données géologiques qu'il ne comprend pas et de l'image obsédante d'un coup de tonnerre entre les mondes.
Un an après la parution de New Lands, C. A. Gifford publia la théorie de la volatilisation des météorites et de l'énergie radiale, expliquant du coup pourquoi Meteor Crater ne contient pas de météorite (et accessoirement pourquoi tous les cratères de météorites sont circulaires, alors que toutes les météorites ne tombent évidemment pas à la verticale). Si Fort avait eu connaissance de cette importante publication, il aurait, une fois de plus, ironisé sur l'aptitude des savants à disqualifier les faits gênants par des explications ad hoc.
Comme pour la matière d'oeuvre des occultistes, les faits recensés par Fort échappent à l'étrangeté par leur masse même - et ses ouvrages par leur encyclopédisme. "I never write about marvels," écrit-il dans Wild Talents, en récusant, très "grand seigneur", une histoire du New York World sur un chien qui dit "bonjour" à des policiers avant de disparaître dans une fumée verte.
Il semble même que les délires d'imagination de Charles Fort soient destinés à réinjecter de l'étrange dans une oeuvre d'où elle s'est écoulée comme d'un crible.
Charles Fort écrit mal, sans se relire, en style télégraphique, en abusant des tirets, et ses livres, même composés, gardent on ne sait quoi qui sent la page dactylographiée péniblement avec deux doigts.
Son attitude est absurde, ses enjeux peu clairs et criticables. On imagine très bien, avec notre auteur, une petite conversation à la Peanuts. "Je veux couvrir les savants de ridicule, dit Fort. - Je comprends, fait son lecteur.Vous voulez, en satirisant la science et les savants, les prémunir contre l'esprit de système, le préjugé, la sottise, le pédantisme et la vanité, dans l'espoir que leurs travaux soient meilleurs. - Hein ? Quoi ? Pas du tout, répond Fort, je veux ridiculiser les savants."
Il se dégage des pages de Fort une atmosphère de folie douce. Le titre même de son troisième livre Lo ! (Tenez ! Voyez ! Là ! ou bien Oh ! Pas possible !, etc.) excite le rire. On imagine ce petit homme qui ressemblait étonnamment à un morse secouant tristement la tête en nous montrant du doigt un nouveau fait complètement inexplicable - sauf à imaginer une force qui déplace choses et gens à travers l'espace et le temps, car Fort a consacré cet ouvrage à ce qu'il appelle la téléportation. Cette force supposée, venue remplacer l'hypothèse d'îles, de fleuves de boue ou de banquises célestes, n'est encore qu'une concrétisation du postulat initial de Fort, qu'on pourrait baptiser le principe d'inorganisation générale de l'univers.
Charles Fort a été tellement pillé par les hétéroclites, en particulier soucoupistes, que ses plus belles inventions sont déjà connues du lecteur du rayon Univers secrets ou New age. Kaspar Hauser, la princesse Caraboo et la Marie-Céleste, vedettes de Lo !, sont au menu de presque tous les ouvrages de cette veine, les auteurs étant trop paresseux pour aller chercher leurs propres faits étranges et ayant l'habitude de se recopier les uns les autres, en en rajoutant - ce qui confère aux "aventures mystérieuses" qu'ils rapportent le degré adéquat de bizarrerie.
On peut considérer ce pillage comme inévitable. Comme Charles Fort l'écrit lui-même, dans Wild Talents : "A ce jour, on n'a pas encore décidé si je suis un humoriste ou un savant."
Les faits proposés par Fort à la perplexité du lecteur peuvent se ranger facilement dans les catégories fétiches des saugrenus. Par exemple, tout ce que Fort voit dans le ciel tombe sous l'intitulé des soucoupes volantes, extraterrestres et autres civilisations ultramondaines et clandestines. Cependant, il crève les yeux que les hétéroclites sont en contradiction fondamentale avec Fort, puisque leurs théories, bien que biscornues, sont unificatrices. Leur emprunt ressortit en conséquence à la fraude, et est dénoncé par les faits eux-mêmes accumulés par Fort - les fameux damnés du titre de son premier livre, hurlants et piaulants. Par exemple, les pauvres soucoupistes, ayant recopié dans Fort un disque volant muni d'un crochet et une sorte de roue lumineuse, sont obligés de claquer la porte sur tout le reste, qui réunit dans l'azur le contenu d'une mercerie, d'un bazar-quincaillerie et d'un réfrigérateur.
Un plagiat fort médiocre (Le Matin des magicien, 1960) lança Fort chez nous, sans qu'on se souçiât beaucoup de le traduire ou de l'expliquer. Une génération de concierges fut élevée sur l'idée qu'il était un puissant mystagogue. L'emprunt fortéen explique des positions comme celle de Jacques Bergier écrivant pour la collection J'a Lu. (Rappelons que le co-auteur du Matin des magiciens admettait les visites d'extraterrestres, mais pas les soucoupes volantes. Il se confessait, sur ce point, en désaccord avec les autres auteurs de la collection. Référence directe, encore qu'incompréhensible, hors du contexte, aux cargos célestes fortéens et à un univers de bric et de broc, flottant dans l'éther.)
Charles Fort a énormément inspiré la science-fiction. Le concept de téléportation est passé tel quel dans le roman scientifique. Lo ! fut feuilletonné dans le pulp Astounding stories.
Les auteurs ont souvent cherché une explication unificatrice des faits "fortéens", c'est-à-dire une réfutation de Fort par Fort. Un excellent exemple est Sinister Barrier (1939) d'Eric Frank Russell. L'existence d'êtres invisibles se nourrissant de nos émotions (hypothèse fortéenne de nos "maîtres invisibles") explique... tout le reste ! - tous les phénomènes étranges ou inhabituels (induits par télépathie par les invisibles, pour provoquer en nous une nourrissante inquiétude) et, plus sinistrement, la désorganisation "normale", le crime et la guerre, nos maîtres invisibles se repaissant de la haine, de la douleur et de la cruauté humaine.
Les scientifiques orthodoxes, fussent-ils romanciers d'anticipation, regardent Fort avec méfiance. Isaac Asimov le détestait.
Comme beaucoup de livres fondateurs, ceux de Fort sont mal écrits et quelque peu au-dessous de leur réputation. Leur enjeu est plus important que leur composition.
Harry Morgan
NOTES
* parce que les unités de poids applicables aux plumes suivent le système "avoirdupois" (16 onces à la livre) alors que les matières précieuses sont pesées selon le système "Troy" (12 onces à la livre). Retour au texte.** ... mais un arc de cercle, comme le prouva Lindbergh - qui n'était pas le premier homme à traverser l'Atlantique en avion - en volant de New-York à Paris. Retour au texte.
*** Le pôle magnétique est à 1500 miles du nord géographique, vers 97 degrés de longitude ouest. Retour au texte.
**** Ils tournent tous deux autour de leur centre de gravité commun, ou barycentre. Retour au texte.
***** Le pôle géographique, le pôle magnétique et le pôle géomagnétique, résultant du calcul et inventé par Gauss. Retour au texte.
- ****** Non parce que la glace est trop dure mais parce qu'il n'y a pas de terre à cet endroit et que la banquise dérive. De sorte que le lendemain de la cérémonie, le drapeau ne serait plus exactement au pôle. Retour au texte.
******* Les Ripley's Believe it or not qui figurent sur les listes de best-seller ressemblent peu ou prou à de vrais livres et racontent, par exemple, les voyages de Ripley. Retour au texte.