
LES DEUX CROISADES DE L'ABBÉ BETHLÉEM
UN APOSTOLAT BIBLIOCIDE
À propos de Jean-Yves Mollier, La Mise au pas des écrivains : l’impossible mission de l’abbé Bethléem au XXe siècle, Fayard, 2014

L’abbé Bethléem, auteur de Romans à lire & romans à proscrire (première édition, 1904, nous citerons par la suite la sixième édition, 1914) est bien connu des amateurs de littérature populaire parce que son ouvrage, et la revue qui en est issue, Romans-Revue (1908), plus tard La Revue des lectures, sont souvent la seule source secondaire sur des fictions populaires par définition délaissées par la critique.
L’historien de l’édition Jean-Yves Mollier, déjà auteur en 2011 avec Matthieu Letourneux, d’un bel ouvrage sur la librairie Tallandier, nous brosse ici le portrait du sévère abbé et retrace sa campagne contre les mauvais livres, corrupteurs et tourneboulants. L’auteur n’hésite pas à voir dans la croisade morale de l’abbé l’origine de la célèbre loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, qui, elle, est surtout connue des amateurs de littératures dessinées, puisqu’elle permit à une commission de siphonnés recrutée tout exprès (Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence) de contrarier efficacement l’édition de bandes dessinées dans notre beau pays, et subsidiairement d’enquiquiner, sous prétexte de protection de la jeunesse, l’ensemble de l’édition et de la presse françaises.
Cependant la thèse de Mollier sur le caractère fondateur de l’apostolat de Bethléem est affirmée plutôt que démontrée, l’auteur se contentant de répéter que l’action de « moralisation » de l’abbé trouve « son aboutissement » dans la loi de 1949. Comme l’abbé est mort en 1940, il n’a pu contribuer d’aucune façon à la loi. Jean-Yves Mollier s’en tire en parlant pour la période 1940-1949 (car la loi contre la bande dessinée à d’abord traîné dans les cartons du régime de Vichy) de « revanche posthume », et en expliquant que « l’âme de l’abbé Bethléem a plané sur l’Assemblée nationale en ces jours de juillet 1949 » (p. 431). On est ici dans la métapsychique, pas dans l’analyse historique. Spécifiquement, il faudrait expliquer pourquoi la loi de 1949 fédère dans l’enthousiasme tout ce que la France compte alors de crétins et d’obscurantistes, qu’ils soient chrétiens, staliniens ou laïques. Le lecteur devra se contenter de l’observation que l’abbé Jean Pihan (de Cœurs Vaillants), a joué un grand rôle dans les rapprochements entre mouvements de jeunes des différentes obédiences (p. 425). C’est un peu maigre. Et comme par définition Mollier n’étudie que le courant catholique, son analyse est forcément incomplète. Notre auteur est comme un homme qui observerait le paysage intellectuel français de la première moitié du XXe siècle à travers des verres teintés en violet et qui conclurait que la teinte dominante de ce paysage est indubitablement le violet.
L’abbé Bethléem était un catholique « à la droite de Dieu » pour emprunter le spirituel titre de Corinne Bonafoux-Verrax (À la droite de Dieu, La Fédération nationale catholique, 1924-1944, Fayard 2004). Antimoderne, horripilé par le divorce, le nudisme, la psychanalyse, les mœurs qu’on ne peut pas dire, le socialisme, partisan d’une vision du monde qu’on qualifierait aujourd’hui de conspirationniste, et ferraillant à ce titre contre ses têtes de Turcs, l’esprit protestant, les francs-maçons ou les maçonnisants, les juifs et/ou les étrangers (il mena vigoureusement campagne contre les frères Offenstadt, « dont le fondateur est d’origine allemande [comprendre : est un juif allemand] et qui s’est fait une triste spécialité de la plus dégoûtante pornographie », La Revue des lectures, 1922, p. 406), nataliste et eugéniste, patriotard, Bethléem est également franquiste. Cependant Mollier, que la rage emporte, a tendance à charger la barque, déjà bien pleine, de l’abbé, qui serait censé retirer du plaisir des campagnes de presse contre « le juif Freud » (p. 217) ou qui détesterait « Joséphine Baker et tout ce qu’elle représentait, l’art nègre, le jazz et la joie de vivre » (sic, p. 218).
Une triple incompréhension
Plus sérieusement, Mollier nous semble commettre, dans son analyse d’un apostolat bibliocide, trois erreurs d’appréciation. Il ne comprend pas comment fonctionne l’Index Librorum Prohibitorum, référence obligée en matière de censure catholique, il ne comprend pas comment fonctionne l’Église de Rome, il ne comprend pas comment fonctionne l’abbé Bethléem.
L’Index ne vise pas définition que les ouvrages immoraux ou contraires à la foi (et il ne concerne par définition que les catholiques). Par conséquent, l’abbé Bethléem ne fait aucunement « preuve de souplesse » (p. 79) en autorisant le théâtre de Hugo, ou les Trois Contes de Flaubert. Il applique strictement la consigne. (L’interdiction des opera omnia d’un auteur ne s’entend pas, avant 1929, des ouvrages de cet auteur qui ne contiennent rien contre la religion.) D’où tout justement la préconisation constante de l’abbé de donner les auteurs litigieux sous forme de morceaux choisis ou dans des éditions catholiques, judicieusement expurgées. D’où aussi la tolérance de l’abbé, dans Romans à lire & romans à proscrire (notamment p. 32), comme dans La Revue des lectures, en ce qui concerne les fabulæ amatoriæ. Ainsi, au lecteur qui, en 1929, proteste contre la recommandation par la revue d’un roman de Balzac, et qui rappelle que l’Index prohibe de Balzac omnes fabulæ amatoriæ, c’est-à-dire « tous les romans », l’abbé répond vertement que « la formule latine qui condamne les romans de Balzac condamne non tous ses romans, mais seulement tous ses romans d’amour impur. Or, Une ténébreuse affaire n’est pas un roman d’amour impur ; donc Une ténébreuse affaire ne tombe pas sous la condamnation de l’Église. » (La Revue des lectures, 1929, p. 749.)
Même incompréhension relativement à l’Église catholique romaine. Jean-Yves Mollier consacre une part considérable, pour ne pas dire l’essentiel, de son ouvrage, à tenter de démontrer que Bethléem exerce une influence énorme sur le monde catholique, que sa revue touche tous les prescripteurs, que l’abbé est très en cour à Rome, jusqu’à être louangé dans une encyclique papale. C’est évidemment une façon de prévenir une objection qui ferait de l’abbé le représentant d’un « parti sacristain », comme l’écrit un Joseph Delteil furieux (cité p. 196), voire un simple maboul. Dans le monde catholique, Jean-Yves Mollier ne mentionne comme opposants à Bethléem que Léon Bloy (qui accuse l’abbé d’attirer l’attention des petits curieux sur les mauvais livres) et François Mauriac (qui se défend contre l’accusation, portée contre ses romans, d’immoralité, sous un mince vernis de catholicisme). Bref, selon Jean-Yves Mollier, Louis Bethléem serait mainstream. Mais ce n’est tout simplement pas ainsi que fonctionne l’Église, qui est constituée d’une myriade d’œuvres, d’ordres ou d’organisations qui cherchent à qui-mieux-mieux à obtenir la protection du haut clergé et l’approbation pontificale. En l’occurrence la dénonciation par Delteil du « parti sacristain » est plus juste que la description que fait Jean-Yves Mollier d’un Louis Bethléem qui ferait l’unanimité ou presque. Au demeurant, Mollier note (p. 217) que l’abbé voit se dresser contre lui de puissants adversaires. La maison Hachette (dénoncée par ses détracteurs comme la pieuvre verte) va tirer la sonnette du cardinal-archevêque de Paris, en le priant de calmer son trublion, tandis que le Syndicat des romanciers (dont Claude Farrère, Léon Groc, H.G. Magog et Marcel Priollet, bien connus des amateurs de littérature populaire) flanque à l’abbé un procès en diffamation, et le fait bel et bien condamner. Bethléem lui-même conclut, résigné, alors qu’il touche au terme de son existence et de son apostolat : « Les catholiques dans leur ensemble n’ont jamais compris l’importance du livre, du journal, du théâtre, de la moralité publique » (La France Catholique, 4 juillet 1938, cité par Mollier p. 322). Bref, le sous-titre de l’ouvrage de Jean-Yves Mollier — l’impossible croisade de l’abbé Bethléem — nous semble beaucoup plus juste que l’ouvrage lui-même, qui argumente à peu près en sens opposé, qui tente de démontrer une croisade victorieuse, une croisade triomphante de l’abbé Bethléem, marchant à la tête du monde catholique rassemblé.
Pour finir, Jean-Yves Mollier comprend mal l’abbé Bethléem lui-même, dont il note à juste titre qu’il est sincèrement épris des lettres, et qu’il est un adversaire résolu de la littérature édifiante et crétinisante, mais qui n’en consacra pas moins son existence à dénoncer les « mauvais livres » (une existence apparemment heureuse et bien remplie, puisque l’auteur nous apprend que l’abbé, sur sa fin, ne disait plus que « le très-bon Dieu »). De cette contradiction entre l’amour des lettres et le travail de censeur, Jean-Yves Mollier ne parvient pas à s’extraire, et il s’en tire en faussant la balance, en chargeant le portrait de Bethléem, pour en faire un sale bonhomme, qui veut interdire même aux gens « éduqués et cultivés » la permission de jouir de leurs trésors (p. 432). Mais l’abbé dit exactement le contraire, et il le dit depuis le début, avec une constance inexorable. Son ouvrage « ne s’adresse pas spécialement à des lettrés mais à des consciences chrétiennes » (Romans à lire & romans à proscrire, Avant-propos des précédentes éditions). L’abbé dirige les lecteurs (catholiques) ordinaires, il n’a pas d’opinion sur ce que lisent des savants et des lettrés. « Il serait aussi ridicule d’interdire aux professeurs, aux critiques, aux professionnels de la littérature, la lecture de certains livres en soi très mauvais que d’interdire à un médecin la lecture des livres de médecine » (Romans à lire, romans à proscrire, p. 72). Cet argument d’un abbé qui guide non le lecteur averti mais le lecteur ordinaire, qui a besoin de conseils, « reviendra souvent sous la plume des critiques », note un Jean-Yves Mollier visiblement agacé (p. 208). Mais cet argument revient souvent pour l’excellente raison qu’il est sincère, Bethléem n’ayant jamais varié d’un iota sur ce point.
Mollier va jusqu’à soutenir que le distinguo opéré entre la qualité littéraire et l’interdiction de la lecture pour tel public fragile (par exemple les jeunes gens) « ne pouvait exister et que toute la tradition romaine de condamnation des grandes œuvres de la littérature française s’inscrivait en faux contre cette casuistique » (p. 191). Le point étant soulevé au sujet de Barrès, il est aisé de se reporter à La Revue des lectures (par exemple à l’année 1927 p. 77) pour voir ce qu’elle écrit de l’écrivain. « Le Mystère en pleine lumière, posthume de Barrès, prolonge de façon fatigante le conflit entre traditions païennes et chrétiennes, la chapelle et la prairie, la sybille, Jeanne d’Arc victime des fées. Enfin, quel mystère, dans quelle lumière ? Conclusion : laissons le livre aux seuls lettrés qui veulent suivre le chant de Barrès jusqu’à sa dernière note. » Comme on le voit, la prétendue incompatibilité n’existe pas. Que nous dit-on ? Que ça n’est pas chrétien, ou du moins que ça ne l’est qu’à moitié. Lisez ces proses si vous voulez avoir lu tout Barrès, ne les lisez pas si vous cherchez une lecture catholique. On conviendra que l’avis est utile pour un lecteur (catholique) de 1927, pour un prescripteur (qui pourrait mésinterpréter le titre et croire à quelque chose d’édifiant).
Une double croisade
D’un autre côté, il y a bel et bien, chez notre abbé, et dès le début de son entreprise, une confusion singulière. Bethléem déborde de la lutte contre les « mauvaises lectures » pour passer à une entreprise de moralisation générale. C’est précisément sur cette défense de la moralité publique (dénonciation de périodiques du type Frou-Frou, d’affiches suggestives, de pièces et films impressionnant l’imagination, etc.) que l’abbé marque des points auprès de l’opinion et des pouvoirs publics.
Jean-Yves Mollier note que l’abbé, en théorie spécialisé dans le roman, élargit très tôt au théâtre (Les Pièces de théâtre, 1910). Mais ici, le distinguo est anachronique. Pour Bethléem, qui est un homme du XIXe siècle, la littérature s’entend comme la poésie, le théâtre et le roman. (C’est au XXe siècle que le roman devient hégémonique.) Par contre, la croisade de moralisation publique de l’abbé Bethléem dépasse indiscutablement l’horizon qu’il s’est lui-même fixé, puisqu’il en arrive à militer contre l’indécence et l’immoralité sur les plages (tous ces gens qui pique-niquent et qui font du camping, et qui se montrent en maillots de bain), contre les mannequins de cire des grands magasins, exhibant de la lingerie, etc.
C’est apparemment l’image qui a servi ici d’embrayeur, et qui a conduit l’abbé de la république des lettres, et donc de l’examen de la littérature in abstracto, à la surveillance de la moralité publique, et donc à l’examen de la littérature in situ (les journaux cochons exposés à la vue de tous), puis à la surveillance de l’espace social dans son entier. Dans l’ensemble des imprimés, Bethléem s’en prend avec une particulière virulence aux illustrés (en particulier aux fascicules populaires américains du type Nick Carter, édités par Eichler, maison allemande, et aux journaux des éditions Offenstadt, maison juive allemande). Émule du sénateur Bérenger (le célèbre « père la pudeur »), Bethléem déchire les publications licencieuses sous les yeux des kiosquiers et désire de se faire arrêter (pour créer le scandale et demander pourquoi les lois réprimant l’outrage à la pudeur ne sont point appliquées). À partir de là, Bethléem et ses suiveurs en viennent plus ou moins rapidement, plus ou moins insidieusement, plus ou moins automatiquement, aux tentatives de pression sur les distributeurs et sur les kiosquiers (qui sont invités à retirer de la vue du public la littérature litigieuse).
Ce point crucial du passage, ou de la compénétration, entre le monde des lettres et le contrôle de la moralité publique est curieusement absent de l’ouvrage de Jean-Yves Mollier, qui ne voit son auteur que comme le militant catholique d’une croisade morale et qui prétend mettre au jour ses noirs desseins moyennant des chaînage interprétatifs qui relèvent parfois de la spéculation ou de la simple polémique : interprétation alarmiste (« la volonté de mise au pas des écrivains catholiques était en train de devenir une réalité beaucoup plus intrusive qu’elle ne l’avait été en 1857, lorsque le procureur Pinard condamnait Baudelaire et Sue, et sermonnait Flaubert », p. 196), appréciation péjorative (« [Bethléem] dévoile le fond de son idéologie et de sa vision du monde », p. 314 — et ce dévoilement permet de tracer une ligne droite de la condamnation du modernisme par Pie X au franquisme), voire recours à l’affabulation (« On peut imaginer (sic) que la présence dans la plupart des bibliothèques paroissiales de La Revue des lectures aida plus d’un [censeur de Vichy] partisan de la révolution nationale à arrêter ses choix », p. 380). Certes d’un abbé qui, dans les années 1930, publie des articles de la veine « Le général Franco lutte contre la pornographie », on peut penser que la cause est entendue. Mais, outre qu’il est toujours dangereux de se livrer à l’uchronie et de faire des suppositions sur ce que Bethléem aurait fait, aurait pensé, pendant l’Occupation s’il avait vécu, il se pose ce problème supplémentaire que, comme Mollier a pris soin de décrire l’influence de Bethléem sur le monde catholique comme hégémonique, sa polémique vise finalement l’ensemble des catholiques, et nous apprenons donc que « de la mise hors-la-loi des francs-maçons à l’exclusion des juifs de la communauté nationale, il n’y avait qu’un pas, vite franchi » (p. 387), que cette mesure, « La Revue des lectures comme d’autres périodiques catholiques avait préparé les esprits à [l’] accepter » (p. 388), et que « les catholiques étaient plus que d’autres préparés à accepter la législation de Vichy » (p. 390), d’autant que la délation de ses voisins « juifs, francs-maçons et résistants est une pratique douteuse, abusivement dérivée de la pratique de la confession » (sic, p. 306). Les journalistes bien-pensants de 2014 ne s’y sont pas trompés, qui, ayant lu l'ouvrage de Mollier, associent l’abbé Bethléem aux « accusations de perversion à l'encontre de “notre belle jeunesse”, lancées par les initiateurs de La Manif pour tous. » (Le Monde du 12 mars 2014).
Un ouvrage écrit trop vite
L’ouvrage de Jean-Yves Mollier souffre manifestement d’avoir été écrit trop vite. Tout est répété, parfois de page en page, ce qui entraîne chez le lecteur lassitude et perplexité. Le propos est parfois incompréhensible, faute d’une rédaction claire. (« Le père Janvier transforme ainsi le critique Jules Lemaître, dix ans après sa mort, en authentique croyant, ce qui semble difficile à admettre », p. 181. « Avec le ralliement... de Jules Lemaître... c’étaient les gardiens du temple de la littérature qui ralliaient l’Église catholique », p. 182.)
Mollier fait des concours de bêtise avec l’abbé Bethléem et c’est l’historien moderne, et non l’ecclésiastique du siècle dernier, qui condamne (p. 84) le capitaine Danrit (inventeur, nous apprend-on, du péril noir) et Paul d’Ivoi (qui serait, lui, l’inventeur du péril jaune).
Les erreurs abondent, parfois mortifiantes. On nous informe p. 289 que l’argentin Raoul Walsh préféra donner sa place à son compatriote Galvez dans le jury du concours du roman antibolchévique, « preuve d’un malaise présent dès l’origine dans cette tentative maladroite pour faire de la “bonne” littérature avec des sentiments situés à droite de l’échiquier politique » (p. 289). Le malaise est indéniable. Il ne fait que croître lorsque, renseignement pris à la source, il s’avère que la confusion est avec le P. Walsh, qui au demeurant n’est pas davantage argentin que le cinéaste Raoul Walsh. (Il s’agit du jésuite Edmund Aloysius Walsh, directeur et fondateur de l’école des affaires étrangères et vice-président de l’université de Georgetown.)

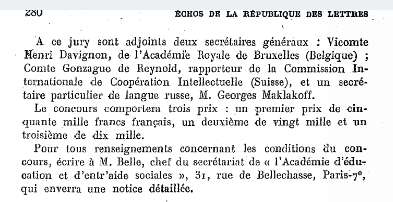
L’abbé Bethléem rêve de faire surveiller la radiodiffusion française par des équipes de volontaires, à l’imitation du Council of Decence américain (p. 307). Il n’existe aucun organisme de ce nom, Decence n’était au demeurant pas un terme anglais. (Souvenir confus de la Legion of Decency ?). Les Grands cimetières sous la lune sont donnés p. 321 comme un «roman » de Bernanos. Le père de Maurice Girodias n’exploitait pas Olympic Press (p. 448), mais Obelisk Press, et Maurice Girodias exploitait Olympia Press (correctement identifiée p. 453). Vaillant, illustré communiste, ne publie pas Rahan à sa création en 1945 (p. 424). Il faudra attendre Pif Gadget, un quart de siècle plus tard. Le même journal (Vaillant puis Pif Gadget), apprenons-nous p. 427, profite « au début des années 60 de l’engouement des lecteurs français pour la BD d’origine belge et pour le trait clair plutôt que gras », assertion qui nous demeure impénétrable. Hara Kiri n’a pas été deux fois interdit, en 1961 et 1966, « puis au lendemain de la mort du général De Gaulle en novembre 1970 » (p. 440), il s’agit de deux publications différentes, Hara Kiri (mensuel), sous-titré journal bête et méchant (1960), et Hara-Kiri Hebdo (1969). Le professeur Choron s’appelait Georges Bernier, pas Georget Bernier. Les dessinateurs de Charlie Hebdo n’ont pas fait leurs armes à Pilote (même page).
L’auteur n’est pas incapable d’affabulations juridiques et on apprend p. 421 que Boris Vian a été condamné en 1950 car « entre-temps la loi du 16 juillet 1949 [serait] venue aggraver les délits en matière de littérature érotique ». (Propos réitéré p. 448 : « avec le procès intenté à Boris Vian pour J’irai cracher sur vos tombes et Les Morts ont tous la même peau, le début des années 1950 marque un tournant que seule la loi de 1949 permet d’expliquer ».) Affabulation encore, p. 451 : l’ordonnance du 23 décembre 1958 amendant la loi de 1949, autoriserait désormais la saisie de tous les livres clandestins. Il n’y a rien de tel dans la loi de 1949, la Commission de surveillance ne pouvant pas connaître des livres clandestins.
On le voit, l’ignorance du domaine des littératures dessinées et l’ignorance du droit positif ferment la possibilité même de l’analyse de ce que la censure de la bande dessinée après-guerre doit au lobby catholique. Ce travail reste à faire.