

Classiques modernes


Classiques modernes
Raymond Briggs, Ethel and Ernest, Jonathan Cape, 1998
Posy Simmonds, Gemma Bovery, Jonathan Cape, 1999
Outre qu'il s'agit de très bons romans graphiques (nous allons en reparler dans un instant), ces deux oeuvres anglaises semblent faites à dessein pour illustrer comment les auteurs mélangent différents modes narratifs, qui se fondent les unes dans les autres de la façon la plus naturelle.
Dans Ethel and Ernest (1998), Raymond Briggs utilise à côté des unités classiques de la bande dessinée (strip, double strip, planche), des unités plus fondamentales (nous allions écrire plus naturelles) qui sont la double page et la vignette. Il arrive fréquemment que la même action se poursuive sur la page de gauche et de droite (l'unité est alors la double page), mais le fait de tourner la page correspond toujours à un hiatus (l'unité n'est donc jamais le folio). A l'autre extrême, l'action se limite souvent à une image isolée.
On note d'autre part que, chez Briggs, l'usage de la bulle n'est pas systématique et que les conversations sont souvent données dans une réserve blanche de l'image voire hors de l'image. C'est fréquemment le cas quand l'auteur utilise une image unique. Ces grandes images isolées en marge de laquelle une conversation est donnée in extenso reprennent donc, à peine modifié, le procédé du cartoon du 19e siècle, à la Punch.
Le choix étant fait de l'image narrative isolée, on constate en effet que les bulles ne sont pas le procédé le plus commode pour introduire les dialogues. Trop nombreuses, elles sont difficiles à placer dans la vignette et et leurs queues sont impossibles à diriger. De plus, en bande dessinée, la prolification des bulles se lit souvent comme l'indication d'une logorrhée. Enfin, une conversation longue dépasse la durée qui est embrassée par l'image, et les bulles auraient alors l'effet d'augmenter cette durée de façon quelque peu artificielle (un lecteur naïf peut se demander par exemple : Ethel et Ernest ont-ils vraiment le temps de se dire tout cela pendant qu'Ernest donne un unique coup de pinceau sur son plafond ?), alors que l'image unique avec conversation en marge est lue comme résumant synecdochiquement toute une scène (La conversation a lieu pendant qu'Ernest repeint le plafond).
Les conversations données en marge ou dans une réserve de l'image sont donc moins étroitement liées au dessin, elles renoncent à leur vocation de restitution naturaliste d'une scène et correspondent à des modes narratifs plus délicats, restituant par exemple la conversation chuchotée et disjointe du couple au lit, par le procédé très simple qui consiste à l'inscrire dans l'espace blanc que fait sur le parquet la lumière de la lune à travers les persiennes.
Cette innocence de la
forme sert admirablement le récit de Briggs. Ethel et Ernest,
les parents de l'auteur, traversent le siècle en enfants
sages, dociles et vulnérables face aux grands
événements.
Cette simplicité et cette innocence de la forme (l'auteur inventant ou réinventant une grande partie de ses procédés) sert admirablement le récit de Briggs. Ethel et Ernest, les parents de l'auteur, traversent le siècle en enfants sages, dociles et vulnérables face aux grands événements (la Dépression, la guerre). Ethel est un peu pimbêche, car elle a gardé de sa première position de bonne les attitudes petites bourgeoises de ses patronnes (elle nie par exemple faire partie de la classe laborieuse) ainsi qu'un sens aigu du décorum (« Ernest, parle correctement, s'il te plaît »). Même le discours de guerre Churchill, « blood, toil, tears and sweat », la choque. Ernest, qui sera toute sa vie livreur de lait, est plus déluré, mais sa connaissance du monde est médiatisée par le journal (de tendance labour) qu'il lit et commente tous les jours et son assurance se tourne aisément en embarras. Quand Ernest se réjouit de la nationalisation du charbon par le gouvernement travailliste (« l'argent ira à l'Etat au lieu d'engraisser les patrons »), Ethel lui demande si désormais le charbon sera gratuit ou si du moins le gouvernement ristournera les profits à la population. Et, comme Ernest répond par la négative, elle demande ce que la nationalisation change pour eux, objection à laquelle il ne trouve rien à répondre.
Cette fondamentale innocence des personnages apparaît aussi dans une conversation sur l'homosexualité. Ernest, embarrassé, essaie maladroitement d'expliquer le concept à Ethel (« C'est comme... deux hommes... seulement.... au lieu d'avec une femme... ») qui répond qu'elle ne comprend rien à son charabia et qu'il ne se comprend probablement pas lui-même ! On note d'ailleurs qu'Ethel et Ernest n'entretiennent aucune vie imaginaire d'aucune sorte, alors que la littérature dessinée semble faite pour illustrer la vie du rêve, du fantasme, de la névrose (qu'on pense à des auteurs français comme David B., aux BD de Crumb ou à cette extraordinaire illustration d'une névrose obsessionnelle qu'est Binky Brown Meets the Holy Virgin Mary de Justin Green).
Une oeuvre qui se tourne vers le passé court perpétuellement le danger de se changer soit en leçon d'histoire, soit en célébration kitsch de la « mode rétro ». L'histoire traverse effectivement le livre de Briggs et, d'une certaine façon, la vie d'Ethel et Ernest n'est qu'un long effort pour s'adapter à des changements - politiques, sociaux, technologiques - qui les dépassent. Le siècle cesse d'être le leur au moment où ils cessent de le comprendre (le programme lunaire est perçu par Ethel, déjà malade, comme une sorte d'enfantillage très compliqué, une sorte de pique-nique high-tech). Cependant cette histoire est toujours vue à hauteur d'homme. L'évocation de la guerre fait beaucoup penser au très beau film de William Wyler sur le home front anglais, Mrs. Miniver (1942). Ernest disparaît par exemple une journée entière, comme Walter Pidgeon dans Mrs. Miniver. Mais il n'a pas évacué les Anglais à Dunkerque, il a seulement déchargé des bateaux entiers de cadavres d'enfants déchiquetés et, à bout de nerfs, il fond en larmes dans les bras de sa femme. Ethel et Ernest contemplent leur maison blitzée en faisant la réflexion que somme toute cela aurait pu être pire (dans Mrs. Miniver, Greer Garson et Walter Pidgeon prennent le thé en faisant abstraction du fait que leur maison est éventrée).
La grande réussite de Raymond Briggs est d'expliquer de l'intérieur pourquoi Ethel et Ernest sont ce qu'ils sont. Le premier environnement quasi victorien d'Ethel explique son obsession des bonnes manières et le fait que pendant les hirsutes années 1960 elle tende à chaque occasion un peigne à son chevelu de fils. Si le trait est drôle, ni la mère ni le fils ne sont ridicules, chacun ayant simplement les attitudes de son époque. Cette équanimité de l'auteur est d'autant plus difficile à atteindre que chaque génération est naturellement convaincue d'être plus intelligente, plus délurée, plus moderne que la précédente (« les croulants »). On trouve un équivalent au cinéma des techniques de Briggs, dans le dernier film de John Huston, The Dead, où un plan montre la chambre d'une vieille dame et nous l'explique à travers ses objets, pendant qu'elle chante en voix off une romance sentimentale. Le message de Huston est clairement : « vous n'avez pas à vous moquer, vous n'avez pas à vous sentir supérieurs, vous n'avez pas à la trouver touchante ou désuète, ses attitudes n'ont ni plus ni moins de sens que les vôtres. »
Cela nous mène au trait le plus admirable d'Ethel and Ernest, qui est le fait que Raymond Briggs ait pu consacrer un livre à ses propres parents en n'éprouvant jamais vis-à-vis d'eux ni honte (par exemple celle de leur classe sociale : en rentrant du travail, Ernest se lave toujours à la cuisine, et non à la salle de bain, parce qu'il est « sale »), ni rancoeur ni irritation, mais sans jamais être tenté non plus de les mythifier et sans céder à l'émotion. L'auteur s'est délibérément placé au second plan de l'histoire. Sur la couverture, Raymond enfant apparaît à la fenêtre de la cuisine, ce qui le caractérise comme spectateur - comme le voyeur involontaire de ses parents -, et il occupe la même place hiérarchique dans le dispositif paginal que le chat. Il n'intervient dans le récit que dans la mesure où il est important dans la vie de ses parents, et c'est généralement en leur brisant le coeur : il est ramené à la maison par la police après un petit larcin, il opte pour des études d'art au lieu de « faire de bonnes études », il épouse une femme dont la fragilité psychologique lui interdit d'avoir des enfants.
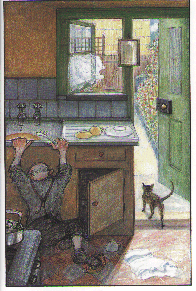 La
retenue de la narration (passant par le dessin isolé ou la
très courte séquence) et la fondamentale pudeur du
narrateur rendent le récit souvent extrêmement
émouvant, alors même que l'auteur refuse tout
attendrissement (on pense à un cinéaste comme Renoir,
qui coupe toujours le plan avant que l'émotion ne s'installe).
Certains éléments chargés d'une très
grande force émotionnelle sont donnés tels quels, en
connaissance de cause (c'est le cas du discours de Churchill avant la
bataille d'Angleterre, « blood, toil, tears and
sweat »). Mais, le plus souvent, c'est une sorte de
froideur et d'objectivité qui sert l'émotion. Les
dernières pages, consacrées à la brève
période de veuvage d'Ernest, montrent le chat, jusque
là décrit comme une sorte de parasite légal, qui
prend soudain la place laissée vide par la morte. Ce huis-clos
pathétique s'achève quand Ernest est victime d'une
crise cardiaque en se brossant les dents à l'évier de
la cuisine. Paradoxalement, cette scène, qui est
racontée dans une image unique occupant une page
entière, est peut-être la plus belle du livre. Dans
l'image précédente, c'était encore l'hiver et le
chat grattait à la porte du jardin pour se faire ouvrir. Mais,
à présent, l'hiver a laissé la place à
l'été, porte et fenêtre sont ouvertes sur le
jardin ensoleillé (toutes les portes sont ouvertes dans
l'image, même celle du placard sous l'évier), une brise
soulève le rideau, et le chat est sur le pas de la porte,
indifférent à l'agonie de son maître. L'auteur
nous laisse libres d'interpréter l'image. On peut choisir de
lire tous ces indices (les portes ouvertes, la brise qui fait voler
le rideau, le chat au seuil du jardin d'été) dans une
perspective spiritualiste, ou tout simplement dans une perspective
stoïcienne (la nature et le chat sont indifférents
à la mort d'Ernest parce qu'elle fait partie de la vie ;
cette mort est en réalité une délivrance).
La
retenue de la narration (passant par le dessin isolé ou la
très courte séquence) et la fondamentale pudeur du
narrateur rendent le récit souvent extrêmement
émouvant, alors même que l'auteur refuse tout
attendrissement (on pense à un cinéaste comme Renoir,
qui coupe toujours le plan avant que l'émotion ne s'installe).
Certains éléments chargés d'une très
grande force émotionnelle sont donnés tels quels, en
connaissance de cause (c'est le cas du discours de Churchill avant la
bataille d'Angleterre, « blood, toil, tears and
sweat »). Mais, le plus souvent, c'est une sorte de
froideur et d'objectivité qui sert l'émotion. Les
dernières pages, consacrées à la brève
période de veuvage d'Ernest, montrent le chat, jusque
là décrit comme une sorte de parasite légal, qui
prend soudain la place laissée vide par la morte. Ce huis-clos
pathétique s'achève quand Ernest est victime d'une
crise cardiaque en se brossant les dents à l'évier de
la cuisine. Paradoxalement, cette scène, qui est
racontée dans une image unique occupant une page
entière, est peut-être la plus belle du livre. Dans
l'image précédente, c'était encore l'hiver et le
chat grattait à la porte du jardin pour se faire ouvrir. Mais,
à présent, l'hiver a laissé la place à
l'été, porte et fenêtre sont ouvertes sur le
jardin ensoleillé (toutes les portes sont ouvertes dans
l'image, même celle du placard sous l'évier), une brise
soulève le rideau, et le chat est sur le pas de la porte,
indifférent à l'agonie de son maître. L'auteur
nous laisse libres d'interpréter l'image. On peut choisir de
lire tous ces indices (les portes ouvertes, la brise qui fait voler
le rideau, le chat au seuil du jardin d'été) dans une
perspective spiritualiste, ou tout simplement dans une perspective
stoïcienne (la nature et le chat sont indifférents
à la mort d'Ernest parce qu'elle fait partie de la vie ;
cette mort est en réalité une délivrance).
 Gemma
Bovery (1999) de Posy Simmonds offre également à
première vue un patchwork de techniques. Un texte romanesque
conventionnel (typographié) alterne selon le cas avec des
pages ou des demi-pages de BD, ou seulement avec des illustrations
(qui elles aussi incluent parfois des dialogues, avec ou sans
bulles). Différents autres documents textuels ou
graphiques - entrées de journal, photos, lettres,
etc. - complètent le dispositif.
Gemma
Bovery (1999) de Posy Simmonds offre également à
première vue un patchwork de techniques. Un texte romanesque
conventionnel (typographié) alterne selon le cas avec des
pages ou des demi-pages de BD, ou seulement avec des illustrations
(qui elles aussi incluent parfois des dialogues, avec ou sans
bulles). Différents autres documents textuels ou
graphiques - entrées de journal, photos, lettres,
etc. - complètent le dispositif.
Le procédé de l'alternance d'un texte romanesque conventionnel avec des fragments de BD est naturalisé par le fait que le roman (c'est-à-dire le texte typographié) est raconté à la première personne par le narrateur français, le boulanger Joubert, alors que la bande dessinée raconte les faits et gestes des personnages anglais, c'est-à-dire de l'illustratrice Gemma Bovery et des hommes qui l'entourent. L'alternance est parfois réduite à un passage textuel élémentaire (un paragraphe) et une image, et on retrouve alors un procédé constamment employé par le romancier victorien Thackeray dans son roman Vanity Fair, qui est le passage entre un texte romanesque conventionnel et une gravure. (On trouve par exemple le passage suivante, chapitre 14 de Vanity Fair : « When the young men went upstairs, and after Osborne's introduction to Miss Crawley, he walked up to Rebecca with a patronising, easy swagger. He was going to be kind to her and protect her. He would even shake hands with her, as a friend of Amelia's ; and saying, 'Ah, miss Sharp ! how-dy doo ?' held out his left hand towards her, expecting that she would be quite confounded at the honour. Miss Sharp put out he right forefinger, - » Le tiret introduit une gravure où on voit Miss Sharp le doigt en avant. Après quoi le texte reprend : « and gave him a little nod, so cool and killing, that Rawdon Crawley, watching the operations from the other room, could hardly restrain his laughter as he saw the lieutenant's entire discomfiture ; the start he gave, the pause, and the perfect clumsiness with which he at length condescended to take the finger which was offered for his embrace. »)
Cependant, un deuxième procédé est aussi important dans l'économie narrative de Gemma Bovery : à côté de l'alternance des zones de texte conventionnel et des zones compartimentées de bande dessinée (ou de l'alternance d'une zone de texte conventionnel et d'une image narrative isolée), on observe une juxtaposition ou une mise en parallèle des deux zones, textuelles et iconiques (tout se passe alors comme si l'histoire était racontée deux fois, en texte et en images). Ici encore, cette juxtaposition peut impliquer des unités minimales (un paragraphe de texte typographié, une vignette), mais, le plus souvent, ce sont plusieurs paragraphes et plusieurs vignettes qui sont juxtaposées. Cette juxtaposition peut correspondre à l'une ou l'autre des deux grandes modalités d'alliance du texte et du dessin : la bande dessinée (avec « texte à côté de l'image ») et le texte romanesque (très) illustré. On peut distinguer les deux par un critère simple : si le lecteur se raccroche en permanence à une image, on est dans la bande dessinée, si cet ancrage sur le dessin est impossible, on est dans le texte romanesque très illustré. Dans ce dernier cas, les illustrations restent nombreuses, elles restent compartimentées, mais elles fonctionnent souvent selon le principe de l'inventaire, en montrant par exemple les possessions terrestres des yuppies britanniques : cuillères en bois pour la salade, appartement monochrome, impersonnel et immaculé, maroquinerie de marque Prada, etc., ou encore les éléments de l'art de vivre français : toile de maître, maître d'hôtel, bouteille de calva, magazine de décoration, etc.
Quel que soit leur mode d'association, texte et dessin reviennent sur les mêmes éléments narratifs (c'est vrai même quand il y a alternance du texte et du dessin, c'est-à-dire quand ils se succèdent logiquement et chronologiquement), mais ils ne sont jamais redondants (c'est vrai même quand texte romanesque et zones de dessins sont juxtaposés : il y a toujours un gain narratif de l'un par rapport à l'autre). A la lecture, on n'éprouve jamais l'impression d'une redite, mais au contraire d'un éclaircissement permanent de l'un des éléments par l'autre. Dès que la séquence textuelle ou dessinée est suffisamment longue, on constate d'ailleurs des divergences entre les deux versions, comme si celles-ci naissaient du dispositif lui-même, c'est-à-dire d'une logique propre aux éléments du roman dessiné. Cela montre à quel point les question de la redondance entre le texte et l'image, et du progrès associé à l'autonomisation du dessin, questions qui ont obsédé la première génération des théoriciens de la bande dessinée, sont de faux problèmes.
Force est de constater aussi que cet éclaircissement mutuel du texte et du dessin (que les théoriciens désignent généralement comme les « rapports du texte et de l'image ») passe rigoureusement par les mêmes procédés selon que Gemma Bovery soit un roman illustré ou une bande dessinée avec « texte à côté de l'image ». Il n'y a donc pas, en dépit de ce qu'a soutenu une génération de critiques, de rapports entre texte et image qui seraient spécifiques à - et constitutifs de - de la bande dessinée. Cela apparaît clairement quand l'alternance ou la juxtaposition concernent un passage textuel élémentaire et une image unique. Comme on vient de la voir, la maquette nous les présente dans le cas ordinaire comme un texte romanesque typographié cédant la place à (alternance) ou accompagnant (juxtaposition) une illustration. Mais, d'un autre côté, l'auteur pourrait très bien faire du paragraphe de texte un récitatif (et par voie de conséquence de l'illustration une vignette de bande dessiné, un peu spéciale à vrai dire puisqu'elle serait isolée), et sur le plan de la transmission du sens, les deux dispositifs seraient strictement équivalents.
Nous hasarderons même une hypothèse : peut-être est-ce précisément parce qu'elles sont fondamentalement ambiguës (du fait que les relations entre texte et dessin sont les mêmes en BD et dans un texte romanesque illustré) que l'alternance ou la juxtaposition d'un paragraphe et d'une image restent ponctuelles dans Gemma Bovery. Lorsque cette alternance s'est produite une fois, l'auteur semble automatiquement faire un choix. Le paragraphe suivant introduit un passage en bande dessinée (dont la longueur va d'un strip à une page entière), ou, à l'inverse, c'est le texte romanesque qui est prolongé, accompagné d'une illustration ou d'un patchwork d'illustrations. Ou bien le texte devient effectivement un récitatif, accompagnant une séquence en bande dessinée (au lieu d'occuper toute la largeur de la page, il est disposé au-dessus des cases, et souvent composé dans un corps plus petit).
Gemma Bovery n'est pas seulement un excellent roman graphique, mais aussi une extraordinaire étude sociologique. Les yuppies londoniens sont absolument répugnants. Large, l'ex-petit ami de Gemma, critique gastronomique dans une revue pour yuppies, est littéralement payé pour se goberger et considère son métier comme une sorte de concours de snobisme avec les restaurateurs (« encore un endroit plutôt en dessous de la moyenne et qui essaie d'en mettre plein la vue »). Avec Gemma, il se montre supérieur et condescendant (ils n'ont jamais de conversations, il se contente de disserter en la prenant de haut), il l'exhibe comme un trophée et il est possible qu'un de ses buts en l'entraînant dans les restaurants soit purement sadique (il chercherait à l'engraisser ; quoi qu'il en soit, il la plaque, après qu'elle ait pris dix-sept livres, au profit d'une fille plus conforme aux canons). Les voisins anglais de Gemma en Normandie, les Rankins, sont un couple d'insupportables parvenus (lui est enrichi dans la finance, elle est « chasseur de tête »). Tous ces gens sont fondamentalement corrompus et cette corruption s'étend à l'entour. Tant qu'elle est avec Large, Gemma réalise des illustrations pour sa revue pour yuppies, en les bâclant. En Normandie, Gemma gagne sa vie en peignant du faux-marbre dans les salles de bain du pied-à-terre des Rankins. Cependant les revenus extravagants de cette faune et leur culte délibéré du kitsch - l'argent et la consommation ostentatoire - ne sont en réalité que des outils au service de leur véritable but, qui est la soif du pouvoir. Mrs. Rankins n'embauche Gemma comme décoratrice que pour pouvoir la ravaler au rang d'employée, alors même qu'elle affecte de la traiter comme une amie.
Aux antipodes des yuppies, se situe un second groupe de personnages, qui ont fait le choix d'une existence frugale, à commencer par Charlie Bovery, le mari de Gemma, qui ne demande rien de plus à l'existence que de travailler à son rythme à son métier d'ébéniste, en jouissant de la douceur de vivre normande. Joubert, le narrateur, universitaire devenu boulanger, est son homologue français.
Le problème de Gemma est précisément qu'elle n'arrive pas à choisir entre les yuppies et les frugaux. En bonne petite bourgeoise anglaise débarquée en Normandie, elle commence par s'extasier sur le bon pain français et par remplir sa maison d'antiquités paysannes, mais, elle s'ennuie rapidement (comme l'avait prédit Joubert), fait des dettes, prend un amant. Au lieu de se tuer, comme la vraie madame Bovary, elle meurt d'un accident stupide.
Les autres personnages brouillent le schéma. L'amant de Gemma, Hervé, un étudiant en droit pas particulièrement brillant, est une sorte de négatif des yuppies. Il appartient à la catégorie des nantis, mais n'est pas un parvenu (c'est un fils de bourgeois du 17e arrondissement et sa mère possède un château en Normandie). Au lieu de kitschiser son environnement, il laisse au contraire le mobilier de son château tomber en poudre noblement sous la dent des vers du bois. L'ex-femme de Charlie, Judy, est un négatif des « frugaux ». Elle n'est pas riche, mais n'a nullement choisi de vivre de rien. Elle a, au contraire, du mal à joindre les deux bouts, et passe son temps à extorquer argent et corvées à son mari (c'est en partie pour la fuir que les Bovery s'installent en Normandie), en usant constamment du moyen de chantage que constituent ses enfants.
Curieusement, la partie la plus faible du roman est l'idée centrale, c'est-à-dire le thème de la malédiction, Gemma étant prédestinée par son nom à connaître le destin de la madame Bovary de Flaubert. Le boulanger Joubert, qui est secrètement épris de Gemma, est à la fois paniqué par ce qu'il considère comme une fatalité et convaincu, pour des raisons assez peu vraisemblables, qu'il est responsable du destin tragique de la jeune femme. Le roman n'avait pas besoin d'un tel procédé, qui l'alourdit assez inutilement, et l'auteur aurait pu se fixer tout simplement le programme de faire une madame Bovary moderne, qu'il n'était pas besoin d'expliciter davantage.
 Ce
détail est insignifiant. Le livre est magistralement
écrit et dessiné. Il propose une merveilleuse
collection de portraits acides (les yuppies britanniques, la
divorcée revancharde, l'étudiant à loden, la
rombière du 17e arrondissement). Gemma est peinte avec
réalisme et sympathie, elle est attachante en dépit de
ses défauts et plutôt plus intéressante que sa
quasi homonyme flaubertienne. Le livre ne tombe dans aucun des
poncifs du féminisme ou d'une écriture fémeline
à la Anais Nin, mais renoue avec l'acuité
d'écrivains femmes comme George Eliot. L'autorité et la
supériorité sociale que la possession d'enfants
confère à une femme, la façon dont Gemma change
de poids en prévision d'un changement de vie et,
littéralement, se redessine elle-même, sont finement
observés, d'un point de vue typiquement féminin.
Ce
détail est insignifiant. Le livre est magistralement
écrit et dessiné. Il propose une merveilleuse
collection de portraits acides (les yuppies britanniques, la
divorcée revancharde, l'étudiant à loden, la
rombière du 17e arrondissement). Gemma est peinte avec
réalisme et sympathie, elle est attachante en dépit de
ses défauts et plutôt plus intéressante que sa
quasi homonyme flaubertienne. Le livre ne tombe dans aucun des
poncifs du féminisme ou d'une écriture fémeline
à la Anais Nin, mais renoue avec l'acuité
d'écrivains femmes comme George Eliot. L'autorité et la
supériorité sociale que la possession d'enfants
confère à une femme, la façon dont Gemma change
de poids en prévision d'un changement de vie et,
littéralement, se redessine elle-même, sont finement
observés, d'un point de vue typiquement féminin.
Enfin, le livre nous surprend continuellement par des trouvailles textuelles, graphiques ou les deux. C'est vrai dès la couverture, qui joue habilement sur le poncif de la pruderie Britannique. Gemma tient une bouillotte (la bouillotte est censée remplacer le sexe pour réchauffer une Anglaise). Mais le symbole est détourné, puisque cette bouillotte-là sert à Gemma à se protéger du froid quand elle se rend, nue sous son manteau, chez son nobliau d'amant. Le regard en coin de Gemma, symbole de sa lubricité perverse, et un coin de soutien gorge rouge qu'on aperçoit à l'échancrure du manteau, renforcent le message tout en lui donnant la valeur d'ironie qui convient.